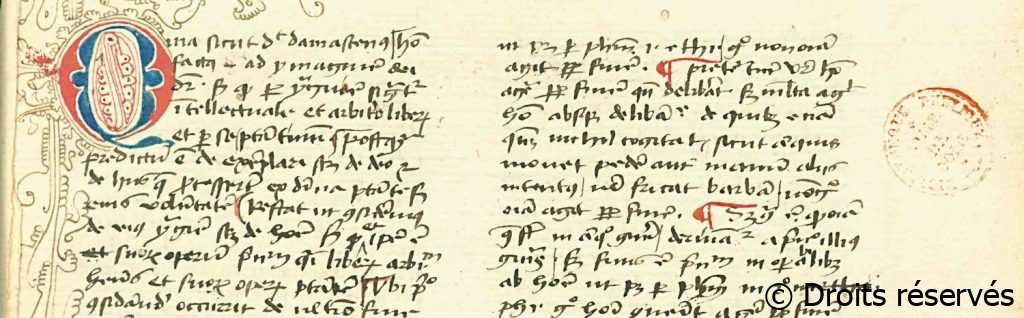Très tôt, l’espace de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est construit en fonction de territoires. Des alliances avec des universités voisines se sont sans cesse esquissées, construites, puis distendues. Dès le début des années 1960, des liens étroits se tissent entre elles.
Une ouverture importante s’affirme avec l’Entente du Grand Est qui regroupe les universités de Besançon, Dijon, Metz, Mulhouse, Nancy 2, Reims et Strasbourg 2, dont les présidents se rencontrent à intervalles réguliers. En 1971, grâce à leurs compétences réunies et partagées, ils discutent pour résoudre des problèmes communs, comme ceux posés par le passage), imposé par la loi Faure, des facultés aux unités d’enseignement et de recherche (UER. À l’instar des présidents d’université, les secrétaires généraux des établissements d’enseignement supérieur du Grand Est ont, eux-aussi, leur propre groupement et travaillent de concert. C’est ainsi qu’en décembre 1994 à Nancy, ils prennent une initiative innovante en impulsant la création du réseau des responsables de formation permanente. Ce dernier permet un échange très riche de bonnes pratiques et d’harmoniser la mise en application des réformes. D’autres services travaillent aussi de manière proche, notamment pour le déploiement de l’informatique.
Déjà, en 1955, les études de médecine à Besançon sont étroitement liées à leur tutelle nancéienne. En effet, le décret du 20 janvier “nationalise” les écoles préparatoires de médecine et les écoles de médecine de plein exercice[1]. Celle de Besançon peut dispenser les cours de l’intégralité des années d’études, mais la thèse d’exercice doit toujours être passée à la faculté de tutelle de Nancy. Cette situation pose de nombreux problèmes de coordination, pénalisant gravement les étudiants bisontins pour la passation de leurs examens et du concours d’internat. À partir de 1964, la création d’une faculté de médecine bisontine est présentée comme une libération indispensable de la « tutelle pathogène » de Nancy, terme largement repris par la presse locale, qui se fait l’écho des difficultés récurrentes avec cette faculté. Par le décret du 11 janvier 1967, l’école nationale de médecine et pharmacie de Besançon se mue officiellement en faculté de médecine autonome. Cependant les relations en médecine pharmacie avec le Grand Est restent toujours très fortes, et se traduisent notamment par de nombreux diplômes interuniversitaires communs (DIU).
Les membres de l’Entente du Grand Est comptent également chacun un centre de télé-enseignement universitaire qui se fédèrent dans les années 1964-1968 en un réseau précurseur. Depuis 1968[2], pour éviter la concurrence, chacun des cinq centres s’est spécialisé dans l’enseignement d’une ou plusieurs matières. Celui de Besançon prépare au DEUG et à la licence d’histoire ainsi que, depuis 1976, à la première année de DEUG mathématiques appliquées et sciences sociales, en collaboration étroite avec la faculté des sciences. La pratique précédant souvent le droit, c’est seulement en 1974 et 1975 que les statuts de la fédération interuniversitaire de l’Est (FIT Est) sont adoptés par les conseils des différentes universités.
Très attaché à cet ancrage territorial dans l’est de la France, Michel Woronoff fait inscrire cet objectif nommé « désenclavement » dans le contrat quadriennal de développement 1992-1995. En retour, dans le document signé le 10 juin 1992, le ministère de l’Éducation nationale prend officiellement acte de cette collaboration entre les universités du Grand Est, à l’initiative de l’université de Franche-Comté, mais n’accorde aucun financement[3].
Cette volonté de travailler en bonne intelligence avec les universités de proximité se lit également du côté alsacien. Des tensions existent en effet, notamment par rapport au projet d’ouverture du DUT génie des télécommunication à Montbéliard, alors que l’IUT de Colmar ouvre la même formation à la rentrée universitaire 1993-1994. Le 19 février 1993, une rencontre entre les universités de Haute-Alsace et de Franche-Comté[4] se tient à Belfort afin de développer un dialogue sur l’ouverture des formations dans la complémentarité. Le DUT génie des télécommunications, émanation du département génie électrique et informatique industrielle, ouvre bien en 1994-1995.
Sous le mandat de Claude Condé, le 17 janvier 2003, l’Entente du Grand Est se transforme en conférence des présidents d’université (CPU) Grand Est. L’université de Bourgogne, avec sa présidente Sophie Béjean, ont rejoint le réseau. Les partenaires se réunissent toujours quatre fois par an, dans un bel esprit de coopération et d’enrichissement mutuel. Représentant une entité géographique cohérente, ils entendent bien peser face à la CPU nationale en se faisant entendre d’une voix unique et consensuelle lors des grandes décisions nationales en matière d’enseignement supérieur et de recherche.