Dès 1971, les présidents successifs sont soucieux d’« informer » leur communauté et les partenaires institutionnels. C’est dans cet objectif qu’est créé le Bire (bureau d’information et des relations extérieures)[1], à l’initiative du président Jean Thiébaut (1971-1975).
Le mot « communication » apparaît pour la première fois sous le mandat de Pierre Lévêque. Il s’agit de la thématique retenue en mai 1976 pour la cinquantième foire comtoise à Micropolis. Pour cet événement, le vice-président Jean-Charles Viénot coordonne la présentation d’une exposition sur six laboratoires[2] de recherche. C’est une grande première pour cette jeune université que de communiquer sur sa recherche et sur son offre de formation continue auprès du grand public et des partenaires extérieurs. Avec son emphase coutumière, P. Lévêque déclare à ce propos[3] : « par sa vocation d’enseignement et de recherche, conforme à la tradition et à la loi, l’université est un centre privilégié de communication, d’une part entre enseignants et enseignés, d’autre part entre hommes et cosmos[4] et entre homme et société ». De fait, le mot « communication » s’inscrit désormais dans les objectifs de l’université.
Lors de son mandat (1986-1991), Jean-François Robert confie à René Didi et à l’équipe du Bire la création d’une nouvelle identité visuelle, fédératrice et moderne, pour l’université, et à Madeleine Lafaurie la conception du nouveau journal en direct, ouvert vers le monde socio-économique.
En 1984, René Didi crée la« média », mission pour l’enseignement, la diffusion et la production audiovisuelle[5], un service commun de l’université hébergé dans les locaux du service audiovisuel de la Ville de Besançon. L’objectif est de réaliser des films vidéo et des CD roms pour valoriser les innovations des équipes universitaires en botanique, microchirurgie oculaire, phonétique, français langue étrangère, communication gestuelle, apprentissage de la lecture labiale pour malentendants…. Certains documents sont coproduits avec d’autres universités, comme celle de de Mulhouse ou le Queensland university…). En 1994, Jean Ritter, directeur de la média, réalise un film de promotion de neuf minutes sur l’université. L’UFR de médecine et de pharmacie compte très vite, dès 1973, un photographe pour ses besoins d’enseignement et de recherche. Georges Pannetton, recruté sur ce poste, est, petit à petit, sollicité pour couvrir les évènements et réaliser des reportages pour les besoins de publications de l’université. C’est ainsi qu’il devient le photographe officiel de l’établissement, rejoignant à la rentrée 2005 le service central de la communication de l’université. Ludovic Godard lui succède de 2009 à 2018.
Lors du mandat (1991-1996) de Michel Woronoff, le service du Bire se scinde en deux. D’une part, les postes concernant l’information sur les formations et l’orientation des lycéens et l’insertion professionnelle des étudiants sont désormais regroupés dans le SIO (service d’information et d’orientation), qui deviendra le SCUIO (service commun universitaire d’information et d’orientation)[6]. D’autre part, le service « presse » regroupe les deux journaux, en direct et tout l’U, tandis que naît le service communication que me confie le président. Avec Christiane Grillier, nos actions portent initialement sur la communication institutionnelle et événementielle de l’université : cartons d’invitation, affiches, papeterie, cartes de visite, cérémonies des vœux, des personnels, organisation et valorisation des évènements qui rythment l’année universitaire. J’assure également les relations avec les médias, l’organisation des conférences de presse et la vente d’encarts publicitaires pour contribuer au financement du journal tout l’U. Avec l’accord du secrétaire général, nous créons un sous-service « colloques » pour accompagner les enseignants-chercheurs dans l’organisation de leurs séminaires de recherche ou de leurs congrès, pour lesquels nous prenons en charge l’organisation logistique de A à Z. Cette prestation de service, facturée, autofinance en partie nos deux postes sur budget propre. Elle apporte une solution de facilité aux enseignants-chercheurs et donne une visibilité accrue aux manifestations scientifiques de l’université. Le succès est tel que ce service quitte la communication pour rejoindre la direction de la valorisation, que Jean Piranda vient de créer. Chr. Grillier en devient la responsable.
La communication de l’établissement se déploie alors avec les présidents et secrétaires généraux successifs, au service de l’intérêt commun de l’établissement. Différents outils s’institutionnalisent : la parution des organigrammes, des dépliants « Les étudiants en chiffres », puis « Les personnels en chiffres », des panoramiques sur les cartes des formations et de la recherche, des répertoires téléphoniques internes, des annuaires de la recherche et des formations.

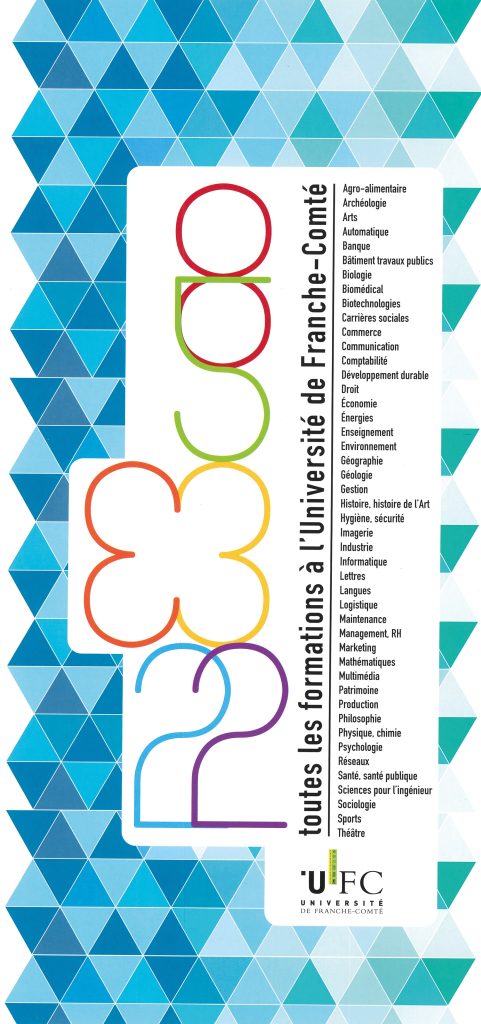
À chaque changement de contrat quadriennal, le service communication réalise de nouveaux jeux de dépliants sur chacune des formations de l’UFC, documents qui sont très utiles aux collègues du SCUIO, et à ceux des UFR et instituts lors des journées portes ouvertes ou des salons d’information sur l’enseignement supérieur.
La communication auprès des lycéens, futurs étudiants, est un enjeu d’attractivité important pour une université. L’image de cette dernière n’est pas toujours bien perçue par les enseignants de lycées et par les familles. Il apparaît souvent rassurant pour un lycéen de poursuivre des études, très encadrées, en BTS, dans le cadre connu du lycée. Conscient de cette difficulté, le rectorat de l’académie de Besançon appuie différentes mesures[7], afin de renforcer le dialogue dans la perspective bac-3/bac+3. Deux initiatives de la direction de la communication et du SCUIO vont se démarquer comme des cas d’école, uniques au niveau national.
Tout d’abord en direction des lycéens : après avoir produit un livret informatif sous la forme d’un agenda, offert à tous les lycéens en classes de terminales de l’académie et aux étudiants pendant 4 années, à partir de la rentrée 1997-1998, puis un « Mémo », coédité avec l’ONISEP (Office national d’information sur les enseignementset lesprofessions) de Franche-Comté, en 2002-2003, une collaboration étroite se concrétise, quelques années plus tard, par une coédition.
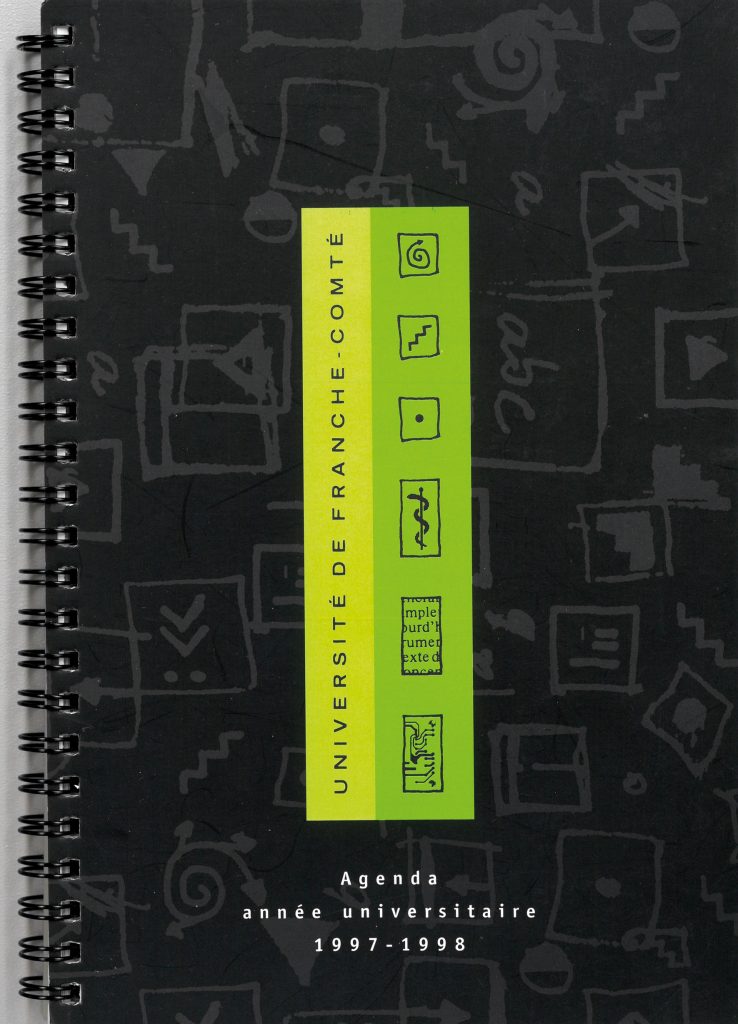
À partir de la rentrée 2013, l’UFC s’associe[8] à la délégation régionale de l’ONISEP et au Centre d’information et d’orientation (CIO)[9], et coproduit l’édition régionale franc-comtoise du guide « Entrer dans le supérieur, après le Bac ».
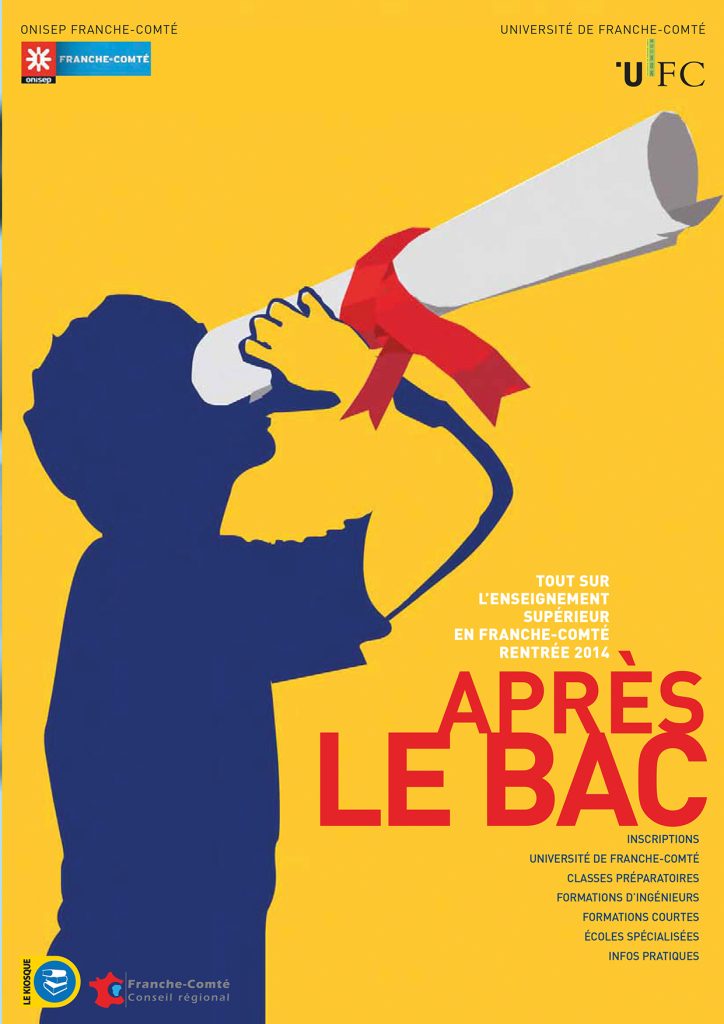
Cet outil de référence a fait ses preuves. Produit par chacune des régions académiques, ce guide recense l’offre régionale de formations du supérieur et bénéficie d’une excellente diffusion. Très lu par les lycéens et leurs familles, il est également utilisé au quotidien par les conseillers d’orientation, prescripteurs d’informations. Les coéditeurs se partagent la recherche de financements[10] et la mise à jour du contenu[11]. Le graphisme et la mise en page se veulent attractifs, distinguant le guide franc-comtois des autres éditions régionales. Ce partenariat permet à l’université de Franche-Comté d’insérer dans ce guide un cahier complet de 35 pages, sur les 98 du livret. Un partenariat de cette ampleur se démarque au niveau national[12]
Une deuxième initiative permet de mutualiser un outil d’information pour les étudiants primo-arrivants à l’université. En effet, l’édition de guides d’accueil pour cette catégorie d’étudiants s’avère nécessaire. Initialement, des numéros spéciaux du journal tout l’U, puis du journal tout l’Ufc, sont publiés. En 2001-2002, ce guide, qui permet de retrouver toutes les informations sur la vie étudiante, prend la forme d’un petit livret, intitulé « tout(e) l’U, toute l’université dans la poche». Cependant, certaines de ses rubriques (se loger, se restaurer, par exemple) forment un doublon avec les informations diffusées dans le « guide annuel du Crous ». Pour éviter cette surenchère, un nouveau partenariat est signé entre l’UFC et le Crous Franche-Comté. À partir de 2013-2014, un livret commun, le « guide de l’étudiant du Crous et de l’université de Franche-Comté » est coédité et distribué lors des réunions de rentrée ainsi que dans les restaurants et les résidences universitaires.
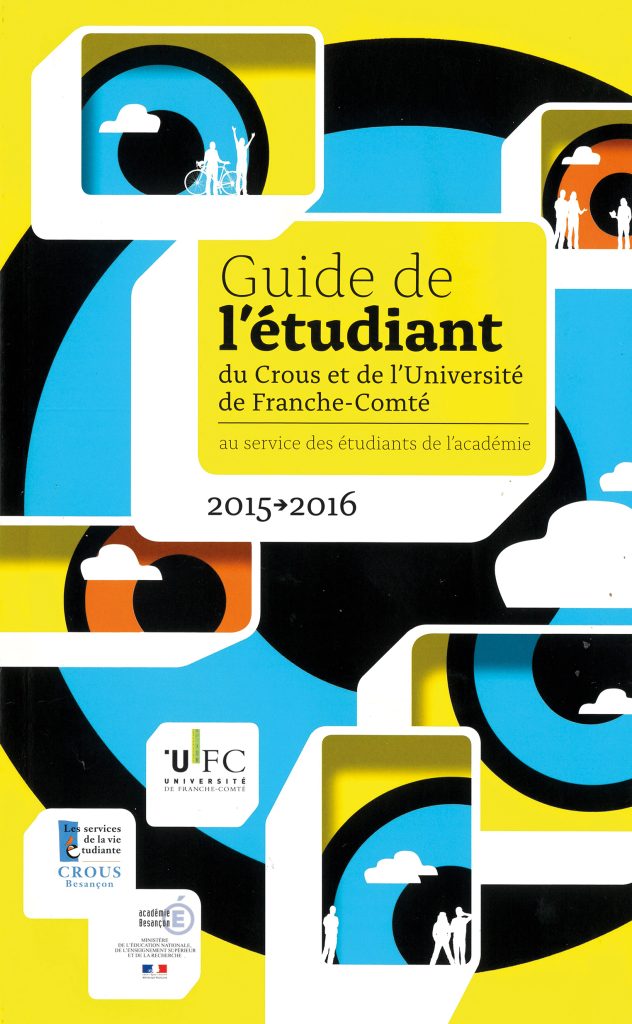
Cette démarche s’arrête en 2018-2019, date à laquelle la version papier de ce livret bascule en numérique sur le site internet. Ce nouveau format, où les informations peuvent être mises constamment à jour, convient mieux à la cible étudiante[13].
Les présidents prennent de plus en plus conscience de l’importance de la communication pour le rayonnement et l’attractivité de leur établissement. Claude Oytana est le premier président à doter le service d’une ligne budgétaire propre[14], alors que, précédemment, les dépenses étaient prises sur le budget général du président. Françoise Bévalot nomme pour la première fois un vice-président délégué à la communication (Francis Farrugia). Grâce à son soutien, le service prend alors le nom de direction de la communication. Claude Condé, pendant le mandat suivant, nomme Daniel Sechter pour les mêmes missions. Le budget augmente peu à peu, complété par d’incessantes recherches de financements auprès des partenaires – principalement la région Franche-Comté, les départements, les agglomérations et les villes universitaires –, sans qui les guides ne pourraient être produits.
En 2005, le journal interne tout l’U est intégré la direction de la communication. Publié sous un format tabloïd pendant treize ans, ce support évolue en un magazine de 16 pages en février 2005[15], puis s’intitule tout l’Ufc en novembre 2008[16]. Ce nouvel outil de communication valorise la vie universitaire, les formations et la recherche sous forme d’articles longs, de dossiers de fond et transversaux. Ce journal prend parfois la forme de numéros spéciaux qui peuvent être consacrés aux formations, comme le tout l’u « spécial licence » ou le tout l’u « spécial masters », très utiles pour les salons, ou peuvent être consacrés à une composante. Ainsi naissent, à partir de décembre 2007, les tout l’u spéciaux de SLHS puis de STGI, STAPS, SMP…
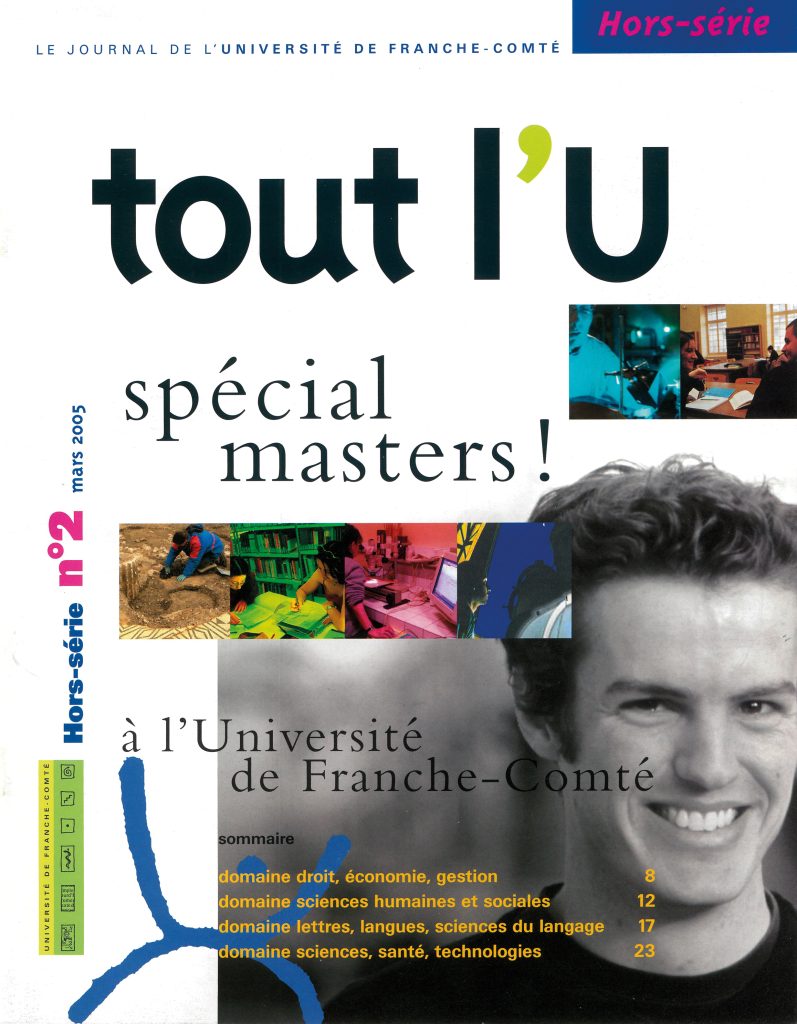
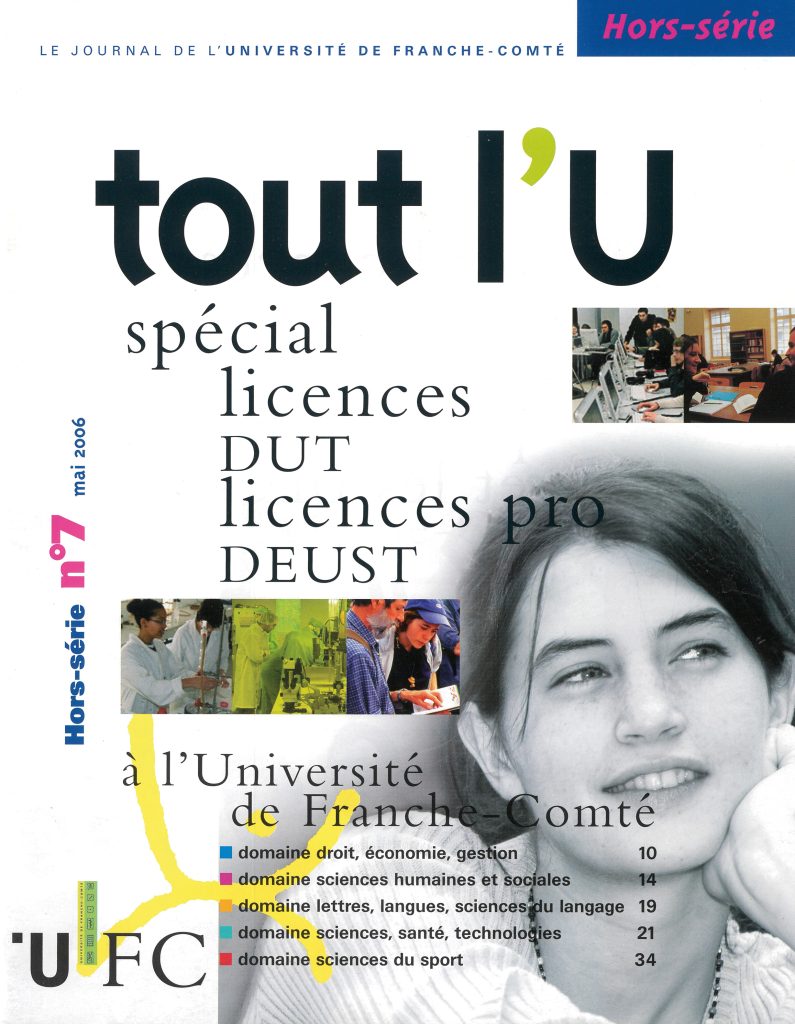
L’arrivée d’Internet ouvre une avancée majeure dans la diffusion de l’information et pour la communication. Contrairement aux outils papier émis jusqu’alors, l’information sur internet est immédiate et visible par tous. En 1998, Nadège Chèvre est recrutée en qualité de cheffe de projet et webmaster, pour concevoir le premier site internet de l’université. En étroite collaboration avec les collègues du CRI (le centre de ressources informatiques[17]), elle relève ce défi inédit pour l’établissement. Cette première technologie, qui fait suite au Minitel, s’appuie sur Explid, un CCMS[18] propriétaire développé par un prestataire extérieur, la société ID.FR. Afin de promouvoir le nouvel outil auprès de la communauté universitaire et d’en faciliter l’appropriation, différents documents sont produits.
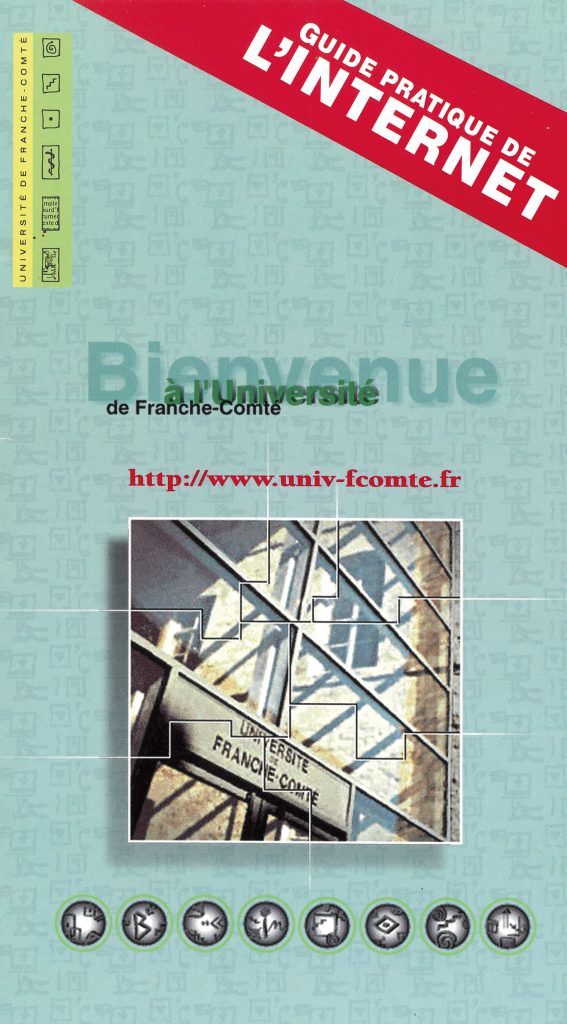
En complément, un site intranet permet de d’élaborer une communication interne avec les services centraux de l’université. Des correspondants web assurent le relais dans les composantes et participent au comité de pilotage[19]. En avril 2004[20], une deuxième version du site, bénéficiant d’avancées techniques et plus ergonomique, voit le jour.
Petit à petit, le web devient une évidence et une nécessité pour chacun. Les composantes, les services, les laboratoires, les départements, souvent même les formations, tous veulent leur propre site afin de leur offrir une vitrine sur le monde. Devant ce foisonnement intempestif, l’image de marque de l’université se brouille, le site Internet se réduit peu à peu à une immense armoire, où s’entassent indifféremment des actualités « chaudes » ou des informations « froides » (pérennes), internes et externes, et où le nombre de pages n’est plus maîtrisé. La direction de la communication et la direction des services informatiques et du numérique (DSIN) peinent à résoudre de nombreux bugs incessants. L. Godard, webmaster, en collaboration avec la DSI, entreprend de réduire les 450 sites délégués au nombre de 150 et il accompagne les utilisateurs avec une maintenance rapprochée.
En 2012, le président J. Bahi mandate Sophie Zecchini, directrice de cabinet, pour conduire la refonte globale du web universitaire et des outils de communication annexes. Il s’agit d’en faire une vitrine attractive et dynamique de l’université. Pour mener à bien cette mission à moyens constants, un binôme de deux chargés de projet est désigné : Delphine Gosset (par ailleurs journaliste et rédactrice du journal interne) et L. Godard (en outre webmaster et photographe).
En étroite collaboration avec la DSIN[21] et la direction des services juridiques, ils conçoivent une nouvelle architecture de l’information en restructurant les contenus et les circuits de diffusion, et en faisant le choix de Drupal[22], un nouveau CCMS en accès libre. Ils organisent l’information avec un site d’actualité en ligne, « L’Actu », qui prend désormais le relais au format numérique, en janvier 2014, du précédent journal papier tout l’Ufc. Avec son approche journalistique moderne et la qualité professionnelle de ses photographies d’illustration, l’Actu rejoint la génération des sites d’information généralistes en ligne, susceptibles d’intéresser également le public extérieur. Les reportages d’actualité peuvent être republiés[23] sur les sites des composantes, en fonction des articles qui les intéressent. Le système est conçu pour pouvoir en extraire une newsletter hebdomadaire, créée automatiquement et diffusée à près de 30 000 abonnés dans la communauté universitaire et auprès des partenaires extérieurs.
À la rentrée universitaire 2013, pour apporter une main experte à la gestion et à l’animation des réseaux sociaux de l’université, Delphine Frésard est recrutée en qualité de community manager[24]. Elle met en place une stratégie et une charte de bonne pratique des réseaux sociaux pour l’établissement et anime un réseau de correspondants. L’université dispose de comptes sur LinkedIn, Facebook, Tweeter et Instagram, qui permettent notamment de relayer les articles du site d’actualités et d’optimiser une communication virale.
Après un très important travail de fond, le projet de refonte aboutit en 2016. L’ensemble du site global et des sites délégués font peau neuve et sont customisés, de l’arborescence aux textes et aux images. Le portail central du web universitaire pilote l’ensemble des sites institutionnels (composantes, laboratoires, services communs…). Désormais, un système centralise et diffuse automatiquement des contenus fiables et validés, sans duplication, ni problème de redondance ou d’obsolescence. L’affichage de l’offre de formation s’effectue dans un lieu unique, vers lequel les composantes peuvent effectuer un renvoi plutôt que de développer chacune leurs propres pages et d’effectuer de multiples corrections à différents endroits.
Pendant de très nombreuses années, le service communication central travaille en étroite relation avec l’ensemble des services centraux, communs, des composantes et des laboratoires. En effet, presque aucune des composantes ne dispose alors, comme actuellement, de postes consacrés à la communication. Deux adjointes techniques[25] arrivent en renfort pour gérer notamment les expéditions postales de documents concernant l’offre de formation dans les lycées et dans les CIO, ou les plaquettes destinées aux envois internationaux. Ce sont également elles qui préparent les packs d‘accueil destinés aux visiteurs et aux congressistes.
Afin de donner une unité d’image aux multiples extensions territoriales des campus, Joël Berger, vice-président de Claude Condé, me mandate pour harmoniser la signalétique des composantes afin d’afficher une unité visuelle cohérente. C’est ainsi qu’un vaste chantier de signalétique est entrepris, en collaboration avec la direction du patrimoine immobilier. Des totems identiques et des vitrophanies rythment alors les façades des différents bâtiments universitaires, afin que tout visiteur, tout chercheur ou tout étudiant, qu’il soit dans l’une ou l’autre des cinq villes universitaires, sache désormais qu’il est à l’université de Franche-Comté. Cette fierté d’appartenance se développe aussi lors des nombreuses manifestations qui rythment l’année, tout particulièrement lors des cérémonies de vœux ou des cérémonies honoris causa.
L’identité visuelle de l’université, conçue par Catherine Zask et mise en place par René Didi sous le mandat (1986-1991) du président Jean-François Robert, se modifie peu à peu. Michel Wonoroff, pour sa correspondance personnelle de président, préfère revenir à une forme plus classique avec le visuel du sceau de l’université de Dole « revisité et modernisé », mais ne remet pas en question la coexistence avec le logo précédemment adopté. En mai 2000, sous le mandat de Claude Oytana, l’originale identité visuelle de l’université de Franche-Comté, conçue par C. Zask, fait toujours référence en France. Le magazine national Vie universitaire sélectionne la communication de l’UFC pour son étude de cas sur la communication[26]. Le titre retenu est « La communication de l’université de Franche-Comté, ou comment passer d’une culture “facultaire” à une culture d’établissement » et le sous-titre en est « Enquête sur une université omnidisciplinaire et éclatée sur plusieurs sites qui s’est forgée une identité en une douzaine d’années ». En 1998, Cl. Oytana fixe la stratégie de l’établissement autour de quatre axes pour le plan de communication. Tout d’abord, délivrer une information homogène, précise et transparente auprès des lycéens et des étudiants pour les aider à réussir leurs études à l’UFC ; mettre l’accent sur la recherche ; améliorer la communication interne dans un souci de modernisation et de transparence, avec une circulation à double sens ; et enfin, harmoniser une communication graphique et institutionnelle unique pour tous.
Ce dernier point retient particulièrement l’attention de Françoise Bévalot, la présidente suivante, qui l’inscrit pour la première fois dans le contrat d’établissement 2004-2007. Cette mesure (n° 50) vise à optimiser les outils de communication, notamment le renforcement du site web, et à délivrer une image et un message unitaires. Désormais, homogénéiser l’ensemble des supports et déterminer une stratégie de communication unique et consensuelle s’imposent. En avril 2003, elle fait procéder à un recensement de tous les supports de communication engendrés dans les composantes et une estimation de leur coût financier global à l’échelle de l’UFC. À la suite de cette étude, la présidente me confie la réalisation de jeux de dépliants sur chacune des formations de l’université, chartés en une ligne graphique unique[27].
Claude Oytana et Françoise Bévalot encouragent l’utilisation du logo dessiné par Catherine Zask en 1987. Cependant, une contrainte revient régulièrement : les caractères typographiques et les pictogrammes deviennent vite illisibles lorsque le logo est apposé en petit format. Devant cette difficulté, Françoise Bévalot fait rajouter les initiales UFC en bas d’une version réduite du cartouche des pictogrammes.
Devant la multiplicité et le foisonnement des logos des composantes, des laboratoires et des services, Jacques Bahi, lors de son mandat, demande aux composantes et aux services de systématiquement juxtaposer le logo de l’UFC à côté du leur.

Puis, en 2017, J. Bahi fait adopter un nouveau logo[28], dessiné par Élodie Croizier, graphiste à la direction de la communication. Il privilégie la mention « Université de Franche-Comté », mise en avant. La couleur emblématique du logo passe du vert au rouge. Dans un second temps de son mandat, il demande de décliner cette nouvelle version, en la personnalisant pour chacune des composantes, afin de la substituer aux multiples logos préexistants. Au 1er janvier 2025, un nouveau logo est créé pour le passage à l’université Marie et Louis Pasteur : il revêt une facture proche du logo précédent pour favoriser une transition graphique en douceur.

La direction de la communication aujourd’hui
Depuis 2021, sous le mandat de Macha Woronoff, Gaëlle Galdin[29] a réorganisé la direction de la communication de l’université de Franche-Comté, qui pilote désormais une stratégie globale visant à valoriser l’identité, les actions et les valeurs de l’établissement. Au service de la communauté universitaire, la direction, organisée en quatre pôles[30] et tournée vers le numérique grâce à l’expertise de Mathilde Dehestru, directrice adjointe, met en œuvre des actions de communication adaptées à ses divers destinataires : étudiants, personnels, partenaires institutionnels et économiques, ainsi que le grand public.
Elle coordonne la diffusion des informations, qu’il s’agisse de projets pédagogiques, de recherche, d’événements ou de campagnes de sensibilisation. En s’appuyant sur des outils et des supports variés, elle contribue à renforcer la visibilité et l’attractivité de l’université, tout en favorisant les échanges et le sentiment d’appartenance au sein de la communauté universitaire.
Dans un contexte où la communication publique évolue pour répondre aux attentes de positionnement des établissements comme marques fortes, la direction de la communication s’engage à affirmer l’identité de l’université, à la fois ancrée dans son territoire et ouverte sur le monde, en valorisant ses singularités et son excellence.