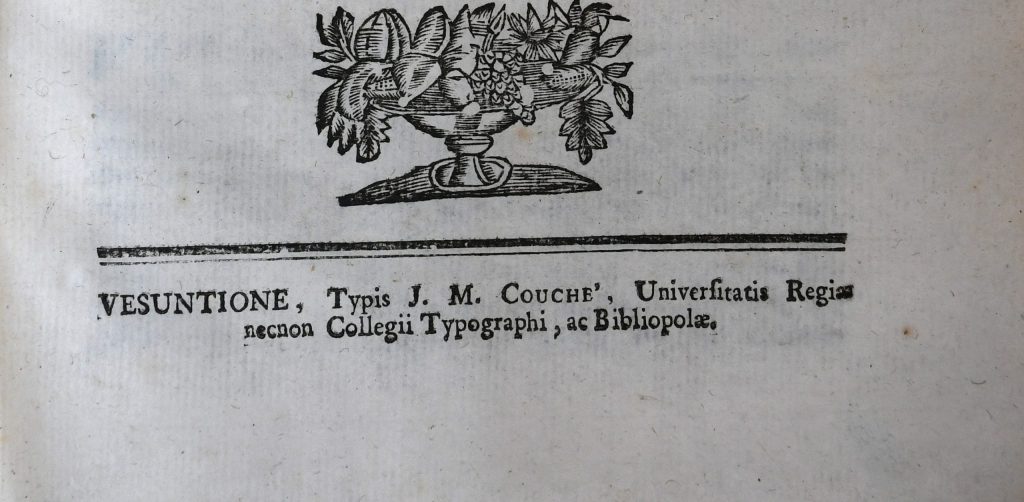En 1970, une unité technique, le centre de microscopie électronique et de cytophotométrie, ouvre sur le site de l’Arsenal, à l’unité d’enseignement et de recherche biomédicale (UER BEM), puis est complétée par deux autres unités fonctionnelles, implantées à l’UER sciences et techniques : au laboratoire de zoologie et d’embryologie, place Leclerc, et au laboratoire de mécanique appliquée, à la Bouloie. Ils soutiennent les activités de formation à la microscopie électronique et à l’analyse X. Ils sont également prestataires pour l’ensemble des équipes de recherche de l’université et auprès des industriels pour visualiser morphologiquement la surface de tout matériau, de l’échelle microscopique à quelques dizaines de nanomètres, ainsi que pour déterminer la nature et la localisation surfacique des éléments présents. Robert Parisotto, technicien, en assure le service.
Afin de répondre à une orientation du ministère souhaitant l’émergence de services structurants dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ce centre se transforme en service commun en 1980. Intitulé Centre de microscopie électronique de l’université de Franche-Comté[1], le CME est alors au bénéfice du collège des usagers. Dirigé alors par Danièle Lenys, il comprend une centaine de membres, représentant les différents laboratoires utilisateurs. Ce service d’appui à la recherche est équipé d’un matériel de pointe renouvelé : un microscope électronique à transmission, deux microscopes électroniques à balayage, un analyseur X, un système cryofracture et un analyseur d’images..
Le CME, qui n’a pas de thématique de recherche propre, met ses compétences à la disposition de tous les laboratoires de recherche, mais aussi des entreprises. Il assure la formation auprès des étudiants de licence, de maîtrise et de 3e cycle en biologie, pharmacie, physique et chimie, accueillant également des stagiaires.
Du 25 au 27 mai 1981, Michèle Bride, professeur en biologie, est désignée par l’équipe du CME pour organiser à l’université de Franche-Comté l’accueil du colloque annuel de la société française de microscopie électronique (SFME)[2]. Celui-ci rassemble 300 congressistes venus écouter 32 conférenciers, dont 15 d’Allemagne, de Belgique, du Canada, des EU et de Suisse. Ce colloque se déroule au bâtiment de propédeutique de la Bouloie, lieu propice avec son grand hall et ses amphithéâtres distribués tout autour.
Michelle Bride, devenue directrice du CME depuis 1987, et l’université de Franche-Comté obtiennent en février 1996 un financement du conseil régional et de l’établissement de transfusion sanguine de Franche-Comté afin d’acquérir un nouveau système de visualisation. Celui-ci associe, de manière novatrice, deux technologies de pointe : la microscopie confocale et le système CellScan. Le CME se trouve désormais rassemblé sur le seul site de l’Arsenal. Alors commercialisé depuis dix ans, le microscope confocal utilise une source lumineuse laser. Ce microscope permet de travailler sur des coupes plus épaisses qu’un microscope optique, jusqu’à 200 microns. Il offre la possibilité de prendre des images à plusieurs niveaux superposés, d’obtenir une seule image finale en les additionnant et de voir “l’intérieur des volumes”. Le système CellScan, plus récent, utilise comme source lumineuse la lampe fluorescente classique. Ce système de traitement informatique des données permet le « défloutage d’images » dans le volume, par ré-affinement des photons, ce qui améliore la netteté pour tous les plans. Il peut se connecter à tous les microscopes optiques. La prise de vue des images est faite par une caméra qui enregistre et restitue l’ensemble des informations. Michelle Bride a l’idée d’associer les deux systèmes et la soumet aux entreprises Leïca et Bionis, qui acceptent de relever le défi. Le CME en assure la mise au point. Ce microscope particulier permet ainsi, sur le même échantillon, de réaliser des images selon deux méthodes différentes.

Il possède toutes les qualités du microscope optique ainsi que des avantages spécifiques. Il offre une grande qualité de netteté et de contraste de l’image, une abondance d’informations, la possibilité de visualiser l’échantillon en 3D et de créer une animation d’images. Des observations sont possibles en fluorescence et en réflexion. Le système est conçu pour être évolutif, à tous les niveaux, qu’il soit confronté à une multiplicité de sources lumineuses, à différentes natures d’objectifs ou encore à un traitement informatique en aval.
En janvier 1997, à son départ en retraite, Michelle Bride transmet ses responsabilités à Bernadette Kantelip, praticienne hospitalière en anatomie et cytologie pathologique.

Georges Pannetton.

Des contrats sont passés pour accompagner d’autres utilisateurs des ressources du CME. Le CHU, pour qui il devient notamment nécessaire de réaliser des examens histologiques pour ses patients, a un créneau réservé chaque jeudi.
De son côté, l’institut fédératif de recherche ingénierie et biologie cellulaire et tissulaire (IFR 133)[3], créé en décembre 2004 et dirigé par Dominique Fellmann, dispose lui aussi d’un microscope confocal pour ses propres besoins en recherche. Sophie Launey, qui en est responsable, se rapproche en 2010 de la plateforme interrégionale DImaCell, dispositif d’imagerie cellulaire Bourgogne Franche-Comté, créé à Dijon l’année précédente. Ensemble, ils constituent le pôle de microscopie électronique et biophotonique dans les sciences du vivant pour les campus dijonnais[4] et bisontin[5]. DImaCELL propose des technologies et des méthodologies de haut niveau dans le domaine de l’imagerie cellulaire et tissulaire à l’ensemble de la communauté scientifique de la région Bourgogne Franche-Comté (universités, EPST et entreprises privées).
Cette diversification s’apparente au schéma de fonctionnement initial (1970), avec d’une part la microscopie des sciences du vivant et d’autre part la microscopie des autres sciences fondamentales. Dans ce second noyau qui reste au CME, Nicolas Rouge, ingénieur d’études, a succédé à Robert Parisotto en 2000 et accompagne les différents manipulateurs extérieurs. Le CME souffre cependant d’un manque de moyens en personnel technique. Sous le mandat de Françoise Bévalot, une restructuration s’effectue. Pierre-Marie Badot, vice-président recherche, décide en 2005-2006 de regrouper trois services techniques centraux liés à la recherche et qui effectuent des prestations auprès des partenaires extérieurs et des industriels, au sein d’un nouveau service, le SERAC (service commun de ressources analytiques et de caractérisation). Il s’agit du centre de microscopie électronique, du centre de spectrométrie et du laboratoire de chimie des eaux (LCE). La direction est confiée à Éric Cavalli et le SERAC intègre les locaux à TEMIS sciences[6], auprès de la direction de la valorisation. L’objectif est d’y transférer du matériel de très haute technologie et des services qui peuvent ainsi être proposés aux laboratoires et aux entreprises. Le CME y déménage en mars 2007, bénéficiant de l’achat d’un microscope à balayage électronique, qui complète l’offre technique d’imagerie microscopique dans le domaine des matériaux. Il y reste jusqu’à la dissolution du SERAC, en septembre 2012. Nicolas Rouge et le matériel de microscopie rejoignent alors la plateforme de chimie au sein de l’institut UTINAM, au 1er janvier 2013, où ils se trouvent toujours en 2024.