Dès les années 1970, les unités d’enseignement et de recherche (UER) développent des protocoles avec leurs homologues des universités étrangères, fruits de plusieurs années de démarches bilatérales. Ces accords renforcent la coopération entre les chercheurs et les enseignants dans diverses disciplines et promeuvent les échanges d’étudiants et de personnels, dans tous les domaines de la vie académique.
Les premiers jumelages historiques marquent l’officialisation de relations internationales. En janvier 1974, Marita Gilli, dynamique responsable de la section d’allemand de l’UER lettres, lance un jumelage avec l’université Greifswald (RDA), signé par le président Jean Thiébaut. Il fait de Besançon l’une des premières universités françaises à procéder à des échanges scientifiques et culturels avec une université située en Allemagne de l’Est.
Le 14 décembre 1977, Jean-Marie Kauffmann, directeur de l’IUT de Belfort, signe un accord de coopération avec le recteur Reinhold Glatz de la Fachhochschule de Karlsruhe, s’appuyant sur une décennie d’amitié et de collaborations concrètes. Depuis 1973, chaque année, une quinzaine d’étudiants français et -allemands alternent leur cursus à Belfort et à Karlsruhe. Les échanges se poursuivent parfois sous la forme originale de tournois sportifs amicaux, comme celui du 7 mai 1978, qui réunit les enseignants de ces deux établissements. D’autres naissent à l’initiative des échanges étudiants comme c’est le cas, à la même période, à l’IUT de Besançon. Un étudiant en publicité-marketing du département carrières de l’information s’est rendu à ce titre à l‘université d’Huddersfield (GRU) et son stage a rencontré un tel succès que, les années suivantes, l’université anglaise invite d’autres stagiaires bisontins. C’est ainsi que naît et perdure un accord international nourri entre les deux établissements.
Avec la Suisse voisine, Pierre Lévêque et Jean-Blaise Grize, recteur de l’université de Neuchâtel, contractualisent un partenariat le 12 novembre 1977.
Ces premiers accords se complètent par de nombreux autres, dans les différents continents. Des bourses sont attribuées aux étudiants français candidats à des études à l’étranger. En octobre 1977, des étudiants de géographie effectuent un voyage d’études de trois semaines au Québec avec leurs professeurs.
Dans les années 1970, ce sont le Centre de linguistique appliquée (CLA) et l’UER lettres et sciences humaines qui contribuent principalement à l’accueil des étudiants internationaux. L’enseignement du français appliqué, qui y est délivré, favorise ensuite leur intégration dans les autres UER, participant ainsi à l’attractivité de l’ensemble de l’établissement. Patrick Lehmann, assistant d’anglais à la section d’anglais, est chargé de l’accueil des étudiants étrangers boursiers du gouvernement français. En mai 1976, il propose des possibilités de contacts universitaires avec le monde anglophone, en Australie, par l’intermédiaire de sa collègue Marylin Gill, elle-même australienne.
Très soucieux d’ouvrir l’établissement dans son ensemble à la dimension internationale, P. Lehmann réalise en janvier 1979 une étude sur les étudiants étrangers de l’université. Il s’appuie sur les données statistiques des inscriptions des années précédentes dans les différentes UER, complétées par des entretiens avec les enseignants et les étudiants concernés. Il en ressort que l’université de Besançon est classée sixième en France pour la proportion d’étudiants étrangers accueillis. Cette enquête souligne la complexité du parcours d’un étudiant étranger qui souhaite poursuivre son cursus en France. Il rencontre maints obstacles administratifs lors de la préinscription depuis son pays, puis pour l’octroi du visa. Arrivé en France, s’y ajoutent ceux de l’obtention des bourses ou d’un logement et, plus encore, la difficulté d’intégrer la méthodologie des cours universitaires français.
À l’issue de cette étude qui conforte la nécessité d’une véritable politique d’information universitaire internationale, P. Lehmann est officiellement chargé, le 1er janvier 1980, d’animer et de coordonner la nouvelle cellule des relations internationales. Soutenu par une subvention ministérielle et créé par le conseil de l’université, ce nouveau service est placé sous l’autorité directe du président de l’université, P. Lévêque. Sa première feuille de route est de susciter le développement de la coopération institutionnelle. À cette fin, diverses actions sont programmées au sein de l’UFC : bien informer la communauté sur les accords déjà existants, organiser l’accueil d’enseignants-chercheurs étrangers, former les collègues-ambassadeurs de l’établissement partant en mission à l’étranger. Des correspondants, relais pour les relations internationales, sont identifiés dans toutes les composantes. P. Lehmann procède également à un examen systématique des possibilités d’accords existants dans ces dernières pour augmenter les échanges institutionnalisés. C’est le cas d’Henry Mérigoux, cristallographe à l’UER ST, très actif dans le domaine des échanges avec les universités des États-Unis, qui met en place[JPB1] , quelques années plus tard, un accord d’échange avec la prestigieuse Georgetown University.
Le décret du 31 décembre 1979 modifie profondément les dispositions relatives à la préinscription des étudiants étrangers. Désormais, une commission nationale créée à cette fin répartit entre les universités françaises, après les avoir examinés, les dossiers de candidatures jugés recevables , et ce en fonction des possibilités d’accueil de chacune. Il appartient donc à chaque établissement de faire connaître ses propres possibilités en la matière, tant pour l’accueil matériel (restauration et hébergement en cités universitaires ou en ville) que pour l’accueil pédagogique. À l’échelle nationale, le service universitaire des étudiants étrangers (SUEE) veille à transmettre ces informations auprès des services de scolarité. Ces nouveaux textes réglementaires sur l’inscription des étudiants étrangers et leurs modalités d’applications fâchent les présidents d’université qui y voient un empiétement de l’État sur leur autonomie et qui contredit la large politique d’accueil culturel que la France a toujours menée. La conférence des présidents d’université (CPU) émet une déclaration le 16 mai 1980, qui réaffirme son attachement au principe de l’autonomie pédagogique (demande volontaire d’inscription auprès d’une seule université et centralisation seulement en cas de refus de l’université).
Sous l’impulsion de P. Lehmann, qui bénéficie de la confiance des présidents successifs, puis du nouveau secrétaire général, Michel Roignot, en 1986, le service poursuit son développement et s’étoffe. Il prend le nom de direction des relations internationales (DRI) et intègre, en septembre 1993, les locaux rénovés de la nouvelle présidence de l’université à Goudimel.
En 1990-1991, l’université de Franche-Comté est classée au 18e rang français pour ses échanges de 80 étudiants dans la CEE. En 1993, deux premières thèses de doctorat en science[1] obtiennent le label des thèses européennes. L’université de Franche-Comté est ainsi l’une des toutes premières universités françaises à le décerner. De même, des enseignants étrangers sont régulièrement invités pour exercer et professer leur discipline pendant quelques mois. En 1992, l’UFC comptabilise plus de 50 accords internationaux.
Dans les années 2000, un projet d’espace européen de l’enseignement supérieur se construit, soutenu par Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale, et par ses homologues européens. Il est né d’une succession de rencontres, lancées par Claude Allègre, le précédent ministre. Ces rencontres ont abouti à la déclaration de la Sorbonne, en juillet 1998, puis à celle de Bologne en juin 1999 et à celle de Prague en juin 2001. Différents programmes de mobilité, offrant des bourses d’études, de recherche, d’échanges ou de coopération, se succèdent : Comett, Face, Lingua, Tempus, Cime, Socrates (pour l’enseignement), Leonardo (formation professionnelle), ISEP, Kansas, Crepuq, Outaouais, mais le plus prisé demeure Erasmus. Ce dernier permet de passer un ou deux semestres dans une université européenne, tout en restant inscrit en France.
À partir de 2004, dans le cadre du processus d’harmonisation européenne de l’enseignement supérieur, l’Université est, en effet, engagée dans la préparation du LMD : licence-master-doctorat. Le système français s’adapte au niveau européen (3,5,8) en appliquant le système d’ECTS (European credit transfer system) à l’ensemble des diplômes proposés à l’UFC. Ces nouveaux dispositifs permettent d’accroître la mobilité des étudiants européens, renouant ainsi avec le modèle de la pérégrination en Europe des étudiants du Moyen Âge[2].
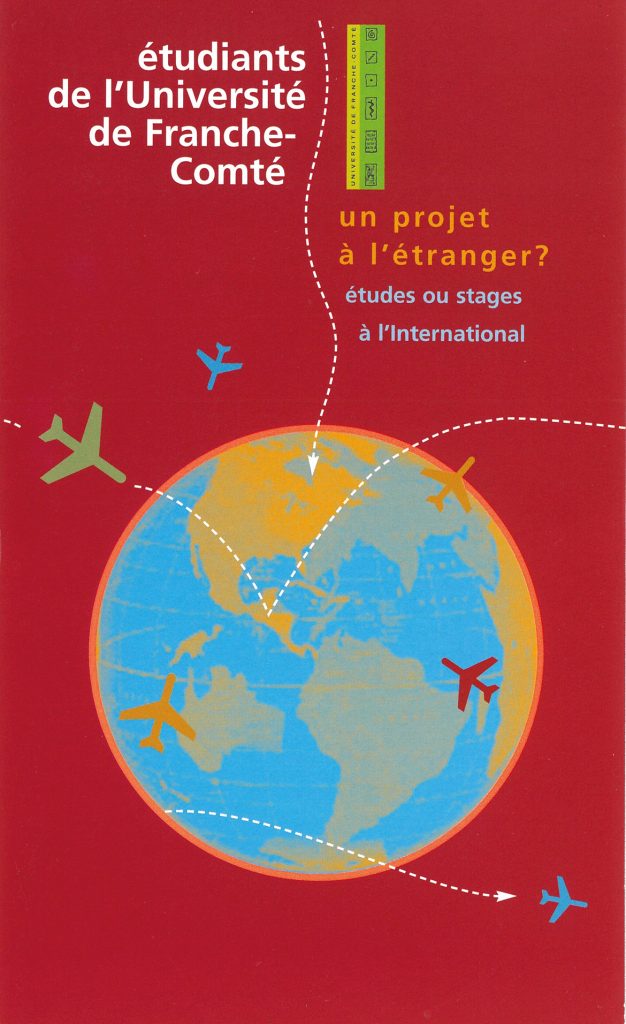
Apportant une reconnaissance européenne aux diplômes, ils encouragent également les partenariats et les accords avec d’autres universités européennes, pour les formations comme pour la recherche.
Pour la mobilité entrante, les programmes d’échanges (Erasmus, ISEP ou autres) permettent aux étudiants d’obtenir des bourses de mobilité dans leur pays d’origine et l’assurance d’un encadrement et d’un suivi dans le pays d’accueil. Cette mission est assurée par la direction des relations internationales. Pour la mobilité sortante, le conseil régional de Franche-Comté apporte un important soutien logistique et financier aux étudiants en échanges internationaux : 600 étudiants de Franche-Comté en bénéficient chaque année.
En juin 2006, sur les 20 253 étudiants inscrits à l’université de Franche-Comté, 3 037 sont de nationalité étrangère, dont 1 000 suivent un enseignement à distance. 124 nationalités sont représentées. Il faut ajouter les 3 000 stagiaires internationaux qui passent quelques semaines, quelques mois ou une année au Centre de linguistique appliquée (CLA), pour y apprendre le français langue étrangère.
En collaboration avec la direction de la communication et le SCUIO, la direction des relations internationales publie un certain nombre de guides d’accueil pour les étudiants qui souhaitentune mobilité ou en mobilité, tel le guide « Venir étudier en France, à l’université de Franche-Comté », paru en 2006.
En 2006, Claude Condé débute son mandat et veut donner une forte impulsion aux relations internationales de l’UFC.
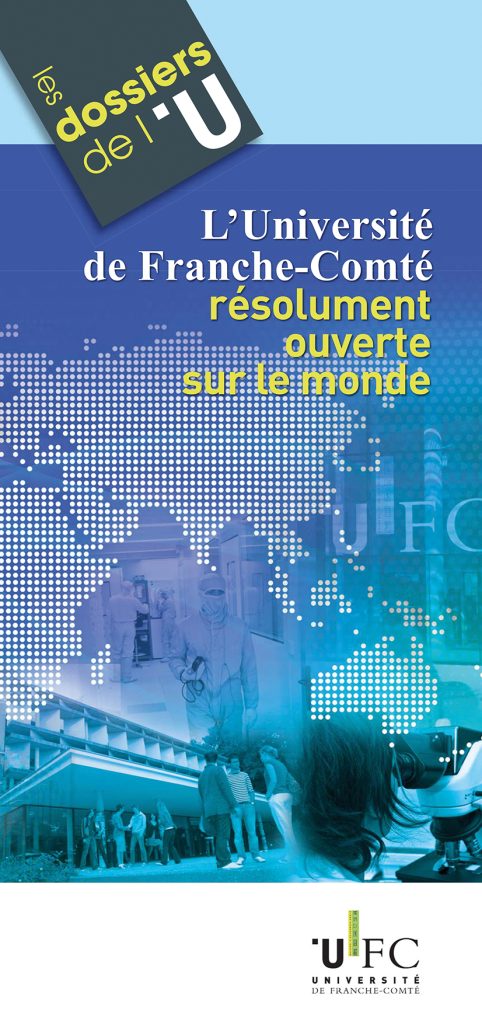
Le président crée une commission consultative pour le développement des relations internationales et la coopération (CODRIC)[3] et souhaite que les relations internationales de l’UFC s’ouvrent à la francophonie. La DRI prend alors le nom de délégation générale aux relations internationales et à la francophonie (DGRIF).
Pour marquer cet élan, Cl. Condé nomme Jean-Marie Bague chargé de mission français langue étrangère et, en 2007-2008, confie à Serge Borg, directeur du CLA, une seconde responsabilité de délégué général aux relations internationales et à la francophonie[4]. En 2008, Rudy Chaulet, enseignant à l’UFR SLHS, prend la direction de la DGRIF. Pour souligner l’importance de sa mission, le président le nomme aussi vice-président délégué aux relations internationales et à la francophonie. Ensemble, ils encouragent les échanges universitaires, avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes de langue française, espagnole ou portugaise. En lien étroit avec le réseau diplomatique et Campus France, ils lancent le programme d’échange « Les bourses d’excellence Victor Hugo », baptisé du nom de cette grande figure de la littérature née à Besançon et très célèbre en Amérique du Sud. Ces bourses[5] sont destinées aux étudiants de master et de doctorat du continent latino-américain, toutes filières confondues, et sont attribuées selon des critères d’excellence académique. Pendant une année à l’UFC, elles offrent aux étudiantes et étudiants sélectionnés la prise en charge des frais d’inscription et de séjour. Ce dernier inclut deux mois de formation préalable en français au CLA. Entre 2011 et 2020, 141 bourses sont attribuées par l’UFC, la région BFC et la Vvlle de Besançon, pour 3 084 candidatures reçues.
Le programme Erasmus 2007-2013 élargit le dispositif aux stages en entreprises, d’une durée de trois à neuf mois[6]. L’université de Franche-Comté signe cette charte. Les enseignants, ainsi que les personnels administratifs et techniques intéressés peuvent, eux-aussi, être concernés par une mobilité dans le cadre d’un échange lors d’un accord bilatéral entre établissements.
En juillet 2008, la DGRIF déménage et gagne, pour quelques années, les locaux du CLA, rue Plançon. L’objectif est de renforcer la coopération entre ces deux directions de l’UFC dont les missions ont un objectif international. Cependant, en 2011, trop à l’étroit dans les bureaux du 6e étage du CLA (qui lui-même manque de salles de cours), la DGRIF déménage dans le bâtiment Q à l’Arsenal, site récemment libéré par le départ de l’UFR sciences médicales et pharmaceutiques et principalement investi par l’UFR SLHS[7].
En 2011, alors que la France préside pour une année les sommets des chefs d’État et de gouvernement (G8-G20)[8], la Conférence des présidents d’universités françaises (CPU) organise, en miroir, le Sommet mondial des universités, Global University Summit.
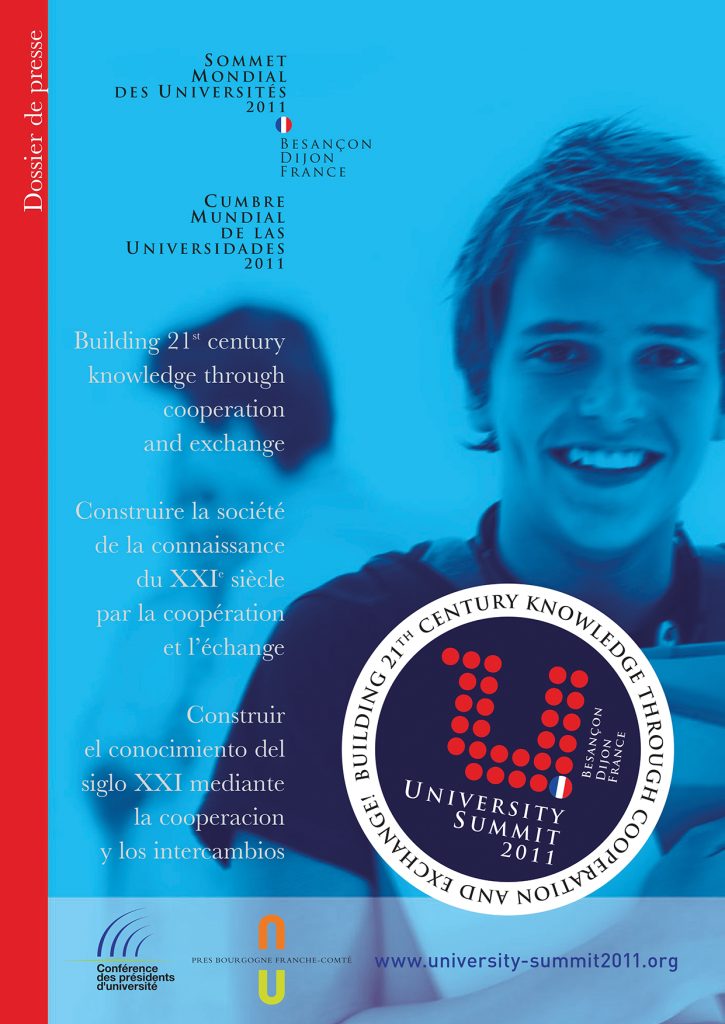
Ces rencontres internationales d’étudiants et de présidents d’université portent sur le thème « Développement durable et société de la connaissance ». Elles rassemblent des responsables politiques au plus haut niveau, venus des pays du G20 et de tous les continents. Conformément à la volonté de la CPU d’ouvrir le débat, des représentants d’Afrique subsaharienne, d’Amérique latine et de pays européens non-membres du G8-G20 sont pour la première fois invités. L’université de Franche-Comté, au nom du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Bourgogne Franche-Comté, accueille à Besançon la partie étudiante de ce sommet mondial des universités. Durant trois journées, les 28, 29 et 30 avril, une cinquantaine d’étudiants de 25 nationalités différentes travaillent en atelier à la rédaction d’une déclaration finale qui rappelle le caractère universel et humaniste des connaissances universitaires, considéré comme un capital mondial. Ce message est transmis, le 10 juin suivant, à la conférence internationale des présidents d’université et des recteurs, puis au sommet des chefs d’État, lors du G8-G20 à Cannes.
À partir de 2012, début du mandat de Jacques Bahi[9], le service s’intitule direction des relations internationales et de la francophonie (DRIF). La stratégie des relations internationales de l’UFC se décline alors de manière différenciée selon une typologie des pays : une politique de développement et de coopération avec des pays à fort potentiel en Asie-Océanie, une politique de renforcement en Amérique du Nord et en Europe, une politique de coopération solidaire en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Le dernier axe concerne une politique d’affirmation sur des thèmes spécifiques, comme le français langue étrangère (FLE), valorisant l’expertise du CLA, ou les sciences, par exemple. Dans ce cadre, en complément du dispositif des bourses d’excellence Victor Hugo, l’UFC participe au programme brésilien de bourses d’excellence « sciences sans frontières » (créé en 2012), suivi d’un second volet « langues sans frontières » (2015-2020). L’ensemble des étudiants accueillis bénéficient d’une formation en FLE (français langue étrangère) à leur arrivée.
En Europe, la présence de l’UFC est largement structurée par le programme Erasmus+ et par les 240 accords interuniversitaires signés entre 2012 et 2018. Le partenariat franco-suisse est conforté (notamment avec SMYLE ou la Communauté du savoir)[10].
Au-delà de l’espace francophone, l’internationalisation de l’université nécessite le développement de formations en langue anglaise. Des co-diplomations s’établissent avec des universités internationales comme l’université Santo Tomas en Colombie (STAPS) ou avec la Bergische Universität Wuppertal en Allemagne (SLHS). En 2019, plus de 500 accords européens et internationaux bilatéraux sont actifs. Dans cet objectif de rayonnement, 14 des 23 masters internationaux (ISITE et écoles universitaires de recherche) portés par UBFC (université Bourgogne Franche-Comté), sont pilotés par l’UFC.
Dès le début de son mandat, J. Bahi affiche la qualité d’accueil comme objectif stratégique. L’université obtient le label HRS4R en 2016 et le label Bienvenue en France, en 2019.
DRI et DRIF (1980-2020)
Directeurs :
Patrick Lehmann (1980 -2006) ; Serge Borg (2007-2008) ; Rudy Chaulet (2008-2012) ; Margareta Kastberg (2012-2013) ; Anne-Emmanuelle Grossi (2014 -2017) ; Antoine Guillemet ( mars 2018 – 2020).
Vice-présidence déléguée :
Rudy Chaulet (2008-2012) ; Margareta Kastberg (2012-2014) ; Anne-Emmanuelle Grossi (2014 -2017)
Responsables administratifs :
Denis Linglois ; Gracian Didier (1996) ; Réjane Hoeuillard (2002-2006) ; Gracian Didier (2007-2008) ; Claire Giboudeaux-Baumes (sept.-nov. 2008) ; Sandrine Gruz, intérim (déc. 2008 à août 2009) ; Cédric Castor (depuis sept. 2009).