Si, dès 1967, un an avant la réforme d’Edgar Faure du 12 novembre 1968, les diplômes universitaires de technologie (DUT) constituent un jalon important pour la formation professionnelle dans l’enseignement supérieur, en complément des écoles d’ingénieurs, cette même volonté est poursuivie par les ministres successifs.
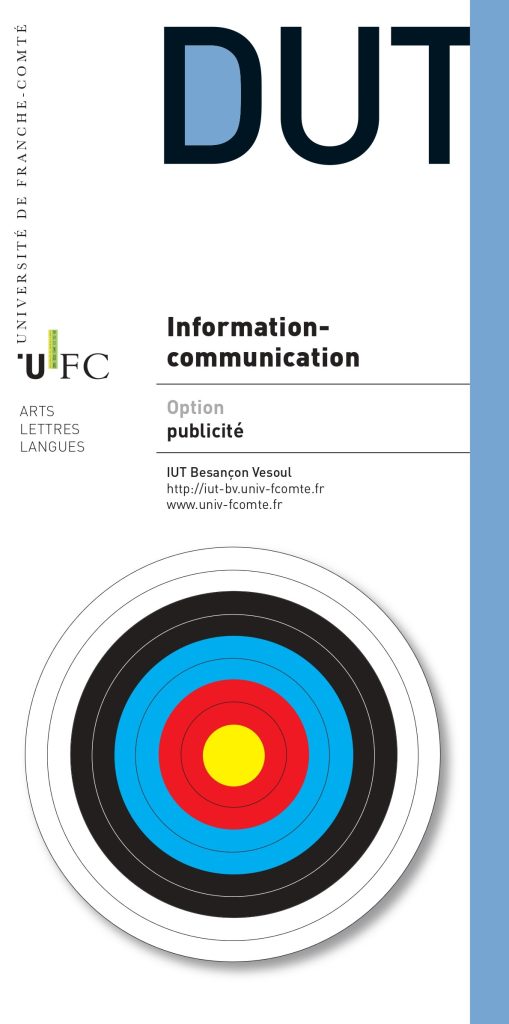
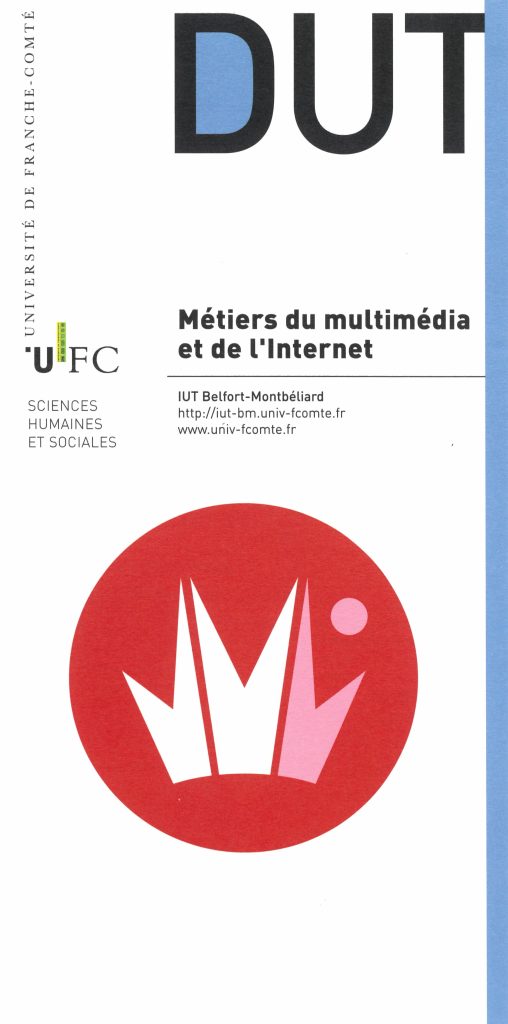
Catherine Bouteiller.
Très tôt, la carte des formations marque une avancée décisive de l’université dans la voie de la professionnalisation, avec des filières sélectives, se distinguant ainsi des cursus classiques des précédentes facultés.
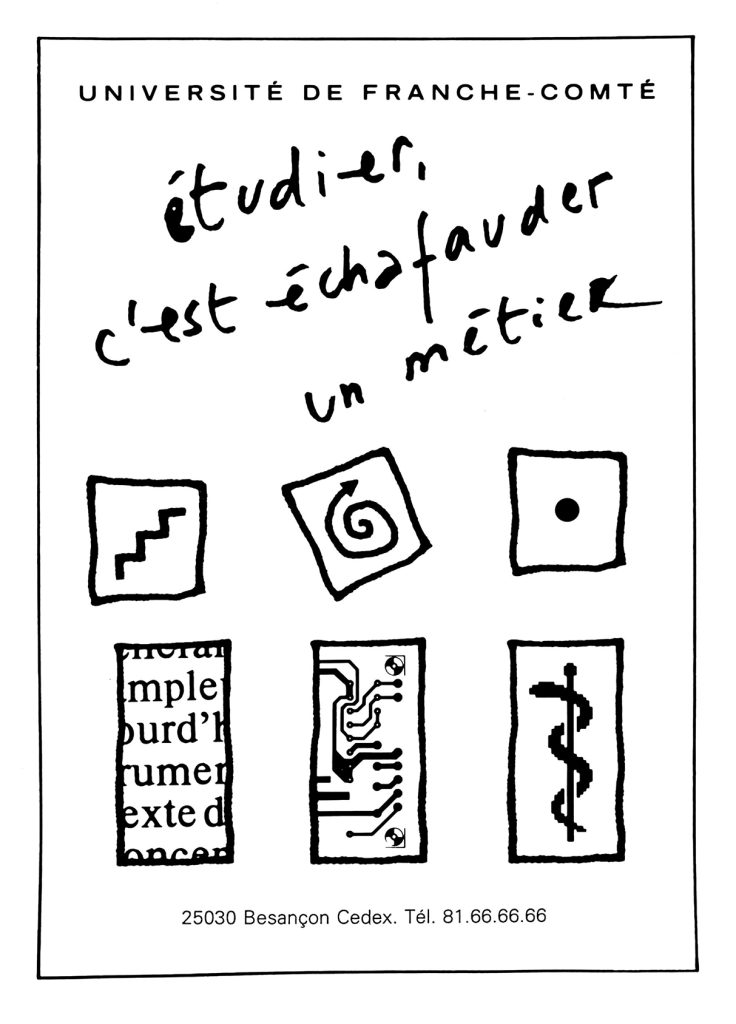
Catherine Zask, ADAGP, Paris, 2025.
En 1971, est créée la MST, maîtrise des sciences et techniques, qui sanctionne des formations portant sur l’étude des connaissances scientifiques et des processus techniques relevant de la production et de la distribution des biens et services. Élu en 1980, le président Jacques Robert déclare dans un reportage vidéo de la télévision régionale[1] que « l’université a la volonté d’offrir à ses étudiants un socle de connaissances solides, mais également un débouché. C’est pour cela que les MST sont mises en place, en plus des enseignements généraux ». Sa stratégie est la suivante : commencer à remplacer des filières traditionnelles par des filières professionnelles. Ainsi naît une MST électrotechnique, qui ouvre avec 38 étudiants, en remplacement de la licence de physique, et dont l’enseignement renouvelé est tourné vers l’informatique et la robotique. Cette formation est destinée à répondre aux besoins de l’industrie des microtechniques qui se reconvertit. La présidence valide également la création d’une MST électrochimie appliquée, centrée sur la protection des surfaces. À l’UER de droit et sciences économiques naît une MST comptabilité et finances, soutenue par l’ordre des experts-comptables. L’UER des lettres, dotée d’une maîtrise en LEA (langues étrangères appliquées), bilingue, mention affaires et commerce, n’est pas oubliée. Par convention avec la chambre de commerce bisontine, ces étudiants devraient apporter des ressources humaines aux métiers du tourisme, de l’exportation et de la traduction. L’ouverture de MST continue lors des mandats suivants. À la rentrée 1993, sous celui de Michel Woronoff, l’université de Franche-Comté crée la MST arts et techniques industrielles du bois et de l’ameublement (ATIBA), portée par François Lhôte à l’UFR sciences et techniques. L’objectif est de former, en deux ans, des cadres techniques (niveau bac +4), spécialistes de l’ingénierie des produits terminaux de la filière bois (meubles, jouets, maisons bois…), capables de couvrir toutes les fonctions, du marketing à la préparation de la fabrication. La MSG est la maîtrise équivalente en sciences de gestion. Ces formations ne survivront pas au passage au système du LMD.
Dès 1971 également, l’université délivre des certifications ou des diplômes d’études, formations courtes destinées à approfondir une spécialité, et qui sont ouverts, tant en interne aux étudiants en formation initiale qu’en externe, en formation continue, pour l’acquisition de compétences complémentaires. À titre d’exemple, il existe, sous le mandat de Jean Thiébaut : en 1971, un diplôme d’études urbaines de l’université ; en 1972, un diplôme de professeur de français à l’étranger ; en 1973, un certificat d’études universitaires des sciences et techniques de l’environnement ou encore en 1974, un diplôme d’université de conseiller familial. À la rentrée 1992, l’antenne de l’IUT de Vesoul délivre un diplôme d’université maintenance industrielle en plasturgie, piloté par Gilbert Grangeot. Cette année post-DUT (ou post-BTS, brevet de technicien supérieur délivré dans les lycées) fait suite à la demande de la chambre industrielle des plastiques d’Oyonnax pour répondre à un manque de personnel qualifié. En 1994, la faculté de médecine délivre un certificat de capacité d’orthophonie, porté par Jean-Claude Lafon.
Le DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) admet des bacheliers désireux de suivre des études courtes à l’université. Délivré par les UFR, il offre une alternative au DEUG ou au DUT et permet, tout comme ce dernier, de s’insérer rapidement dans le marché de l’emploi. Une poursuite d’études en licence professionnelle est également possible, sous réserve d’une même spécialité. De niveau Bac +2, le DEUST survit cependant au LMD et est validé par 120 crédits ECTS (European Credits Transfer System), capitalisables (définitivement acquis quelle que soit la durée du parcours), ce qui autorise une interruption puis une reprise des études.
Voici quelques exemples : en 1993, l’UFR sciences et techniques propose le DEUST PAI, préparation aux activités industrielles. En 1994, l’UFR sciences médicales et pharmaceutiques ouvre, sous le format de l’alternance, le DEUST gestion de production pour l’industrie pharmaceutique et la cosmétologie, avec Jean-Pierre Chaumont. Il est essentiellement destiné aux étudiants en pharmacie, éliminés dès la première année en raison du numerus clausus imposé lors du concours. Un DEUST visiteur et informateur médical s’ouvre en 2002, sous le mandat de Françoise Bévalot.
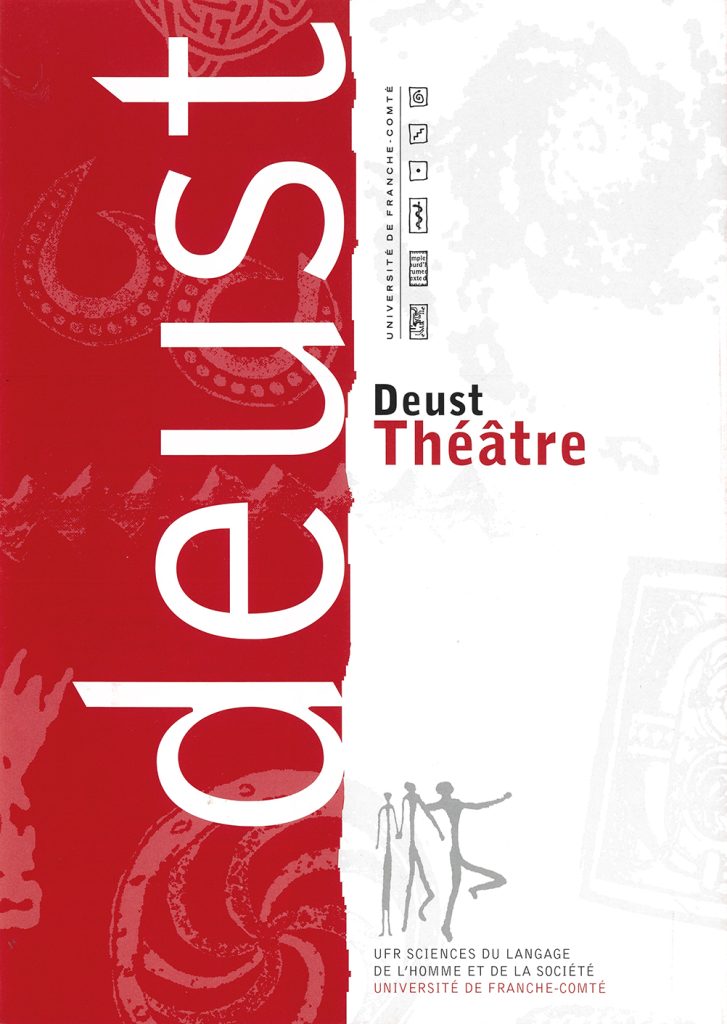
Philippe Bracco.
Créé en 1998[2] et délivré à l’UFR SLHS, le DEUST théâtre[3] est une formation intensive professionnalisante préparatoire aux grandes formations des métiers du spectacle. Cette nouvelle formation se pose en alternative, immédiatement professionnalisante, au DEUG théâtre délivré dans la même composante qui, lui, suppose une poursuite en licence. L’UFR STAPS propose, en 2002, un DEUST encadrement et gestion des pratiques sportives et, en 2018, un DEUST animation gestion des activités physiques et sportives et culturelles, dispensé à Montbéliard.
De nouvelles formations innovantes, en rapport avec la recherche et l’industrie viennent compléter la carte des formations, marquant une avancée décisive de l’université dans la voie de leur professionnalisation. Les IUP, instituts universitaires professionnalisants, et les CMI, cursus de masters en ingénierie en sont deux exemples.
En 1991, les IUP[4] sont créés par le ministre de l’Éducation nationale Claude Allègre, sur proposition d’un groupe de travail animé par la rectrice Nicole Belloubet et par le directeur des enseignements supérieurs, Daniel Bloch[5]. Cette nouvelle formation peut être considérée comme la réponse de l’université au cursus des écoles d’enseignement supérieur technique que sont les écoles d’ingénieurs et les écoles de commerce afin d’améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’université. Cette formation, à caractère technologique, est organisée en milieu professionnel avec de nombreux stages, pour un tiers de sa durée. En complément, des cours sur le management et la gestion sont assurés par des acteurs du monde du travail. Comptant trois années, elle est accessible au niveau bac +1 et délivre ensuite, à chaque étape, un diplôme : le DEUP, diplôme d’études universitaires professionnalisées (au niveau du DEUG), la licence, puis la maîtrise. Ces études, exigeantes, comportent un volume horaire important car leur programme est calqué sur celui de la licence générale, mais avec des matières en supplément, à finalité professionnelle. À l’issue du cursus, les étudiants se voient décerner le titre d’ingénieur maître[6].
La création de ces instituts, écoles internes à l’université, contrarie les directeurs d’IUT qui voient les UFR empiéter sur leurs prérogatives en dispensant un enseignement technologique et professionnalisant[7]. Si la similitude des deux sigles IUT et IUP prête à confusion, les diplômes délivrés sont différents : bac +2 pour le premier, bac +4 pour le second. Mais les modalités de la nouvelle formation sont très proches du modèle des IUT, qui fonctionne très bien depuis vingt-cinq ans : sélection, stages, pédagogie pratique et encadrement serré des élèves. Bien que les étudiants ciblés soient ceux des premières années de DEUG, les directeurs d’IUT, avec qui leur ministère de tutelle ne s’est pas concerté, se demandent si les IUP ne vont pas vider les DUT du vivier de leurs meilleurs étudiants de première année. En 1993, Serge Goursaud, président de l’assemblée des directeurs d’IUT, y voit une vive concurrence potentielle : « Si les IUP connaissent une croissance forte, comme le prévoit le ministère de l’Éducation nationale, que deviendront les IUT ? ». Aussi envisage-t-il « une filière unique, avec des sorties possibles à bac +2, 3 et 4, [qui] faciliterait l’adaptation du système de formation à l’économie et permettrait une meilleure lisibilité de l’offre de formation ». En 1995, un diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) est bien créé, sanctionnant pour les DUT et les BTS une année de formation post-bac +3, qui évoluera, le plus souvent, par la suite en licence professionnelle. Ainsi, en 1995, un nouveau diplôme d’université à bac +3, post DUT, ouvre à l’antenne de Vesoul pour former des technologues de l’environnement, grâce à Gilbert Grangeot. La même année et au même endroit, toujours pour répondre aux demandes des entreprises locales, ce sont deux nouvelles formations de niveau bac +4, portées par Bernard Belorgey et Christian Myotte-Duquet, qui ouvrent au sein du département GEA (gestion des entreprises et des administrations) : le diplôme universitaire de finance et de comptabilité supérieur (DUFCS) et le diplôme universitaire de technologie approfondie de management européen (DUTA management européen).
Ainsi, implantés au sein même des universités, les IUP sont, soit des créations ex-nihilo, soit issues de transformations des filières universitaires classiques. Très rapidement, leurs formations rencontrent un grand succès, auprès des étudiants comme des entreprises. Pratiquant une pédagogie caractérisée par l’alternance, par la présence d’enseignants issus de la profession,par la forte adéquation entre formation et métiers, intégrant la pratique novatrice de deux langues étrangères obligatoires, elles réussissent l’’insertion professionnelle de leurs diplômés.
Le premier IUP est créé à l’UFR sciences et techniques à la rentrée 1992. Intitulé ingénierie et qualité, porté par Bernard Froment, il est l’unique IUP en France à avoir choisi cette orientation. Il est ouvert aux étudiants de la filière génie mécanique. La troisième année permet une spécialisation suivant trois options : conception de produits, exploitation des systèmes de production et leur automatisation ou encore maîtrise de la qualité. La formation théorique est complétée par un stage ouvrier en 1re année, un projet professionnel en 2e année et un stage d’application en 3e année. La première promotion compte déjà une centaine d’étudiants.
Dans le cahier des charges des IUP figurait la nécessité que des professionnels y donnent des cours ; dès lors, les enseignements s’appuient essentiellement sur les professeurs associés en service temporaire (PAST)[8]. Toutefois, ce qui a fait leur force devient une faiblesse à plus long terme : on reproche à cette formation universitaire le manque d’enseignants-chercheurs, phénomène qui s’accentue avec l’arrivée des normes SYMPA dans le calcul des dotations, dont l’attribution valorise les enseignants-chercheurs publiants. Ce manque de reconnaissance entraîne la fermeture de nombreux IUP.
Pour d’autres, un schéma différent se dessine alors : nombre d’entre eux évoluent en DESS, (diplôme d’études supérieures spécialisées), plus tard master, qui les mène ainsi à bac +5. C’est le cas de l’IUP SAPIAA (systèmes automatisés de production en industrie agroalimentaire), créé en 1997 par Bernard Froment et Alain Chevillard., Dix ans plus tard, il devient un master porté par Laurence Ricq. L’idée était d’imaginer une formation regroupant sciences pour l’ingénieur et sciences des aliments, afin de permettre une optimisation des moyens de production des industries agroalimentaires en proposant au secteur industriel des diplômés au profil différent. Afin de transmettre les compétences en agroalimentaire, SAPIAA est d’emblée associé par convention avec les deux écoles d’industries laitières (ENIL) de Mamirolle et de Poligny, dont sont issus la moitié des professeurs intervenant dans la formation. Celle-ci s’est ouverte à l’apprentissage, à partir de 1997, une première en France pour une formation de niveau bac +4. Le cursus s’est transformé en master en 2007, toujours délivré à l’UFR ST, avec un excellent taux d’insertion professionnelle.
Une autre forme d’enseignement supérieur technique et professionnel est dispensée dans les écoles d’ingénieurs. Deux écoles d’ingénieurs délivrent, tour à tour, des formations à l’université. Dès 1961, la première est l’ENSCMB (École nationale supérieure de chronométrie et micromécanique de Besançon) qui devient une école nationale supérieure d’ingénieurs (ENSI) l’année suivante. En 1969, elle se transforme en UER, érigée en EPSC, rattachée à l’université de Besançon[9], avec cette année-là une promotion d’une quarantaine d’ingénieurs. En 1980, elle prend le nom d’École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM). L’école devient un établissement public à caractère administratif mais reste toujours rattachée à l’université. C’est en 2018 qu’elle accède à part entière au rang d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Dès la rentrée 2001, un projet préparé sous le mandat de Claude Oytana aboutit sous celui de Françoise Bévalot. L’université de Franche-Comté créée son propre institut d’ingénieurs, l’ISIFC (Institut supérieur d’ingénieurs de Franche-Comté), spécialisé dans le génie biomédical, sous la responsabilité de Daniel Hauden et de Philippe Picart. Installé initialement à l’UFR sciences et techniques, il répond à des besoins industriels dans le domaine de l’instrumentation et des techniques biomédicales et en rapport notamment avec l’institut FEMTO-ST, un pôle de recherche internationalement reconnu. L’ISIFC recouvre une double compétence, d’une part en sciences biologiques et médicales, et d’autre part en sciences pour l’ingénieur. Avec sa spécialité innovante, cette école d’ingénieurs rencontre très vite un grand succès : dès 2003, ses effectifs connaissent une hausse de 23 %.
Créé par l’arrêté du 17 novembre 1999, un nouveau diplôme voit le jour : il s’agit de la licence professionnelle (LP). En offrant un débouché à bac +3, elle correspond aux objectifs européens. Cette réforme, voulue par le ministre de l’éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie Claude Allègre, résulte du rapport sur l’enseignement supérieur qu’il avait commandé à Jacques Attali[10]. Premier « diplôme de sortie », censé faire écho à des besoins en qualifications non couverts, entre le niveau technicien supérieur et le niveau d’ingénieur-cadre supérieur, la licence « pro » offrirait une rapide insertion dans le marché du travail, puisqu’elle répond à des manques et à des métiers clairement identifiés. La LP entérine le mouvement massif de poursuites d’études des titulaires de DEUG, de DUT ou de BTS. De surcroît, elle correspond à la demande des IUT d’une troisième année à l’issue du DUT. Les UFR et IUT portent la mise en place de ces nouveaux diplômes en partenariat avec des lycées professionnels, technologiques ou agricoles, mais aussi des écoles d’ingénieurs ou des écoles spécialisées.
À la rentrée 2000, 170 mentions de licences professionnelles (sur les 195 possibles) sont immédiatement mises en place dans les IUT et les UFR pour l’ensemble des académies, s’adressant aussi bien aux étudiants en formation initiale qu’aux adultes en formation continue, et prenant en compte la validation des acquis professionnels. Elles dynamisent ainsi l’alternance sur l’ensemble du premier cycle de l’enseignement supérieur. L’université de Franche-Comté a, elle aussi, saisi cette chance. Le président Claude Oytana est fier de présenter lors d’une conférence de presse, le 19 juin 2000, la nouvelle carte des formations, avec à ses côtés la rectrice Aleth Manin et les vice-présidents de l’UFC. Il annonce, en plus de la consolidation de l’offre existante, la création de 45 formations, dont quatre licences professionnelles. Trois d’entre elles ouvrent à la rentrée suivante : sciences de la production industrielle ; sport et intégration sociale ; métiers de l’exposition et technologie de l’information.
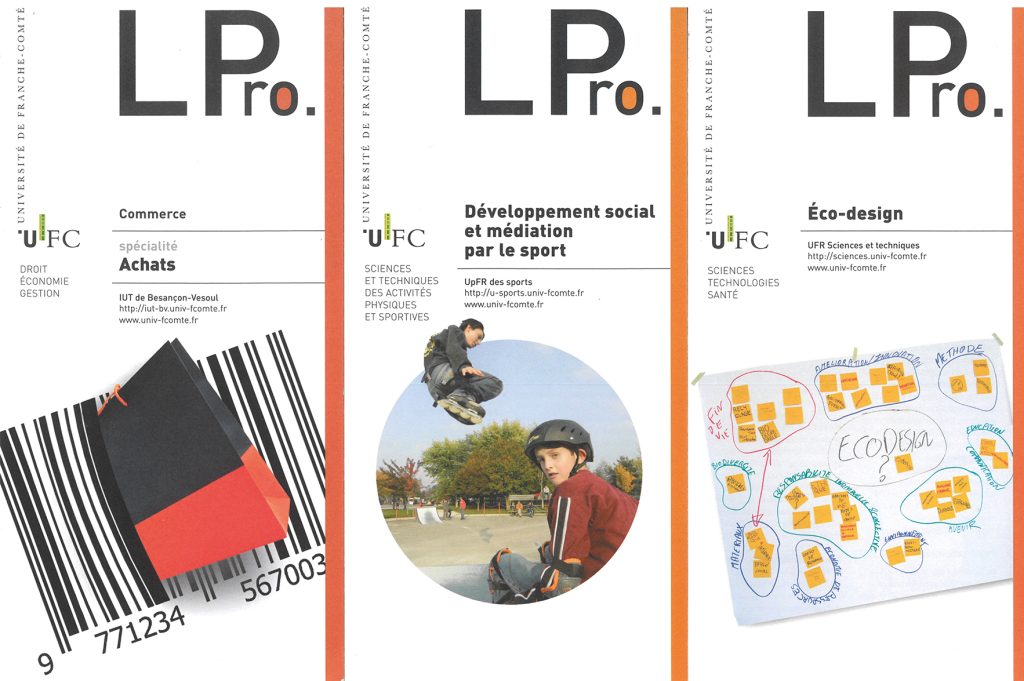
Catherine Bouteiller.
Certaines s’intègrent dans un continuum avec des MST. C’est, par exemple, le cas de la licence professionnelle bois et ameublement, techniques et management dans les industries du bois, qui s’insère dans le pôle bois constitué avec la MST ATIBA, citée précédemment. La région Franche-Comté accrédite son passage en alternance en 2006, date à laquelle elle peut ainsi accueillir des apprentis. D’autres vont voir le jour ultérieurement, avec toujours de fortes caractéristiques professionnalisantes et appliquées : en 2005, sous le mandat de Françoise Bévalot, naît, à l’IUT de Belfort Montbéliard la licence professionnelle dosimétrie et radioprotection médicale.
La rentrée 2006 chamboule les 320 IUP existants en France. L’arrivée du système LMD (licence, master, doctorat) est désormais normée sur les cycles de 3, 5 et 8 années d’études, mettant les IUP, qui se situent à 2, 3 et 4 années (DEUP, licence, maîtrise), en porte-à-faux. Jean-Marc Monteil, directeur général de l’Enseignement supérieur, finit par autoriser les IUP à délivrer des masters professionnels[11].
Depuis la fin des années 1990, une nouvelle formation de 3e cycle, intitulée diplôme de recherche technologique (DRT)[12], avait vu le jour, offrant une possibilité d’aboutissement de la filière technologique aux ingénieurs maîtres, diplômés des IUP, désireux d’orienter leur future carrière vers le secteur recherche et développement. Cette alternative intéressante, d’une durée de 18 mois, se répartit en six mois de recherche et douze mois en milieu professionnel (fonctionnant à la fin sous contrat d’alternance). Le DRT sanctionne des travaux de recherche technologique appliquée, visant à résoudre un problème relevant du secteur industriel ou tertiaire, en relation étroite avec une entreprise. Malgré son taux d’insertion exceptionnel, son niveau bac +6 est incompatible avec l’harmonisation européenne du LMD sous le format 3, 5 et 8 et la dernière promotion s’achève en 2009.
La voie très professionnalisante du DESS, diplôme d’études supérieures spécialisées (et appliquées), formation à bac +5, pendant du DEA (diplôme d’études approfondies) qui, lui, a pour finalité la recherche, rencontre un grand succès dès son ouverture. Ainsi, sous le mandat de Michel Woronoff, naît en 1993 le DESS cadres en relations européennes et, en 1995, le DESS génie énergétique industriel à Belfort. Sous celui de Claude Oytana, voient le jour en septembre 1998 le DESS qualité et traitements des eaux et, en septembre 2000, les DESS audit et contrôle, langues étrangères et commerces électroniques, psychologie humaine et psychopathologie, ingénierie des composants et systèmes mécaniques.
Dès 2013, l’université de Franche-Comté rejoint le réseau Figure et propose un choix de neuf CMI répartis à Besançon, Belfort et Montbéliard. En 2023, les spécialités en sont les suivantes : éditions numériques et patrimoine de l’Antiquité à nos jours (ENPAJ) ; sciences de l’information géographique pour l’innovation territoriale ; géologie appliquée ; sciences de l’information et de la communication ; ingénierie systèmes et logiciels ; ingénierie structures et systèmes intelligents (S-CUBE) ; photonique, micronanotechnologies, temps fréquence (PICS) ; ingénierie de l’environnement et des territoires ; enfin hydrogène, énergie et efficacité énergétique (H3E). À titre d’exemple, ce dernier, dispensé par l’UFR STGI à Belfort, illustre la spécificité de ces parcours professionnalisants. À sa création en 2014, H3E est la première formation sur l’hydrogène en France[13], et en 2024 encore, elle est la seule à proposer un parcours de la licence au master, dans le domaine en plein essor de la filière hydrogène. Adossé aux deux formations majeures en énergie électrique et thermique, le CMI H3E offre des enseignements supplémentaires spécialisés dans l’hydrogène, mais également des modules permettant aux étudiants d’acquérir une expertise plus globale et les compétences requises pour les métiers de l’énergie. En rapport avec deux laboratoires de l’université, Femto-ST et FCLAB, mais aussi avec des industriels du secteur (entreprises McPhy, Rougeot, Gaussin…), les étudiants sont ainsi immergés le plus possible dans le quotidien des chercheurs ou des entreprises. En 2022, le CMI H3E de l’université de Franche-Comté a reçu le prix de « la sensibilisation, de l’éducation et de la formation » lors de la 3e édition du concours Hydrogénies qui récompense, avec les trophées de l’hydrogène, une formation de pointe destinée aux étudiants intéressés par le développement de l’hydrogène et des énergies renouvelables.

Laurène Grisot.
En 2012, impulsée par Claude Condé et Françoise Coupat, vice-présidente vie étudiante,une mission très innovante, pilote à l’échelle nationale, est consacrée à la professionnalisation des formations. Mise en œuvre dans sa phase expérimentale par l’UFR SLHS, sous la supervision de son directeur André Mariage, elle se déploie à l’échelle de l’UFC sous le mandat de Jacques Bahi et le pilotage de Frédéric Muyard. Oumhanie Legeard, cheffe de projet, mobilise les équipes pédagogiques pour conduire la réécriture et la publication systématique de toutes les fiches RNCP[14] des formations portées par l’établissement. La commission nationale de la certification professionnelle reconnait la qualité de la rédaction de ces fiches de référence et procède très rapidement à leur publication afin de fournir des exemples aux établissements certificateurs en France. Le 23 janvier 2015, lors d’une journée nationale rassemblant toutes les universités, la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle(DGESIP) invite l’université de Franche-Comté à partager son expérience. Cette réflexion amène l’université à travailler sur le supplément au diplôme, afin de valoriser les compétences académiques et les expériences extracurriculaires[15] que développe l’étudiant dans le cadre de son cursus. Les conseils de perfectionnement comprenant enseignants, étudiants et professionnels sont alors instaurés. Cette démarche, unique par son ampleur, permet d’obtenir un label européen et une reconnaissance au niveau national, ainsi que celle de l’agence Erasmus +. Le 9 juillet 2015, une délégation de la DGESIP, de l’agence de mutualisation des universités (AMUE) et de l’association Cocktail[16], de la conférence des présidents d’université (CPU) et d’Erasmus + est reçue à Besançon. L’université leur présente sa démarche et les succès du dispositif, afin d’envisager son déploiement dans les autres établissements.
Dans la continuité de l’universitarisation des diplômes, une des récentes réformes concerne les IUT, pour leur permettre d’évoluer conformément au schéma du LMD, en trois cycles. L’arrêté du 6 décembre 2019 réforme, à compter de la rentrée 2021, la licence professionnelle (LP) pour créer le bachelor universitaire de technologie (BUT), licence professionnelle en trois ans, exclusivement délivrée par les instituts universitaires de technologie (IUT), pour 180 crédits européens (ECTS). Les diplômes sont définis dans l’une des 24 spécialités de DUT qui tiennent lieu de mentions. Les programmes, nationaux, comprennent deux tiers de cadrage national et un tiers d’adaptation locale. L’IUT Besançon Vesoul propose quinze parcours de BUT et l’IUT Nord Franche-Comté dix. L’intégration peut s’effectuer à différents moments grâce à des passerelles. Toutes les formations sont ouvertes à l’alternance et se structurent autour de situations professionnelles : 600 heures de projets, 22 à 26 semaines de stages et 50 % des enseignements assurés par des professionnels. De plus, grâce à l’intégration du schéma européen du LMD, les étudiants améliorent leur possible mobilité internationale.
Tout en maintenant, parfois avec bien des difficultés, des filières dites classiques ou fondamentales, les universités n’ont eu de cesse de s’ouvrir au monde économique de leur région, où elles jouent un rôle moteur dans la formation professionnelle de leur bassin d’emploi et sont nécessaires à son développement.