L’université de Franche-Comté s’est engagée dans une démarche ambitieuse d’assurance qualité et d’amélioration continue de son offre de formation, de sa recherche et de sa qualité d’accueil et de service aux étudiants, mais aussi dans des dispositifs visant les certifications ou la labellisation.
Dès les années 1990, dans le cadre de ses liens avec l’Institut de recherche et de développement de la qualité (IRDQ), l’UFC a été l’une des premières en France à créer des formations de ce type. En effet, un pôle qualité naît à l’UFR sciences et techniques (ST) pour porter des formations universitaires à la qualité. Jean Bulabois et Pierre Maillard proposent un DEUST spécialisé technicien de la qualité industrielle, puis une licence, complétée ensuite par un master qualité et management des performances.
Dans le même temps, les entreprises sont en train de modifier leur organisation qualité en la diffusant au cœur des métiers : elle n’est plus seulement perçue comme une fonction concentrée dans un service spécifique. Afin de préparer les étudiants à cette évolution, Bernard Froment porte, en 1992, la création de l’IUP ingénierie et qualité. Dans la filière mécanique, ce diplôme instaure des enseignements aux outils de la qualité, au service de la conception des produits et de leur production. De plus, il renforce aussi la filière qualité en ouvrant une option de fin de parcours, proposée en coopération avec le pôle qualité. Outre la dorsale qualité qu’il intègre, cet IUP innove en bouleversant un certain nombre d’habitudes : au début de la 3e année, un stage “long” (de quatre à six mois) plonge les étudiants dans un vécu en entreprise, en fonction de leurs options de spécialisation.
Fin 1997, le projet du pôle qualité est déposé par le service de la formation continue pour candidater au « concours Allègre »[1], lancé par le ministère pour développer la formation continue dans les universités. Le succès de l’UFC à ce concours lui permet de bénéficier d’un appui de l’État. À l’audition des présélectionnés, un des facteurs influents de la décision est sans doute que l’UFC est la seule université dont le binôme audité comprend le président et le directeur de la formation continue (Bernard Froment) afin de démontrer que la démarche n’est pas propre au service, mais bien celle de l’établissement. Ainsi, un diplôme de responsable en gestion de la qualité (bac +3) et un DESS gestion industrielle de la qualité (bac +5), dont le responsable pédagogique est Pierre Maillard[2] s’ouvrent sous forme de modules accessibles graduellement.
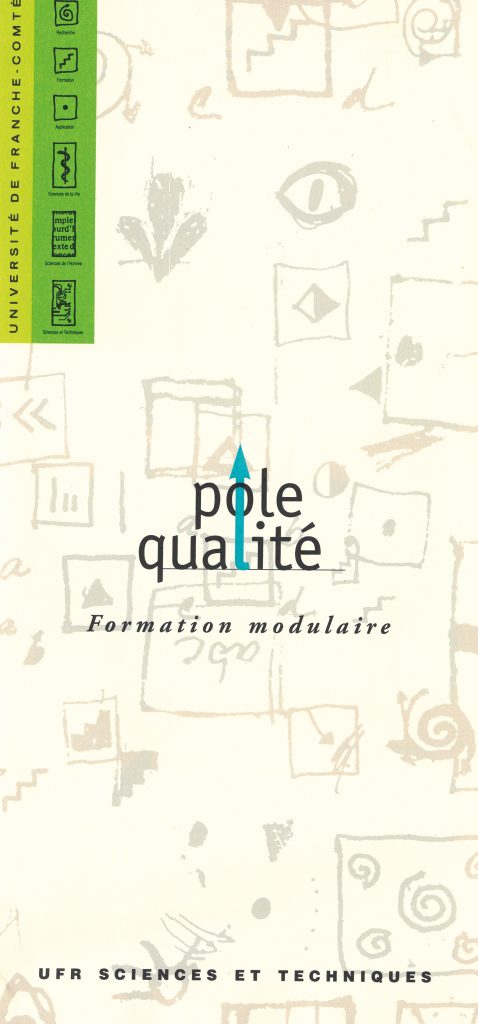
En 2014, sous le mandat de Jacques Bahi et de Frédéric Muyard, vice-président de la commission formation et vie universitaire (CFVU), l’UFC structure une démarche s’appuyant sur la « qualité des formations », qui suppose une évolution de sa pédagogie. Elle se dote alors[3] d’une charte de l’apprentissage par problème et par projet (APP) dont le déploiement est amorcé dans les CMI (cursus master en ingénierie)[4], dans le cadre d’un projet piloté par l’IDEFI Figure, porté par Lamine Boubakar, vice-président Ingénierie, liens recherche-formation-valorisation. Ce dernier développe, en collaboration avec l’université catholique de Louvain et « FA2L » (formation à l’apprentissage actif de Louvain), un référentiel d’évaluation sur mesure de la qualité des programmes de formation, qui lui est propre. L’UFC obtient ainsi l’accréditation et le label CMI, attribués par le réseau Figure® afin de reconnaître une formation au métier d’ingénieur à l’université, pour les diplômes délivrés dans les sept CMI de l’UFC.
À compter de décembre 2015, une cellule d’appui à la démarche qualité des formations, le dispositif d’appui à la qualité (DAQ), est lefruit d’une réflexion conduite, depuis l’année précédente, par les deux vice-présidents Frédéric Muyard et Lamine Boubakar. Il se déploie dans un contexte européen de l’enseignement supérieur et de la recherche où les pays signataires du processus de Bologne s’engagent dans des politiques pour améliorer en continu la qualité des programmes de formation[5]. Centrée sur la pédagogie, cette démarche consiste à éviter une dérive de distanciation entre recherche et formation, constatée dans le contexte universitaire français et, plus largement, européen. Ce lien recherche-formation fonde le projet d’assurance qualité de l’UFC. De plus, le DAQ fédère différentes initiatives autour de la qualité des formations dans l’établissement, où des services sont engagés dans des actions d’amélioration continue sans qu’elles soient nécessairement formalisées[6]. Après une première phase expérimentale, l’objectif visé est d’impliquer toutes les formations de l’UFC, afin que chacune atteigne, pour 2020, un socle d’exigences, assurance-qualité justifiant son ouverture. La coordination de ces différentes missions au sein de la DAQ est confiée à des chargées d’appui : Oumhanie Legeard pour la qualité pédagogique des formations universitaires[7], Véronique Freyburger, comme référente démarche qualité des programmes de formation, et Isabelle Maillotte, responsable qualité au titre de son expertise[8] en la matière.
L’intégralité des équipes pédagogiques doivent s’engager dans la démarche compétences et acquis de l’apprentissage, avec des programmes en amélioration continue. Ce dispositif prévoit une mise en synergie des activités des services universitaires en appui à la formation, afin de créer un environnement favorable à cette démarche. Un processus d’évaluation des enseignements est engagé. Les ateliers de projet professionnel, conçus avec le bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP), se généralisent dans tous les diplômes[9]. Cette approche nouvelle, qui repose sur différents engagements, permet de réfléchir collectivement à la qualité de l’enseignement supérieur du point de vue des programmes et de leur cohérence pédagogique. L’étudiant est placé au cœur du processus : il doit pouvoir développer des compétences transversales en bénéficiant, dès la licence, d’une sensibilisation à l’entrepreneuriat et à l’innovation, avec PÉPITE Bourgogne Franche-Comté, acquérir des certifications en langues (dont la maîtrise de la langue française) et en informatique.
De leur côté, certaines équipes de recherche, comme le SERAC (Service d’analyse et de caractérisation), de l’observatoire (en chronométrie[10]) et de FEMTO-ST, ont elles-aussi déjà intégré une démarche qualité afin de répondre aux exigences de leurs partenaires extérieurs, grands organismes publics ou entreprises privées. En juin 2007, afin de les accompagner, est créé au sein de la direction de la valorisation un service qualité, qui a pour responsable Sophie Ubaldi. Il convient d’harmoniser et de systématiser les bonnes pratiques professionnelles quotidiennes, d’en décrire les processus pour réaliser une tâche donnée, notamment quant aux ressources et de pilotage. Si l’objectif consiste à améliorer l’organisation interne du laboratoire ou du service, le plus souvent il s’agit d’obtenir une certification ou une accréditation[11], délivrée par un organisme spécialisé qui confirme ainsi que les activités du laboratoire, tant pour son management que pour ses procédures, répondent à un ensemble de critères définis par une norme[12]. Cela suppose une mobilisation de tous les personnels, via une sensibilisation, des formations et l’élaboration de documents.
À la fin, des évaluateurs d’un organisme extérieur habilité réalisent un audit de la structure concernée. Ainsi, à titre d’exemple, en 2023, sont certifiés le laboratoire QUALIO analyses & environnement[13], l’UMR Right[14], deux unités techniques du laboratoire temps-fréquence de Besançon[15] ou encore l’institut FEMTO-ST[16]. De plus, l’établissement obtient (début 2016) la reconnaissance européenne « HR Excellence in Research » (HRS4R), marquant ainsi son souhait de se conformer aux recommandations de la Commission européenne sur le recrutement et sur la carrière des personnels – label renouvelé en 2023.
En 2018, lors de son second mandat, Jacques Bahi crée le service qualité-audit, qui permet un véritable management de la qualité à l’échelle de l’établissement. Dirigé par Véronique Freyburger, il est composé de trois personnels. Son champ d’expertise apporte une aide au pilotage pour la gouvernance. Ses principales missions sont d’accompagneer les services, les formations et les unités de recherche pour être certifiées et labellisées. Ce service assure aussi la confection et la mise à jour du plan de continuité d’activité, en cas de crise de l’université, à partir de la norme ISO 22301. Le service qualité-audit a ainsi accompagné l’obtention de labels tels que Qualiopi[17] pour SeFoC’Al et le CLA, Marianne pour le service commun de documentation (SCD) et les bibliothèques universitaires, qualité FLE (français langue étrangère) pour le CLA[18], le label Bienvenue en France pour la DREIF et la certification ISO 9001v2015 pour SeFoC’Al ou encore EURACE[19] pour le CMI hydrogène énergie et efficacité énergétique.
En 2024, l’UFR sciences et techniques propose une licence professionnelle métiers de la qualité, parcours qualité sécurité environnement, un master sciences de l’eau, parcours qualité des eaux, des sols et traitements et un master biologie-santé, parcours assurance-qualité de produits de santé. L’ISIFC s’est doté d’un DU (diplôme d’université) qualité.
Dans les bibliothèques universitaires, la qualité de l’accueil et des services aux étudiants est mesurable. En 2022, le réseau du SCD, labellisé Marianne depuis trois années, est toujours classé en 1re position de la moyenne nationale[20]. Ce label est en cours de transition vers le label « services Publics + ». D’autre part, ouverte 74 heures dans la semaine, la BU santé est labellisée « NoctamBU + » par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
L’obtention du label Bienvenue en France, mesurant la qualité d’accueil des étudiants internationaux, facilite aussi la mobilité étudiante. Le 8 juillet 2019, l’université de Franche-Comté s’est ainsi classée dans les treize premiers établissements publics à obtenir cette reconnaissance du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et de l’agence Campus France. La direction des relations internationales, de l’Europe et de la francophonie (DRIEF), accompagnée par le service qualité-audit, a piloté ce projet. Des groupes de travail liés au déploiement du label et mobilisant l’ensemble des composantes ont permis d’élaborer un plan d’action en faveur de l’accueil des étudiants internationaux. D’une manière plus générale, lors du mandat de Macha Woronoff, l’université s’engage dans une démarche qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) pour l’ensemble de ses personnels, pilotée par un vice-président, Benoît Géniaut. L’objectif est d’harmoniser toutes les actions permettant de concilier l’amélioration des conditions de travail pour les personnels et la performance globale de l’université. Elle concerne les thématiques liées à la santé des agents, au sens de l’organisation mondiale de la santé (OMS) : un état de bien-être complet physique, mental et social, et la prévention des risques psychosociaux[21]. Il vise notamment à écrire un schéma directeur de la QVCT, se fondant sur un appel à participation et sur des ateliers participatifs, à accompagner les mutations des pratiques professionnelles par une meilleure adéquation entre l’offre et les besoins des personnels. En conséquence, le plan de formation permanente des personnels a été enrichi, fin 2022, de nouvelles propositions : développement personnel, déontologie, qualité de vie au travail, management et environnement

