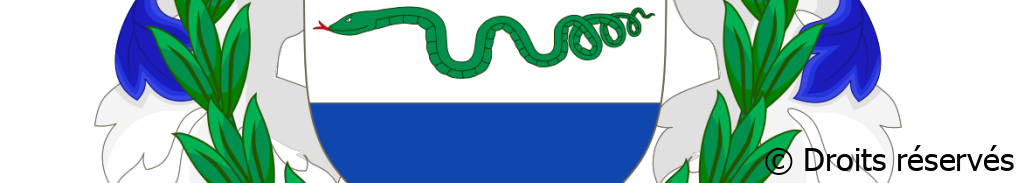Éclipse de l’université, naissance des facultés : la Révolution et le Premier Empire
L’université de Besançon ferme ses portes le 12 novembre 1793, après quelques années difficiles. L’abolition des privilèges et des droits féodaux, le 4 août 1789, ainsi que la vente des biens ecclésiastiques, frappent durement ses ressources financières et donc les traitements des professeurs. Après le décret du 27 novembre 1790, l’obligation de prêter serment de soumission à la Constitution civile du clergé divise les enseignants et force certains à l’exil. La loi Le Chapelier de 1791, qui supprime les corporations et associations professionnelles, et le décret du 18 août 1792 qui fait disparaître les congrégations séculières, rendent en outre les diplômes universitaires inutiles ; ils ne sont désormais plus nécessaires pour exercer en tant que juriste, médecin ou théologien. Comme presque toutes ses homologues, l’université bisontine est donc déjà moribonde lorsque la Convention nationale décrète, le 15 septembre 1793, la dissolution et la fermeture des 22 universités du pays.
Pourtant, le conseil général du département du Doubs, dans la séance où il met en application le décret de suppression des universités, annonce : « Le Conseil général […] arrête que le nombre des professeurs de l’Université sera réduit provisoirement à deux, dont un pour le droit et l’autre pour la médecine1. » Ce faisant, le conseil entend sans doute, malgré la suppression de l’université, préserver l’existence d’un enseignement supérieur à Besançon. L’école centrale du Doubs créée, comme dans les autres départements, par le décret du 7 ventôse an III, est installée à Besançon dans le collège des jésuites : le droit est enseigné par Jean-Baptiste-Victor Proudhon (1758-1838) et quelques cours d’anatomie et de botanique y sont brièvement assurés. Une véritable école libre de médecine prend progressivement corps à l’hôpital Saint-Jacques, rebaptisé « hôpital de la Montagne », où des professeurs de la faculté de médecine de l’Ancien Régime et des médecins militaires enseignent activement.
Le Consulat et le Premier Empire s’intéressent très tôt aux questions d’enseignement. Dès 1802, les écoles centrales sont remplacées par les lycées, dans l’idée d’en faire l’une des « masses de granit » sur lesquelles recréer l’unité nationale, fonder le nouveau régime et assurer la “fusion des élites”. Ce sont ces lycées qui doivent assumer les fonctions de préparation aux études professionnelles (dans la lignée des facultés des arts de l’Ancien Régime) et la formation générale complète des futurs notables. C’est a posteriori qu’ils sont intégrés dans un système global, appelé l’Université impériale, établie par la loi du 10 mai 1806 et mise en place par le décret impérial du 17 mars 1808. L’Université de Napoléon Ier est marquée par trois principaux soucis : donner à l’État et à la société les cadres nécessaires à la réconciliation et à la stabilisation du pays ; contrôler étroitement leur formation, en conformité avec le nouvel ordre social, ce qui implique de laisser une place à la religion, mais de conserver les principaux acquis de la sécularisation du corps enseignant ; empêcher la renaissance de nouvelles corporations professionnelles indépendantes.
Cette Université devait avoir le monopole de l’enseignement, comme l’affirme Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845) : « l’Université a le monopole de l’éducation comme les tribunaux ont le monopole de la justice et l’armée a le monopole de la violence publique2 ». L’objectif de soumission de l’enseignement secondaire et supérieur à l’État, qui entend s’en servir pour orienter l’esprit public, explique la prédominance du modèle de l’école monodisciplinaire fonctionnant sur des programmes uniformes, mais aussi la centralité du grade ouvrant le droit à une fonction ou à l’exercice d’une profession précise. La hiérarchie qui voit se succéder baccalauréat, licence et doctorat réapparaît, comme moyen de certifier le talent et de distinguer une nouvelle élite nationale par le mérite. La recherche de stabilité imprègne toute l’entreprise napoléonienne. Si, en dehors des mathématiques, les sciences sont suspectes aux yeux du régime, car susceptibles de connaître des révolutions et donc incapables de fournir un socle de connaissance stable, les humanités classiques, considérées comme garantes de valeurs éternelles, sont placées au cœur de l’enseignement. La seule recréation d’une corporation est celle de l’Université, au singulier, qui englobe le personnel enseignant secondaire et supérieur. Contrairement au temps de l’Ancien Régime, c’est une corporation étroitement surveillée et sans autonomie aucune. Elle est intégrée dans la hiérarchie des corps qui forment l’État nouveau, sous la tutelle d’un Grand-Maître, Louis de Fontanes (1757-1821), qui nomme à tous les postes.
Lorsque les facultés sont finalement recréées en 1808, elles sont désormais organisées par ordres nationaux, et non en fonction d’universités locales. Il n’existe aucune connexion entre les différentes facultés d’une même ville, mais une hiérarchie nationale dont Paris est le sommet. Les anciennes facultés des arts sont en outre scindées en deux, facultés des lettres (23 sont ouvertes) et facultés des sciences (10 sont créées), s’ajoutant aux traditionnelles facultés de théologie (7 sur le territoire), de droit (9 sont établies) et de médecine (3 sont instituées). Aucune de ces facultés n’a vocation à innover ou à produire de la recherche, activités confiées aux grands établissements (Collège de France, Observatoire et Muséum national d’histoire naturelle), à l’Institut national et aux sociétés savantes. Les facultés des sciences comme celles des lettres sont ainsi d’abord, et avant tout, des jurys d’examen pour le baccalauréat, donnant accès aux facultés “professionnelles” ; leurs rares étudiants se destinent tous à l’enseignement. Partout, les facultés de médecine et de droit concentrent ainsi la grande majorité des étudiants.
Le retour d’institutions d’enseignement supérieur à Besançon s’opère dans ce contexte. Il est organisé par Jean-Jacques Ordinaire (1770-1843), un quarantenaire issu d’une vieille famille comtoise, ancien avocat au parlement devenu professeur de grammaire générale à l’école centrale du Doubs en 1797, puis proviseur du lycée de Besançon. Nommé recteur de l’académie, Ordinaire voit son action soutenue par le préfet Jean de Bry (1760-1834), les maréchaux Bon-Adrien Jeannot de Moncey (1754-1842) et Louis-Alexandre Berthier, prince de Neuchâtel et Valangin (1753-1815), ainsi que l’archevêque de Besançon Claude Le Coz (1740-1815).
Cependant, malgré les cours réputés de législation de Jean-Baptiste-Victor-Proudhon, que la ville et le département avaient soutenu en espérant la création d’une école juridique, Besançon ne parvient pas à obtenir une faculté de droit. Le régime se méfie d’une cité qui s’est avérée hostile en majorité lors des plébiscites de 1802 (sur le consulat à vie) et 1804 (sur l’hérédité impériale). Il accorde sa préférence à Dijon, ville qui lui est plus favorable. Proudhon devient d’ailleurs le premier doyen de cette faculté dijonnaise. De même, alors que dans de nombreuses villes les écoles libres de médecine de la période révolutionnaire deviennent des écoles secondaires de médecine, intégrées dans la nouvelle université impériale, la ville de Besançon, malgré ses demandes réitérées, n’obtient pas la création d’une telle école. Le décret du 7 août 1806, signé de Napoléon Ier, remplace l’école libre de médecine par des cours pratiques de médecine, de chirurgie, et de pharmacie. Ces cours forment des officiers de santé, un corps de « médecins de deuxième ordre » créé par la loi du 10 mars 1803, qui ne peuvent exercer que dans le département dans lequel ils sont reçus par un jury spécialisé.
La création des facultés bisontines de sciences et de lettres est bien organisée par Jean-Jacques Ordinaire, qui cumule son rectorat avec le décanat de la faculté des lettres. Il a obtenu que son frère Désiré Ordinaire (1773-1847) soit nommé doyen de la faculté des sciences et mobilise très efficacement ses liens étroits avec la municipalité et avec le grand-maître de l’université impériale Louis de Fontanes. Ordinaire parvient à ce que les facultés de lettres et de sciences soient installées solennellement le 1er mai 1810 dans les locaux que la municipalité a acquis pour l’académie de Besançon, dans les bâtiments de l’ancienne abbaye Saint-Vincent. Ces deux nouvelles facultés sont de taille modeste et n’occupent guère que deux ou trois salles. On compte quatre chaires en lettres, pour la philosophie, l’histoire, l’éloquence latine et l’éloquence française, et trois en sciences, pour les mathématiques, la physique et la chimie, et pour l’histoire naturelle. La cérémonie d’installation, grandiose, est ouverte par une messe solennelle célébrée par l’archevêque, en présence de la cour impériale et des « chefs des autorités militaires, administratives et civiles3 ». Après un discours du recteur, tous les professeurs de la faculté et du lycée, en grand costume, prêtent serment devant un buste de l’empereur. Avant même la première rentrée officielle du 3 décembre 1810, les enseignants donnent une leçon par semaine à destination du grand public, afin d’attirer l’attention sur la nouvelle institution. La première soutenance de doctorat ès lettres du pays est organisée à Besançon le 14 août 1810, pour Pierre Fontanier (1765-1844). Si la faculté de théologie a bien été créée par décret du 13 décembre 1810, les trois ecclésiastiques désignés pour la constituer suscitent au grand séminaire des débats tels que le grand-maître abandonne le projet en janvier 1811.
Des temps difficiles : de la Restauration au Second Empire
La Restauration, fondée sur l’alliance du Trône et de l’Autel, se méfie très fortement de l’Université. Le 17 février 1815, elle en prononce même la dissolution, entendant la remplacer par 17 universités régionales – dont une à Besançon. Mais l’arrêt n’est pas appliqué en raison du retour de Napoléon Ier quelques jours plus tard. Après les Cent-Jours, le gouvernement de Louis XVIII (1755-1824) décide de maintenir la structure nationale, se refusant finalement à perdre le contrôle centralisé que lui offre l’institution napoléonienne. Mais la guerre coûte cher : 17 facultés des lettres et 3 facultés des sciences sont supprimées en 1815. À Besançon, l’arrêté du 31 octobre 1815 supprime la faculté des sciences, mais le conseil municipal parvient, à grand peine, à faire maintenir la faculté des lettres. La pression de la municipalité, et du maire de Besançon Antoine Daclin (1742-1822), pour obtenir enfin une école secondaire de médecine porte alors ses fruits. Le 18 mai 1820, une ordonnance du roi Louis XVIII transforme les cours pratiques de l’hôpital Saint-Jacques en école secondaire de médecine qui passe sous régime universitaire, sous l’autorité de la commission de l’instruction publique. Nicolas Vertel (1767-1845), professeur de pathologie interne, devient le premier directeur de la nouvelle école secondaire de médecine et reste un homme clé de l’enseignement de la médecine à Besançon jusqu’à son décès.
La faculté des lettres bisontine continue de vivre discrètement, sous l’étroite surveillance des autorités ecclésiastiques qui voient dans ses cours publics des foyers de libéralisme. Comme l’évoque Charles Weiss (1779-1866) dans son journal, le 8 décembre 1819 : « Les étudiants en théologie [du grand séminaire] ont cessé de suivre le cours d’histoire de l’académie depuis que le professeur [Boucley], arrivé au Moyen Âge, est obligé de révéler les fautes des souverains pontifes ; et ce matin même ils ont déserté le cours de belles-lettres parce que le nouveau professeur (M. [Paul] Dubois) a fait résonner en trois fois à leurs oreilles le mot patrie ». Le recteur Jean-Jacques Ordinaire, considéré comme trop proche des libéraux par le ministère, perd alors son poste : il est mis à la retraite d’office en 1824, remplacé par l’abbé Magloire Alexandre Calmels (1789-1848).
Le succès des libéraux aux élections de 1827 permet un début d’apaisement avec la création d’un ministère indépendant de celui des cultes, qui lance une politique poursuivie par la monarchie de Juillet, puis le Second Empire. Il s’agit de défendre l’Université contre les prétentions ecclésiastiques, et de renforcer quelque peu l’autonomie corporative, sans affaiblir pour autant le pouvoir de l’État. C’est dans ce contexte qu’Amédée Thierry (1797-1873) occupe en 1828-1830 la chaire d’histoire bisontine. Mais les résistances sont nombreuses. Les gouvernements successifs choisissent de calmer le jeu en neutralisant progressivement les fonctions de l’institution – politique incarnée localement par Jean-Baptiste François Pérennès (1811-1867), doyen de 1837 à 1872. Cet apaisement permet le développement de l’université de Besançon.
Toujours sous l’impulsion de Nicolas Vertel, l’ordonnance royale du 31 mars 1841 transforme l’école secondaire de médecine en école préparatoire de médecine et de pharmacie à la charge financière de la municipalité. Le corps professoral est réorganisé et l’école connaît une période de stabilité et de prospérité sous la responsabilité de directeurs qui assurent des mandats longs, comme Joseph Édouard Sanderet de Valonne (1802-1890), directeur de 1857 à 1878.
Le retour de la faculté des sciences en 1845 est le résultat de l’activisme de Jean-Jacques Ordinaire, revenu à la tête du rectorat en 1834, après dix ans de disgrâce. En 1837, averti que le gouvernement prépare la création de nouvelles facultés, il rédige un mémoire détaillé dans lequel il insiste sur les besoins de l’industrie horlogère, sur ceux de l’école de médecine et du séminaire, sur la nécessité de lutter « contre l’influence envahissante de Fribourg » en Suisse, mais aussi sur le goût des Comtois pour les sciences. Selon lui, il n’est pas de province « où le goût des mathématiques soit plus généralement répandu ». Appuyé par les députés du Doubs, en particulier par son ami Théodore Jouffroy (1796-1842), professeur de philosophie à la Sorbonne, mais aussi par le conseil municipal, le préfet et un groupe de notables franc-comtois résidant pour partie à Paris, il lance une longue campagne. Elle est couronnée de succès par l’ordonnance royale du 15 février 1843 mais Ordinaire, décédé 15 jours plus tôt, ne le voit pas. La nouvelle faculté des sciences, organisée par son premier doyen, le jeune chimiste Henri Sainte-Claire Deville (1818-1881), est inaugurée le 4 novembre 1845, après deux ans de négociations entre l’État et la ville pour l’aménagement des locaux, toujours au sein de l’ancienne abbaye Saint-Vincent. L’institution est, dès l’origine, plus développée que la première faculté des sciences. Les chaires de chimie et de physique sont désormais séparées, de même que celles de zoologie et de botanique d’une part, de géologie et de minéralogie d’autre part. Dès 1846, les mathématiques sont elles aussi dédoublées, par la création d’une chaire de mathématiques appliquées. La nouvelle institution tisse très rapidement des liens forts avec son environnement : les travaux de Sainte-Claire Deville à Besançon sont par exemple largement consacrés à l’analyse des eaux du Doubs. La faculté des sciences recréée développe une collaboration étroite avec l’école de médecine par l’intermédiaire de ses professeurs de botanique, tel Charles Grenier (1808-1875) qui enseigne également l’histoire naturelle à l’école de médecine, mais aussi des étudiants, nombreux à suivre les enseignements des deux institutions.
La faculté des lettres connaît, elle aussi, de nouveaux développements à partir du Second Empire. Une chaire de langues étrangères est introduite en 1859, mais elle prend toute son ampleur à l’arrivée de Charles Auguste Widal (1822-1875) en 1864. Il faut attendre la IIIe République pour qu’une sixième chaire apparaisse à la faculté des lettres : en 1883 est créée une seconde chaire d’histoire, séparant l’histoire et géographie des temps modernes, occupée par Léonce Pingaud (1841-1923), de l’histoire et géographie de l’Antiquité et du Moyen Âge, confiée à Charles Molinier (1843-1911). L’institution sort alors définitivement de son rôle initial de conservatoire des humanités classiques pour s’intéresser à la production de savoirs nouveaux, ce dont témoigne, parmi bien d’autres exemples, la chaire de philosophie. Jusqu’alors occupée par des historiens de la discipline, en 1885 accède à cette chaire Edmond Colsenet (1847-1925), spécialiste de psychologie et introducteur en France du concept d’inconscient.
Les débuts de la montée en puissance : la IIIe République
La IIIe République déploie une active politique universitaire, avec l’objectif de redorer le prestige du pays après la défaite de 1870-1871, mais aussi de répondre à la concurrence grandissante de l’enseignement supérieur privé, autorisé à partir de 1875. À l’échelle nationale, le coup d’envoi est lancé par la création en 1877, d’une part des bourses de licence et d’agrégation, qui amorce une augmentation du nombre d’étudiants des facultés des lettres et des sciences, et d’autre part des postes de maîtres de conférences, qui permettent de transformer la pédagogie. À Besançon, au fil des créations, le nombre d’enseignants à la faculté des lettres double ainsi entre 1877 et 1881, puisqu’aux cinq professeurs sont désormais adjoints cinq maîtres de conférences. Ces postes permettent de donner une place plus grande aux « conférences » (que l’on appellerait aujourd’hui travaux dirigés), et met le pied à l’étrier à une nouvelle génération de savants. L’un des tout premiers, à Besançon, est Édouard Droz (1855-1923), en littérature, qui devient rapidement l’un des piliers de la faculté.
En 1871, après l’annexion de l’Alsace-Moselle consécutive à la guerre franco-prussienne, la faculté de tutelle de l’école de médecine bisontine n’est plus Strasbourg mais Nancy. Au début des années 1880, l’école, après une longue période de stabilité, est mise en difficulté par une série de décrets, qui grève les frais à la charge de la municipalité, et par la chute du nombre d’étudiants inscrits. Le directeur Albin Saillard (1842-1925), conseiller municipal de Besançon et futur sénateur du Doubs, après de multiples tractations, réussit à mettre l’école préparatoire en adéquation avec les impératifs légaux et à en assurer la survie.
Le passage à la IIIe République a aussi des conséquences profondes à la faculté des sciences, puisque celle-ci se joint à la campagne qui vise, dès 1871, à doter Besançon d’un observatoire astronomique, météorologique et chronométrique afin de venir en aide à l’industrie horlogère locale ; lorsque l’observatoire est inauguré en 1884, une septième chaire est créée pour son directeur Louis-Jules Gruey (1837-1902). À partir de 1897 cet observatoire a pour mission, en particulier, de certifier la qualité des montres, ce qu’il fait en leur apposant un poinçon représentant une tête de vipère. La collaboration de la faculté des sciences et de l’école préparatoire de médecine s’intensifie lorsqu’est créé, en 1893, un certificat d’études physiques, chimiques et naturelles (PCN), préalable obligatoire à l’entrée à l’école de médecine. Cette préparation incombe aux professeurs de la faculté des sciences et aboutit à l’individualisation d’une chaire de botanique, confiée à Antoine Magnin (1848-1926). Ce dernier réussit à obtenir la construction d’un Institut botanique sur le site du jardin botanique à proximité de l’hôpital Saint-Jacques et des laboratoires d’anatomie et de chimie construits à l’arrière de l’école de médecine quelques années plus tôt.
À la fin du XIXe siècle, le budget de l’enseignement supérieur bisontin commence à augmenter : entre 1878 et 1888, celui de la faculté des lettres passe ainsi de 36 000 à 60 000 francs. L’espace disponible s’accroît lui aussi. La séparation des Églises et de l’État en 1905 permet au rectorat de s’installer dans l’ancien palais archiépiscopal, ce qui laisse à la faculté des lettres rue Mégevand trois salles de cours nouvelles – là où elle n’en disposait alors que de deux –, une salle d’archives, une antichambre et une salle de réception. On retrouve un processus semblable à la faculté des sciences, où sont fondées en 1898 une chaire de chimie industrielle, confiée à Pierre Genvresse (1852-1905), et un cours de botanique agricole. Une alliance avec l’enseignement technique permet en outre la création en 1901 du laboratoire de chronométrie, dont la direction est confiée à Jules Andrade (1857-1933), titulaire de la chaire de mécanique rationnelle et appliquée, qui partage ses travaux pratiques avec l’école nationale d’horlogerie. Le laboratoire devient, en 1927, l’institut de chronométrie et micromécanique, dirigé par le successeur d’Andrade, Jules Haag (1882-1953).
Une série de réformes de modernisation (telles la spécialisation grandissante de la licence et la création du diplôme d’études supérieures, ancêtre du master) aboutissent, en 1896, à la recréation des universités. Au cours de ce processus, les facultés gagnent une autonomie de plus en plus grande. En 1885 est établi, dans chaque académie, un conseil général des facultés composé de deux représentants de chaque institution, ce qui permet une première ébauche de coopération à l’échelle locale. Ce conseil examine les budgets, coordonne les programmes d’enseignement et administre la bibliothèque. En 1880, Félix Prieur de Grandville (1859-1927) devient le premier bibliothécaire universitaire à Besançon, poste qu’il occupe jusqu’en 1925. Médecin, il devient en parallèle directeur de l’école de médecine de 1902 à 1925.
Chaque faculté obtient alors la personnalité civile, la liberté de fixer les programmes d’enseignement, le droit d’élire son doyen, celui de recruter ses professeurs, même s’il n’en est pas question pour les maîtres de conférences, directement désignés par le ministère. Les rentrées solennelles de chaque faculté sont désormais organisées le même jour. Après plusieurs années de débat, la loi du 10 juillet 1896 accorde le nom d’université à ces conseils généraux des facultés. La presse locale bisontine célèbre alors une opération qui doit faire de la ville un centre intellectuel national. De fait, cette loi fait plus que donner un nom : elle accorde les débuts d’une première autonomie budgétaire, en attribuant aux universités le produit des droits d’inscription, de laboratoire et de bibliothèque des étudiants, en les habilitant à recevoir des dons. Elle leur donne également la capacité de créer des diplômes d’établissement, hors du système des grades d’État. Ce nouveau cadre permet, en particulier, à l’université de Besançon, en 1901, d’ouvrir un cours d’électricité industrielle, de créer un diplôme d’ingénieur-horloger et un diplôme d’agriculture et, en 1902, un certificat d’études françaises destiné aux étudiants étrangers. Un tel dynamisme explique aussi le succès de l’Université populaire, présidée par Édouard Droz, qui multiplie conférences et causeries académiques à l’attention des ouvriers et des employés.
L’objectif de décentralisation est partiellement réussi : si 55 % des étudiants des facultés sont parisiens en 1876, le chiffre tombe à 43 % en 1914. Mais Besançon reste alors, faute d’une faculté de droit, l’une des deux plus petites universités du pays, avec Clermont-Ferrand. Si les facultés bisontines accueillent environ 200 étudiants au moment de leur constitution en université, ils sont environ 300 à la veille de la Première Guerre mondiale, alors qu’à cette date une université non parisienne typique en accueille alors un bon millier, seules Bordeaux, Montpellier et Lyon dépassant les 2000 étudiants.
Ces effectifs limités n’empêchent pas que l’université de Besançon soit touchée par un double processus général à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : la hausse du nombre d’étudiants étrangers, encouragée par la création en 1901 d’un comité de patronage des étudiants étrangers, et la féminisation des effectifs. En 1894-1895, trois Françaises sont ainsi inscrites en médecine (pour 61 hommes) et trois autres en lettres (72 hommes), un étranger (mais aucune femme) en sciences (54 Français) – cette inégale répartition entre facultés reste valable durant l’entre-deux-guerres, mais s’amenuise progressivement. Ils n’empêchent pas non plus l’affirmation d’un syndicalisme étudiant, autour de l’association générale des étudiants de Besançon (AGEB), constituée en 1888, ni l’apparition d’une presse étudiante à partir de 1882 sous la forme de L’Étudiant, journal anecdotique, littéraire, scientifique et musical. Enfin, ces effectifs réduits peuvent même soutenir l’activité scientifique : si Félix Gaffiot (1870-1937) décide de quitter la Sorbonne en 1927 pour occuper une chaire bisontine, c’est en grande partie pour trouver le temps de terminer son célèbre dictionnaire.
La Grande Guerre marque un coup d’arrêt dans la dynamique de développement de l’université bisontine. Nombre d’enseignants et d’étudiants sont mobilisés et pour certains meurent au combat. La guerre vide les salles de cours : les étudiants scientifiques, qui sont 85 en août 1914, ne sont plus que 25 en novembre de la même année ; les littéraires passent de 133 à 48. Jusqu’à la fin du conflit, les effectifs des facultés sont inférieurs à 40 % du niveau d’avant-guerre, ce qui laisse plus de place aux étudiantes – l’école de médecine, en revanche, forme aussi des médecins militaires. Les plaques commémoratives de la faculté de médecine et du site Mégevand témoignent encore aujourd’hui de la lourdeur du tribu payé.
L’université se remet pourtant assez vite : elle accueille plus de 130 officiers américains en 1918-1919, qui viennent apprendre le français et publient un journal, The Besançonian. Les effectifs étudiants retrouvent ou dépassent leur niveau d’avant-guerre dès 1921-1922. En octobre 1920, à la faveur de la loi de 1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur, une faculté libre de droit est créée à Besançon sous l’impulsion du maire Charles Krug (1872-1947). Cette structure supplée l’absence d’une faculté publique et réintroduit l’enseignement du droit à Besançon, absent depuis la fermeture de l’école centrale révolutionnaire en 1802. La ville et le département la financent. Durant l’entre-deux guerres, grâce aux efforts d’Eugène Ledoux (1877-1949), directeur de l’école de médecine et de pharmacie, l’ancienne école supérieure Granvelle est transformée en école de pharmacie et inaugurée en décembre 1934. L’enseignement de la pharmacie y est assuré jusqu’en 1964, date du transfert de la section pharmacie dans les locaux de l’ancien arsenal militaire, où elle rejoint les premiers locaux de l’école de médecine transférés de l’hôpital Saint-Jacques. Besançon reste, dans l’entre-deux-guerres, la plus petite université de France, faisant jeu égal avec Clermont-Ferrand, malgré un pic à 673 étudiants en 1934 – sur les 87 166 étudiants que comptent alors les universités françaises. Cette taille explique sans doute qu’elle ait finalement peu attiré l’attention de l’occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, et soit à cette occasion restée peu perméable aux pressions extérieures – ce qui ne l’empêche pas de connaître de sévères difficultés de ravitaillement, aggravées par une augmentation paradoxale du nombre d’étudiants.
Vers l’université moderne – 1945-1968
Ce sont les années qui suivent l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale qui marquent le début d’un changement d’échelle pour l’université de Besançon. Dès 1946, le nombre d’étudiants commence à augmenter, anticipant même la massification de l’enseignement secondaire liée au baby boom. La faculté des sciences accueille 229 étudiants en 1945-1946, 640 en 1956-1957, et passe la barre des 1 000 à la rentrée 1960, alimentant l’optimisme ministériel qui pense alors que les 3 000 étudiants seront dépassés en 1969. En réalité, la croissance se tasse, et l’université accueille 2 185 étudiants scientifiques en 1968-1969. La faculté des lettres suit à l’origine un rythme proche : 353 étudiants en 1945-1946, 580 en 1956-1957, plus de 1 000 à la rentrée 1961. Mais, en l’occurrence, les prévisions ministérielles de 1960 seront dépassées puisque, si 1 735 étudiants sont prévus pour 1969, la faculté compte en réalité 3 300 étudiants lors de la rentrée 1968.
Après la Libération, l’école préparatoire de médecine et pharmacie connaît une nouvelle crise. Ses effectifs restent stables et les relations avec la faculté de tutelle nancéienne se compliquent. Maurice Duvernoy (1885-1985), professeur d’anatomie et directeur de l’école de 1945 à 1951 œuvre à un changement de faculté de tutelle, en proposant un retour au rattachement à la faculté de médecine de Strasbourg. À deux reprises, il fait voter ce rattachement par la municipalité. Mais le directeur général de l’enseignement supérieur Pierre Donzelot (1901-1960) s’oppose au projet. Ces démarches initiales aboutissent à la transformation de l’école en école nationale de médecine et pharmacie en 1955, puis à la création de la faculté de médecine en 1967 et à la faculté mixte de médecine et pharmacie en 1968. Le professeur Paul Laugier (1910-2009) devient le premier doyen de cette structure.
L’augmentation du nombre d’étudiants en droit dépasse l’effort financier possible par la municipalité. Par une délibération du 17 mars 1964, le conseil de l’université demande la création d’un collège universitaire de droit et des sciences économiques, que le ministère accorde. Une convention est établie avec la ville permettant de répartir la charge financière. La poursuite de l’augmentation du nombre d’étudiants aboutit à la création d’une faculté de droit de plein exercice en 1968.
L’activité de recherche bénéficie de la conjoncture favorable des années d’après-guerre. Le fort renouvellement des titulaires de chaires est l’occasion d’une mutation profonde de l’organisation de la recherche, de plus en plus collective et internationale. Citons, parmi d’autres, l’arrivée de Pierre-Michel Duffieux (1891-1976) en physique, qui va donner une forte impulsion aux recherches en optique, d’Antonin Tronchet (1902-1990) en botanique, de François Châtelet (1912-1987) en mathématiques, de Georges Matoré (1908-1998) en philologie française, un peu plus tard de Pierre Lévêque (1921-2004) en histoire ancienne. Les facultés des sciences et des lettres connaissent une multiplication des postes d’assistants puis, en 1960, le nouveau corps des maîtres assistants. Si la faculté des lettres proposait en 1954 une douzaine d’enseignements magistraux, ils passent la trentaine en 1964. Alors que la faculté des sciences dispose de 10 professeurs et maîtres de conférences et de 9 assistants en 1945, elle accueille 41 professeurs et maîtres de conférences, ainsi que 128 assistants et maîtres assistants, en 1968. Ce déploiement permet à l’institut de chronométrie de prendre son indépendance, et de devenir en 1961 l’école nationale supérieure de chronométrie et micromécanique de Besançon, sous la direction de Pierre Mesnage (1910-2001).
De nouveaux laboratoires peuvent dès lors être créés par l’université à côté des laboratoires de chaire sur lesquels s’appuient des professeurs comme Duffieux. Citons le laboratoire de calcul numérique de Jean-Louis Rigal (1928-1997), qui reçoit en 1961 le première ordinateur bisontin, une calculatrice CAB500, ou le centre de documentation et de bibliographie philosophique fondé en 1959 par Gilbert Varet (1914-2004). La hausse des recrutements laisse la possibilité de s’affirmer à de nouvelles disciplines, comme la psychologie, qui inaugure un laboratoire de psychologie appliquée en 1957, où Charles Bried (1921-2006) développe ses recherches sur l’enfant, ou encore l’histoire de l’art, autour de Lucien Lerat (1909-1993). Cette vitalité permet la montée en puissance de la formation à la recherche, en particulier après la création du troisième cycle à partir de 1956. Si, en 1945-1946, on compte un seul étudiant préparant un doctorat à la faculté des sciences, et aucun en lettres, ils sont 177 à la faculté des sciences en 1964-1965, et 13 dans celle des lettres. Elle encourage aussi l’implantation des organismes de recherche : le CNRS crée en 1958 le laboratoire de l’horloge atomique, dirigé par Jean Uebersfeld (1927-2015), ou, en 1964, le centre d’archives du français contemporain de Bernard Quemada (1926-2018), et l’Inserm confie une unité de recherche à Pierre Magnin (1926-2020) en 1966.
Ces transformations se traduisent aussi par l’établissement de nouveaux liens avec le reste du monde académique, en particulier international. Dès 1946, sous l’impulsion du doyen de la faculté des sciences, Louis Glangeaud (1903-1986), une série de colloques franco-suisses sont organisés, rapprochant en particulier Besançon et Neuchâtel. À l’échelle nationale, les universités de Besançon, Dijon, Nancy et Strasbourg créent, en 1958, l’Association interuniversitaire de l’Est, qui cherche à organiser la collaboration en sciences humaines et sociales entre ces quatre universités, par l’intermédiaire de publications et de colloques réguliers.
Cette double mutation, touchant l’enseignement comme la recherche, impose une extension rapide des locaux universitaires. En 1947, la direction des construction scolaires accorde un crédit de 9 millions de francs pour rénover l’institut de chimie, rendu prioritaire par son état de délabrement avancé. À partir de cette date, et jusqu’en 1966 au moins, l’université connaît des chantiers continuels, financés par la direction de l’équipement scolaire, universitaire et sportif, dirigée par Pierre Donzelot – ancien étudiant bisontin, dont le nom sera donné au nouvel amphithéâtre de Mégevand, inauguré en 1958 –, et soutenue par la direction de l’enseignement supérieur, en particulier Gaston Berger (1896-1960) et Pierre Aigrain (1924-2002). C’est le temps de la construction, pour les sciences, des bâtiments de la place Leclerc, puis du campus scientifique de La Bouloie, l’installation de l’école de médecine et pharmacie sur le site de l’ancien arsenal militaire, et l’extension de la faculté des lettres, à la fois rue Chifflet, au 47 de la rue Mégevand et dans les anciens locaux de la faculté des sciences, également rue Mégevand.Reste que les tensions montent, l’université bisontine connaît une crise de croissance : les étudiants, de plus en plus nombreux, voient leurs conditions d’études se dégrader. Lors de la rentrée solennelle du 13 novembre 1967, qui a lieu dans le théâtre municipal, un groupe de manifestants salue ainsi les étudiants en portant des pancartes réclamant des bourses. Le préfet fait appel à la police, qui « éloigne » brutalement les manifestants au moment où le cortège traverse la rue. Le doyen Pierre Lévêque interpelle le préfet et organise une protestation officielle du corps enseignant dans la presse locale.Le Canard enchaîné fait néanmoins son titre sur la « raclée solennelle de l’université ». Le mai 1968 bisontin éclate donc dans un ciel déjà menaçant. L’agitation commence dès février 1968 dans la cité universitaire de La Bouloie. Comme à Nanterre, l’arrestation de « meneurs » enclenche un engrenage qui débouche sur l’occupation de la faculté des lettres à partir du 13 mai – après jonction avec le mouvement ouvrier, lors de manifestations rassemblant de 6 à 10 000 personnes. Les assemblées générales se multiplient, et Besançon est alors l’une des universités les plus radicales : le boycott des sessions d’examen de juin et octobre l’emporte, et à la faculté des sciences tous les cours sont supprimés. Mais le décès subit du leader Bernard Lhomme (1944-1968), le 27 mai, d’une crise cardiaque, change l’ambiance, au moment où la conjoncture nationale bascule. Le mouvement s’affaiblit, jusqu’à la fermeture estivale des locaux le 11 juillet. Votée à la fin de l’année en réponse aux événements de mai, la loi Faure, première réforme d’ampleur depuis 1896, va profondément transformer les universités.