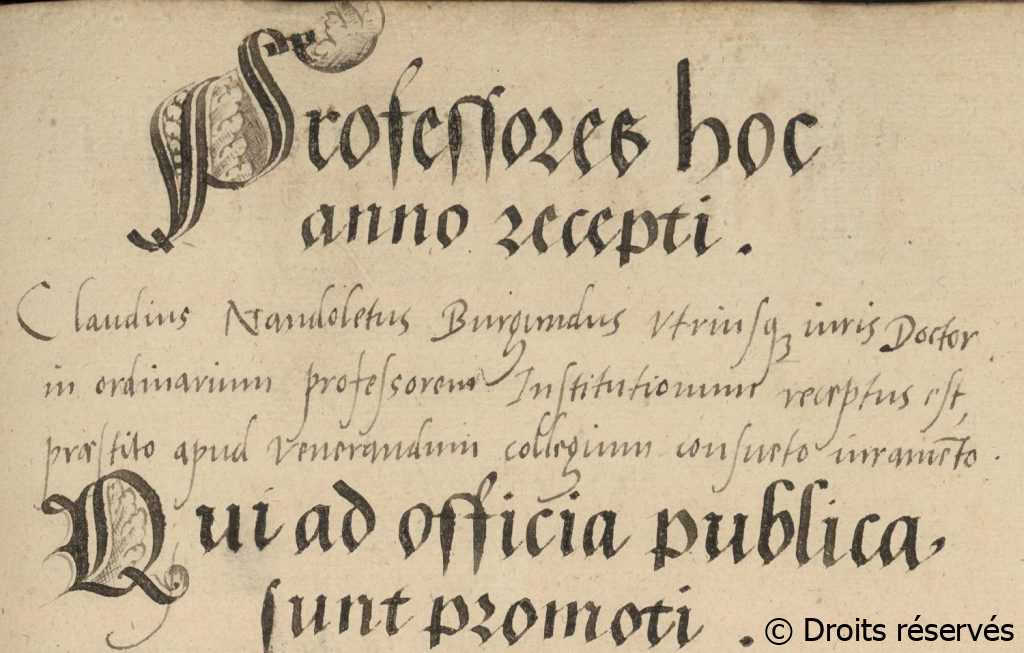La IIIe République déploie une active politique universitaire, avec l’objectif de redorer le prestige du pays après la défaite de 1870-1871, mais aussi de répondre à la concurrence grandissante de l’enseignement supérieur privé, autorisé à partir de 1875.

Vue de la cour intérieure de l’université (ancien cloître de l’abbaye), photographie du début du XXe siècle. Archives départementales du Doubs, 68J1. L. Besançon.
À l’échelle nationale, le coup d’envoi est lancé par la création, en 1877, d’une part des bourses de licence et d’agrégation, qui amorce une augmentation du nombre d’étudiants des facultés des lettres et des sciences, et d’autre part des postes de maîtres de conférences, qui permettent une transformation de la pédagogie. Au fil de ces apports, le nombre d’enseignants à la faculté des lettres double ainsi entre 1877 et 1881, puisqu’aux cinq professeurs sont désormais adjoints cinq maîtres de conférences. Ces postes permettent de donner une place plus grande aux « conférences » (que l’on appellerait aujourd’hui travaux dirigés), et met le pied à l’étrier à une nouvelle génération de savants. L’un des tout premiers, à Besançon, est Édouard Droz (1855-1923), en littérature, qui devient rapidement l’un des piliers de la faculté. Le budget commence lui aussi à augmenter : entre 1878 et 1888, celui de la faculté des lettres passe de 36 000 à 60 000 francs. Surtout, suivent une série de réformes de modernisation (le nouveau diplôme d’études supérieures, ancêtre du master, par exemple) qui aboutissent en 1896 à la recréation des universités – et donc de l’université de Besançon.

Photographie d’Édouard Droz (1855-1923). Bibliothèque municipale de Besançon, EST.FC.1743-Droz.
Le processus est long. Après les premières réflexions lancées par Paul Bert (1833-1886) en 1872, la proposition initiale, que formule le ministre William Waddington (1826-1894) en 1873, est de n’attribuer le statut d’université qu’à des groupements de quatre facultés – médecine, droit, lettres, sciences. L’objectif avoué de l’administration ministérielle, de Louis Liard (1846-1917) et ses proches alliés Ernest Lavisse (1842-1922), Octave Gréard (1928-1904) et Michel Bréal (1932-1915), est de parvenir à créer quatre ou cinq gros centres universitaires sur le territoire. Concentrant les ressources et disposant de leur autonomie, ils pourraient contrebalancer la centralisation parisienne et amorcer une décentralisation intellectuelle. Dans la configuration d’alors, cette mesure aurait condamné à la disparition, ou au moins à la relégation, Besançon, comme Clermont-Ferrand, mais aussi Marseille ou Toulouse. Toutefois, dans un contexte où les républicains sont engagés dans un combat de longue haleine pour prendre le contrôle des institutions, ils ne peuvent pas se permettre de perdre le soutien des neuf ou dix académies qui se verraient ainsi refuser le statut d’université.
Pour temporiser, le ministère Jules Ferry (1832-1893) finit, en 1885, par adopter une mesure de compromis : le but est d’accorder un soupçon d’autonomie et une augmentation des ressources à l’enseignement supérieur, sans pour autant diminuer les droits de l’État, et d’encourager l’unification des facultés, sans toucher à leur autonomie individuelle. Dans chaque académie est créé un conseil général des facultés, composé de deux représentants de chaque institution, ce qui permet une première ébauche de coopération à l’échelle locale. Le conseil administre en particulier la bibliothèque, examine les budgets, et coordonne les programmes d’enseignement. Parallèlement, chaque faculté gagne en marge de manœuvre puisqu’elle obtient alors la personnalité civile, la liberté de fixer les programmes d’enseignement et le droit d’élire son doyen. L’unité est ainsi avant tout symbolique : désormais, les rentrées solennelles de chaque faculté sont organisées le même jour.
Le débat est relancé en 1890 avec les cérémonies des 600 ans de l’université de Montpellier, qui sont l’occasion pour Liard et le ministre Léon Bourgeois (1851-1925) de rouvrir le dossier. Le projet est proche de celui de Waddington : le pari est que, le régime étant désormais consolidé, il devrait être possible de passer outre le mécontentement de nombreux parlementaires. Tout juste créée en juillet 1890, l’association des intérêts de Besançon, qui s’est donné pour mission « le développement du commerce et de l’industrie » de la ville, se saisit très rapidement du sujet. Regroupant les notables bisontins, elle se dote en décembre 1890 d’une commission de l’enseignement supérieur, qui confie la rédaction d’un rapport au docteur Léon Chapoy (1850-1928), professeur à l’école de médecine. Il est assisté de son collègue le docteur Albin Saillard (1842-1925) et de Léonce Pingaud (1841-1923), professeur à la faculté des lettres. Ce texte, intitulé De la restauration de l’université franc-comtoise, sa nécessité pour l’avenir de notre ville et de nos provinces, est largement diffusé lors de la mobilisation que construit alors cette commission en faveur de l’obtention d’une faculté de droit, ce qui donnerait l’assurance d’un futur statut universitaire à la ville. La presse locale, comme la Franche-Comté ou Le Ralliement, joue alors un rôle actif de relais, de même que les sociétés savantes – et en premier lieu l’académie des sciences, belles lettres et arts. En décembre 1890, le conseil municipal de Besançon approuve à l’unanimité le rapport Chapoy, et prend l’engagement formel de mettre à la charge de son budget la somme nécessaire pour assurer la création d’une faculté de droit à Besançon, mais aussi la transformation de l’école de médecine en école de plein exercice. Au 30 avril 1891, 602 autres municipalités de Franche-Comté ont manifesté leur soutien, de même que les conseils généraux du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.
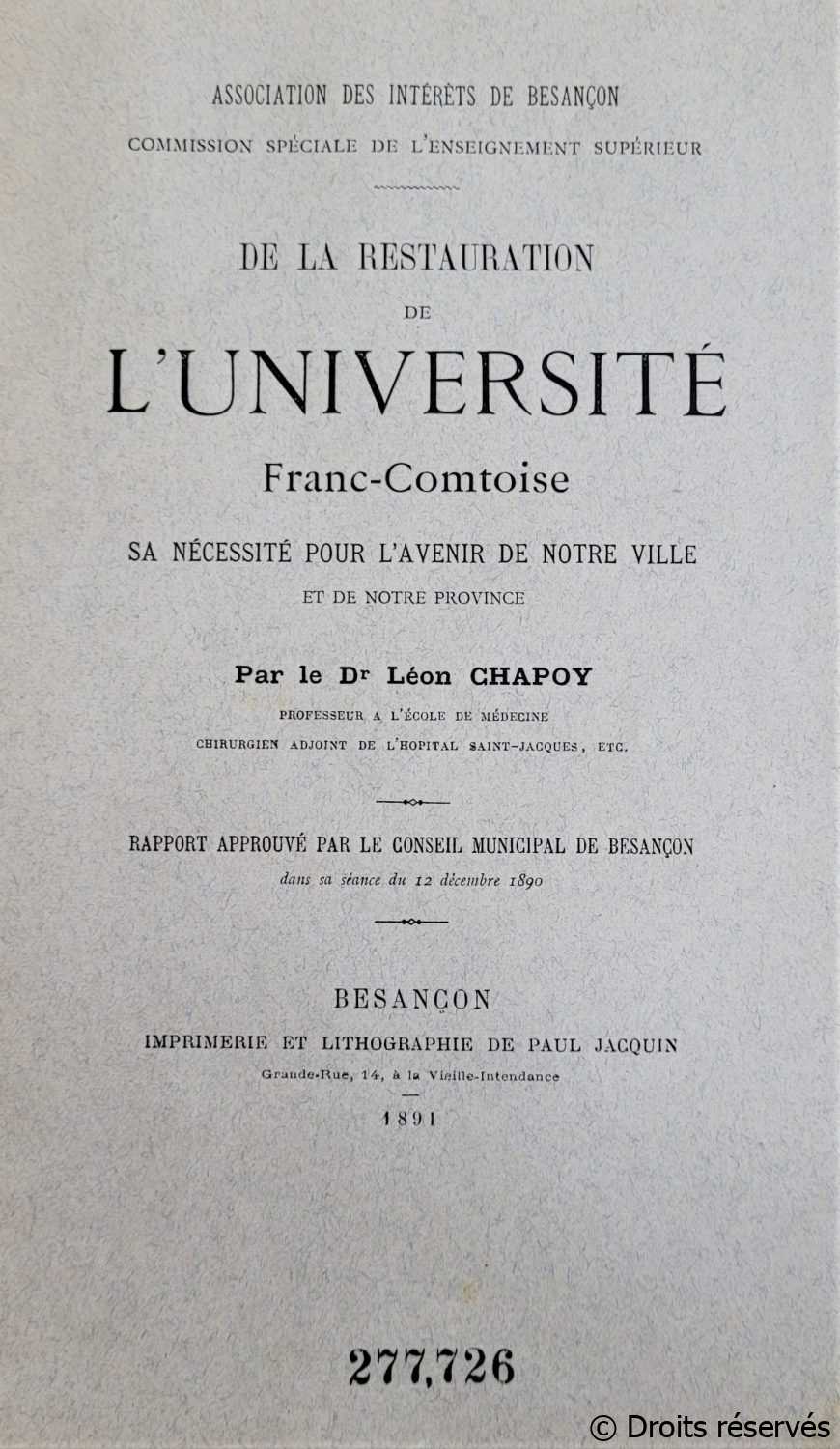
Page de titre de l’essai du Docteur Léon Chapoy, publié en 1891. Bibliothèque municipale de Besançon, 277726.
Les revendications échouent, mais les craintes s’avèrent infondées : après plusieurs années de débat, la loi du 10 juillet 1896 accorde le nom d’université aux conseils généraux des facultés, quel que soit le nombre de facultés. La presse locale célèbre alors une opération qui doit faire de la ville un centre intellectuel national. De fait, cette loi fait plus que donner un nom : elle accorde les débuts d’une première autonomie budgétaire, en attribuant aux universités le produit des droits d’inscriptions, de laboratoire et de bibliothèque des étudiants, en les habilitant à recevoir des dons. Elle leur donne également la capacité de créer des diplômes d’établissement, hors du système des grades d’État. Ce nouveau cadre permet, en particulier, à l’université de Besançon : en 1901, d’ouvrir un cours d’électricité industrielle, de proposer un diplôme d’ingénieur-horloger et un diplôme d’agriculture ; en 1902, un certificat d’études françaises destiné aux étudiants étrangers.
L’objectif de décentralisation est partiellement réussi : si 55 % des étudiants des facultés sont parisiens en 1876, le chiffre tombe à 43 % en 1914. Mais Besançon reste alors, faute d’une faculté de droit, l’une des deux plus petites universités du pays avec Clermont-Ferrand. Elle compte une population d’environ 300 étudiants, tandis que l’université non parisienne typique en accueille alors un bon millier – seules Bordeaux, Montpellier et Lyon dépassant les 2 000 étudiants.