La sécurité des personnels et des étudiants, notamment dans un établissement public doté de laboratoires de recherche utilisant des produits dangereux, mais aussi les règles d’hygiène pour leur manipulation ou en cas de contamination sanitaire, sont des sujets d’importance dont l’université s’est, dès le départ, emparée, sans guère de moyens à l’époque. L’encadrement législatif est arrivé au fil du temps, professionnalisant le service.
En mai 1976, le conseil de l’université décide de créer, au sein de l’établissement, un comité d’hygiène et de sécurité (CHS) qui se réunit tous les deux mois. Il est chargé de procéder à une étude de l’organisation matérielle, de l’ambiance et des facteurs physiques du travail des personnels enseignants et non enseignants de l’université. Ce comité peut aussi préconiser des mesures à prendre pour normaliser ce qui ne serait pas conforme aux règles d’hygiène, de sécurité et de droits des personnels.
Le 9 mai 1978, Jean Ripplinger[JB1] [MG2] , professeur à la faculté des sciences et techniques qui préside ce comité, remet un bilan de son étude[1] au président Pierre Lévêque dans lequel il souligne l’indigence des moyens alloués : absentéisme des enseignants membres du comité qui ne participent que très rarement aux travaux, besoin d’un secrétariat pour l’administration, la documentation et la formation. Si l’université prend en charge financièrement l’acquisition du matériel documentaire spécialisé, le laboratoire de physiologie « paye la frappe et la duplication des documents ». Heureusement, le directeur de la médecine de prévention, le docteur Duplessis de Pouzillac, apporte son concours et l’ingénieur sécurité du CNRS prête son matériel de dosage du gaz dangereux. Toutefois, les enquêtes menées dans les différents UER ou services attirent l’attention des responsables sur les anomalies de certains montages électriques, le dispositif de sécurité incendie, le fonctionnement des issues de secours. La ventilation des locaux est déficiente : sont signalés deux cas, heureusement peu graves, d’intoxication par gaz. Le CHS préconise d’être consulté, du moins informé, de toute construction nouvelle destinée à héberger des activités productrices de vapeur. Les personnels fréquentant des locaux où sont utilisés des gaz dangereux ou des produits toxiques sont invités à subir régulièrement des examens hématologiques dans le cadre de la médecine préventive. Le comité déplore les lenteurs de la réalisation d’un entrepôt spécial pour produits dangereux. Enfin, le CHS souhaite constituer des équipes de secours et d’intervention rapide, en cas d’incendie, de panne d’ascenseur, de fuite d’eau ou de gaz.

Bulletin d’information Le Bire, n° 46, mai-juin 1979, p. 3.
Des volontaires se sont fait connaître, mais doivent être formés. Le bilan souligne aussi l’indiscipline des automobilistes qui laissent leur véhicule sur les voies de circulation à la Bouloie, empêchant ainsi le passage des véhicules de sécurité et de secours.
En mai 1981, Gilbert Tribillon, lui aussi professeur à la faculté des sciences, devient le nouveau président du comité d’hygiène et de sécurité. Il doit faire appliquer les directives qui évoluent rapidement dans ce domaine. En 1982, l’État publie le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction. Les différents acteurs y sont définis, ainsi que leur rôle.
En 1993, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) [2], composé de membres de l’administration et de 14 représentants du personnel désignés par les syndicats, se constitue. En relation étroite avec le service hospitalo-universitaire de médecine du travail et des risques professionnels[3], il œuvre pour améliorer les conditions de travail au sein de l’université du point de vue de la sécurité. Cet organe de représentation des personnels est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission (règlements, consignes), sur les prochains aménagements de bâtiments et a connaissance des remarques consignées dans les registres hygiène-sécurité. Tout accident de service ou maladie professionnelle donne lieu à une enquête. Pour 1993-1994, le programme d’actions en matière d’hygiène et de sécurité se décline en cinq axes : recenser les laboratoires utilisant des éléments radioactifs et les personnes exposées, amplifier les actions déjà engagées pour l’évacuation des déchets, permettre aux personnels des autres sites universitaires de bénéficier aussi d’une visite médicale du travail, élaborer un programme de formation permanente à destination des responsables d’UFR et de laboratoires sur des thèmes sensibles comme les risques ionisants, le traitement des déchets chimiques ou les risques d’incendie, mettre en œuvre la vaccination des personnels. Dès sa création, le CHSCT accompagne un important travail d’évacuation des déchets se trouvant dans les laboratoires des UFR sciences, médecine pharmacie et STGI. Le comité change d’intitulé à plusieurs reprises : en 1996, de CHSCT, son nom est modifié en CHS (comité hygiène sécurité, appellation officielle des textes de l’époque pour l’enseignement supérieur), puis à nouveau CHSCT le 25 septembre 2012, et enfin F3SCT (formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail) depuis le 16 décembre 2022, par application du décret du 20 novembre 2020. La délégation du personnel comprend aujourd’hui 10 titulaires et 10 suppléants.
En 1997, une première ingénieure pour la prévention et la gestion des risques[4] est recrutée ; son poste est intégré au service du patrimoine. Elle a pour priorités de réduire les avis défavorables des commissions de sécurité incendie et de sensibiliser les personnels aux dangers liés à l’exercice de leur travail, en commençant par leur apporter une formation suffisante pour qu’ils soient responsables de leur propre sécurité. Cette information s’effectue sous forme de stages (manipulations des extincteurs, SST, formation autoclave…) intégrant l’offre de formation permanente. Une filière d’élimination des déchets chimiques, notamment liée aux UFR de médecine – pharmacie et de sciences et à l’IUT chimie, est mise en place. Depuis le décret du 5 novembre 2001[5], le Code du travail prévoit que les établissements rédigent un document unique de l’évaluation des risques[6] pour la sécurité et la santé de leurs salariés. Ce document, dont la réalisation s’inscrit dans les obligations réglementaires, doit être ensuite régulièrement mis à jour. D’autres obligations légales, comme le registre santé et sécurité au travail ou le registre des dangers graves et imminents, sont à mettre en œuvre.
Pour répondre à ces enjeux, un service hygiène sécurité est créé en 2007, dont Sonia Racois devient responsable. L’offre de service hygiène sécurité s’étoffe par l’ajout d’autres postes au sein des deux principales composantes présentant le plus de risques et visées comme telles par les inspections hygiène sécurité : un poste d’ingénieur d’études hygiène sécurité à l’UFR sciences médicales et pharmaceutiques en 2008 et un poste contractuel à l’UFR sciences et techniques à partir de 2011[7].
Avec le passage à la LRU et aux RCE (1er janvier 2010), la prévention et les réparations pour les accidents de service ou les maladies professionnelles sont désormais à la charge des établissements et non plus de l’État-employeur. Le président de l’université assume la responsabilité de la sécurité au sein de son établissement. À tous les échelons, les directeurs (d’UFR, d’IUT, de laboratoire de recherche et de services) sont responsables de la protection des agents placés sous leur autorité. Les universités ont donc une obligation de résultats pour améliorer les conditions de travail de leur personnel, leur protection face aux dangers, aux risques d’exposition liés au milieu professionnel. Le conseil d’administration de l’UFC choisit de se rattacher à l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche (IGAENR) pour la mission d’inspection en matière d’hygiène et sécurité[8]. Un inspecteur participe donc de façon consultative depuis 2012 (la première inspection a eu lieu en 2006 et les suivantes se déroulent environ tous les 5 ans). L’université nomme un conseiller de prévention auprès de la présidence, qui veille à l’application du décret 82-453 relatif à l’hygiène et la sécurité, conseille le président de l’UFC et participe de façon consultative à son comité hygiène et sécurité.
Pour déployer son action, le service hygiène sécurité s’appuie sur le réseau des assistants de prévention, formés et présents dans toutes les composantes. Depuis le 1er janvier 2011, ces derniers bénéficient d’une reconnaissance de leur engagement par une valorisation sous forme de points indiciaires sur leur salaire.
En 2023, pour être au plus proche de ses missions, le service hygiène et sécurité devient la direction sécurité prévention des risques (DSPR). L’équipe s’étoffe, avec à sa tête le conseiller de prévention, directeur du service[9], et une équipe composée de deux ingénieurs et deux assistants ingénieurs. Afin de moderniser les outils de prévention, et en collaboration avec la direction des services informatique et du numérique (DSIN), les informations relatives au service hygiène sécurité, initialement accessibles sur l’intranet de l’université, sont depuis juin 2022, déployées dans des pages sur la plateforme Moodle. Ce nouvel outil permet une mise à jour en temps réel de l’actualité et de l’évolution de la réglementation. En octobre 2023, la mise en œuvre du plan de continuité d’activité de l’établissement et la dématérialisation des registres santé, sécurité au travail (STT) sont déployées, comme dans d’autres universités, avec un logiciel propre.
Parce que la sécurité est l’affaire de tous, la communication de l’information est primordiale pour sensibiliser la communauté. Elle s’effectue initialement par le biais du journal interne tout l’U. En complément, une première newsletter électronique est diffusée, d’avril 2010 à juillet 2016.

L’idée est reprise en février 2022 et une nouvelle version est adressée aux personnels.
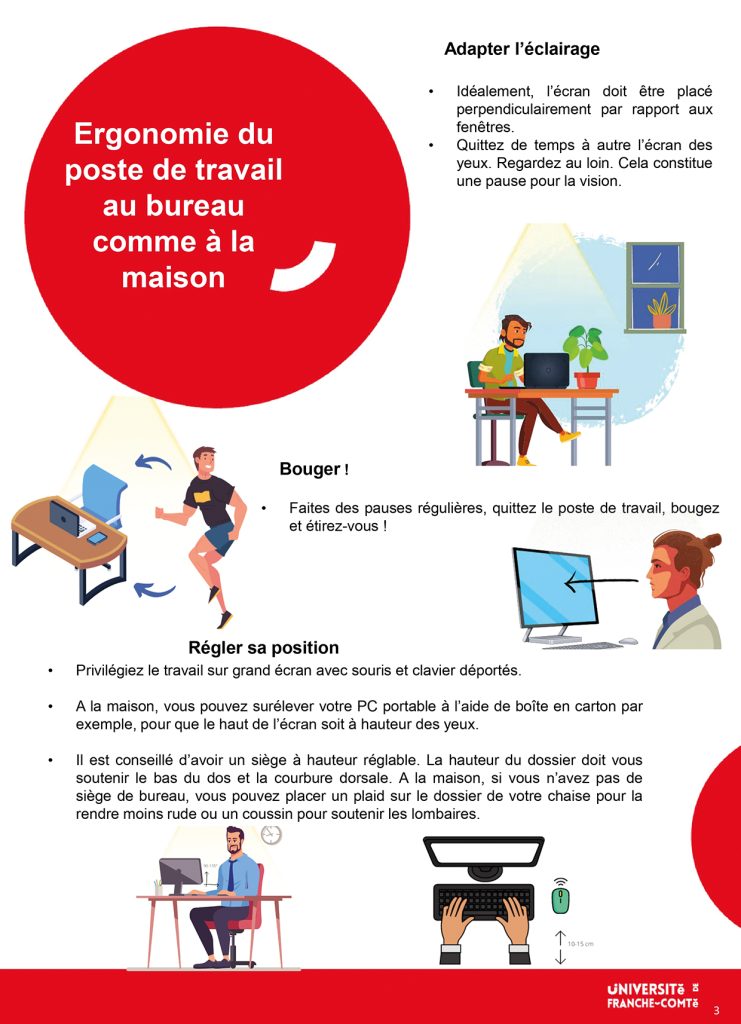
Élodie Crozier.
L’hygiène et la sécurité sont également, depuis longtemps, des disciplines enseignées à l’université de Franche-Comté. Depuis 1997, le département hygiène, sécurité et environnement (HSE) de l’IUT de Besançon Vesoul propose, en formation initiale, apprentissage et formation continue, un bachelor de technologie (BUT), parcours science du danger et management des risques professionnels technologiques et environnementaux, précédemment intitulé diplôme universitaire de technologie (DUT) hygiène, sécurité et environnement.
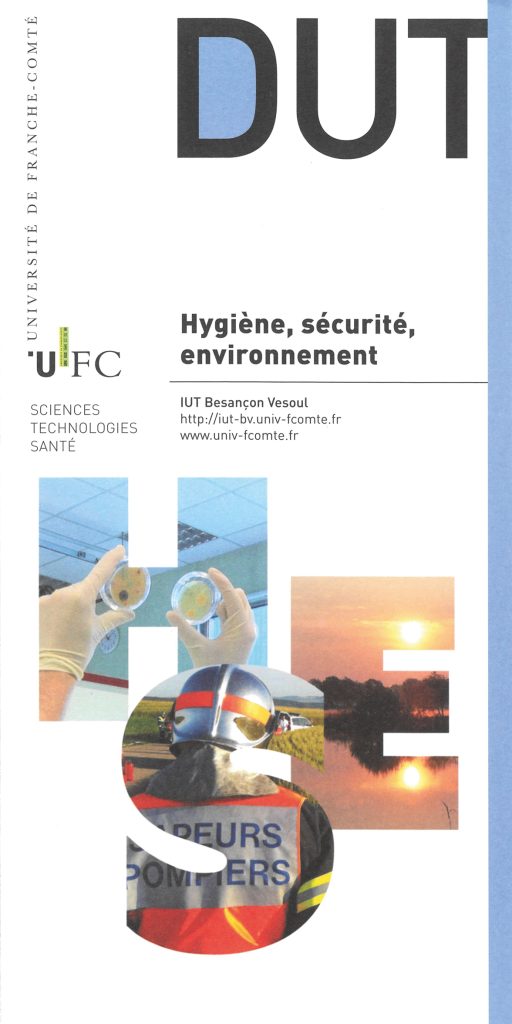
Catherine Bouteiller
De plus, depuis 2001, l’UFR sciences et techniques enseigne la gestion, le traitement des déchets et l’économie circulaire, avec une licence professionnelle, dans le site universitaire de Lons-le-Saunier.