Depuis longtemps, l’université s’est ouverte à la formation continue[1]. Cependant, la volonté de former les individus pour obtenir un diplôme leur permettant d’accéder à une promotion professionnelle est plus récente. Les premiers cours de formation continue remontent à 1959. C’est en 1971 que l’université de Franche-Comté, s’appuyant sur la loi Edgar Faure de 1968 et sur celle du 16 juillet[2] 1971, s’ouvre véritablement à la formation continue. La loi de 1971 secoue la formation professionnelle continue car elle ne vise plus seulement à s’adresser à des individus, des auditeurs, mais à proposer des formations à des acteurs économiques et sociaux confrontés à des mutations profondes, qu’il s’agisse de fermetures de pans entiers d’industries (sidérurgie, mines ou, à Besançon, horlogerie) ou de bouleversements technologiques,et économiques qui restructurent le paysage industriel et social. L’université met alors son potentiel au service des entreprises, des salariés, des demandeurs d’emploi.
À l’université de Besançon, le 1er décembre 1959, le professeur René-Pierre Jacquemain, doyen de la faculté des sciences (1958-1968), et son secrétaire général Georges Lambert adressent au ministère[3] la demande de création d’un institut de promotion supérieur du travail (IPST).
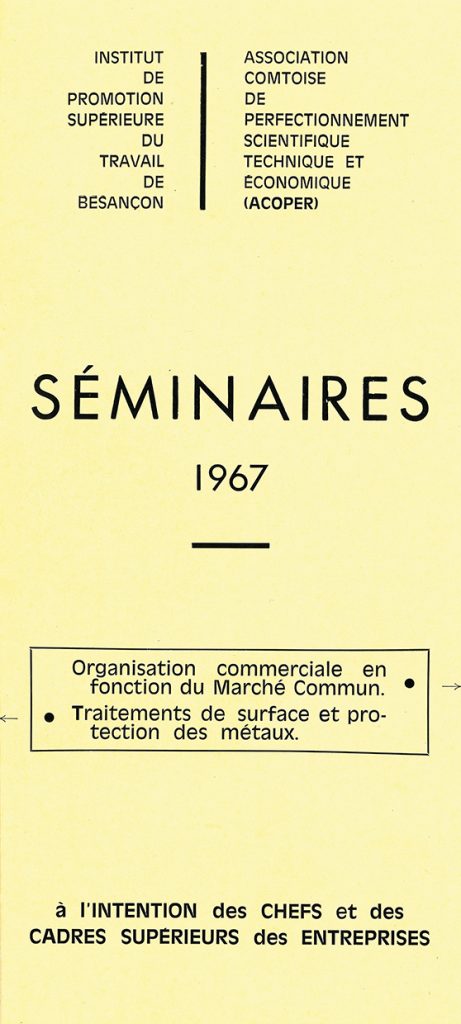
Ce dernier a pour vocation d’organiser les enseignements pour les travailleurs ; il est porté de concert par la faculté des sciences, la faculté des lettres, l’institut de chimie, les lycées d’enseignement technique et les structures économiques régionales. C’est ainsi que, le soir et le samedi matin, se mettent en place les cours de préparation de l’examen spécial d’entrée à l’université (ESEU)[4]. G. Lambert et son bras droit Jean-Marc Narboni assurent eux-mêmes la première organisation de ces enseignements, en cours du soir, décentralisés dans un lycée à Dole. À la même époque, la création de l’association comtoise de perfectionnement scientifique, technique et économique, (ACOPER[5]) permet à l’université d’organiser des séminaires, avec et pour les cadres et dirigeants des entreprises régionales.
Le 1er janvier 1969, un centre de formation et de promotion professionnelle voit le jour, pour peu de temps[6]. Le 21 juin 1972, dans le cadre de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur, grâce au soutien du président Jean Thiébaut et à l’assistance toujours active de G. Lambert, l’institut universitaire de formation continue (IUFC) lui succède. à sa tête, d’abord François Lhote, puis Maurice Colette en 1975, avec une équipe très efficiente constituée du directeur des études Pierre Maillard (responsable des cours du soir et de l’antenne du CNAM), de chargés de mission (Anne-Montenot André, Claude Lambey) et d’une responsable administrative (Gilberte Genevois).
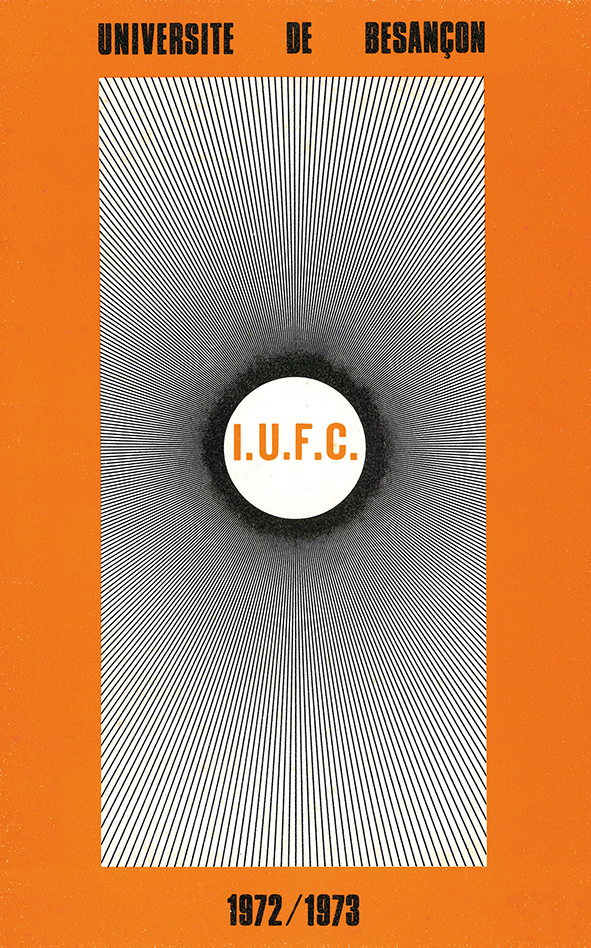
L’IUFC, qui a des frais de fonctionnement, doit s’autofinancer. Le 16 novembre 1973[7], son conseil d’administration approuve la facturation du montant des frais engagés pour la préparation du stage, ainsi que pour la publicité (frais de réalisation des catalogues) et la prospection, toutes deux « rendues nécessaires par la concurrence dans laquelle se trouve l’université dans ce domaine de formation ». Suivant l’importance des démarches entreprises par l’IUFC pour la préparation et le lancement d’un stage, les frais des prestations de service représentant 6,5 %, 10 % ou 20 % du prix du stage[8].
Dans ses missions, l’IUFC prend également en charge la gestion d’un centre agréé par le CNAM, créé par François Lhote, enseignant à la faculté des sciences. La modularité des certifications proposée par cette antenne du CNAM est particulièrement adaptée aux travailleurs et facilite leur suivi.

Pour répondre aux besoins de formation continue des salariés, l’IUFC collabore avec le monde économique, social, culturel de la région. Dans cet objectif, il prospecte pour identifier les besoins ponctuels des entreprises en ressources humaines, afin de proposer des stages permettant de leur apporter une réponse. L’IUFC est amenée à informer les entreprises, non seulement des offres de formation possibles de l’université, mais également de la réglementation en vigueur du « 1% à la formation continue », alors mal connue. La loi du 16 juillet 1971 constitue en effet une étape majeure de ce qui deviendra plus tard la « formation professionnelle tout au long de la vie » (FPTLV) du 15 octobre 2007 Cette législation oblige les entreprises de plus de 50 salariés à consacrer 1 % de la masse salariale à la formation de leurs employés. Pour établir le programme de stage en réponse aux besoins en formation du milieu socio-économique, l’IUFC fait appel à des universitaires, qu’il accompagne pour l’organisation des sessions de stage. C’est ainsi que se développe la transmission des connaissances, issues de la recherche scientifique et technique la plus récente, dans de larges domaines : métallurgie, traitements de surfaces, robotique, électronique, pédagogie, gestion, audiophonologie, langues…Les cours intéressent différents publics, ayant divers niveaux de qualification ; ouvriers, techniciens ou cadres, formateurs, travailleurs sociaux, conseillers familiaux et conjugaux, jardiniers, élus locaux, orthophonistes ou pharmaciens… La durée des sessions, variable, va de quelques jours à plusieurs semaines[9]. Les formations ont lieu dans les entreprises ou dans les laboratoires ; certaines ont même été décentralisées jusqu’aux Antilles. Elles sont construites pour des acteurs économiques et sociaux et traitent de problèmes concrets, tels que les mutations technologiques, la reconversion, le chômage ou le retour en formation.
Les formateurs, universitaires et intervenants extérieurs, sont confrontés à la nécessaire acquisition de nouveaux savoir-faire pédagogiques, autres que la transmission classique des savoirs. C’est ainsi que l’IUFC met en place une approche inédite par le théâtre, en collaboration avec Jacques Vingler, directeur du centre de rencontres de Besançon. L’IUFC collabore aussi avec les services régionaux del’État. À la demande du service régional del’emploi[10], de nouvelles formations sont organisées pour les anciens personnels de Lip après la fermeture de l’usine. L’IUFC organise des stages pour des jeunes en recherche de travail, pour des femmes en réinsertion professionnelle. En collaboration avec la région Franche-Comté et la délégation aux droits des femmes, des stages de réinsertion professionnelle sont organisés[11] pour les femmes à la recherche d’emploi dans des zones rurales désertifiées. Pour des publics précis, l’IUFC organise des formations, spécifiques et à temps plein, dans divers domaines : gestion d’entreprise, informatique de gestion, automatismes, qualité, gestion de production… Certaines thématiques, très demandées et reconnues, déboucheront sur de futures formations initiales. L’incidence financière est bénéfique pour tous : entreprises, services et laboratoires de recherche.
Dès l’automne 1976, l’IUFC ouvre une antenne à Belfort, dans les locaux de l’IUT. À la fin de l’année 1980, l’IUFC organise déjà des stages sur tout le territoire comtois : à Besançon, à Belfort, à Dole (antenne du CNAM), mais aussi à Luxeuil et à Lons-le-Saunier. Son chiffre d’affaires est de 4 437 248 francs[12].
Bien qu’elle figure parmi les plus petites universités du pays, l’université de Besançon est classée en 1978, selon une enquête du ministère de l’Éducation nationale, en troisième position pour sa formation continue. Cette enquête inclut aussi les enseignements mis en place par d’autres services de l’université, comme la capacité en droit par l’UER de droit et sciences économiques, la formation des personnels communaux par le centre universitaire régional d’études municipales (CUREM) et les formations du centre de linguistique appliquée (CLA). Dans son rapport d’activités de mars 1981, le président Jacques Robert souligne de nouveau la place originale de l’IUFC en France, notamment dans le domaine du contrôle qualité. Il dit avoir eu « le plaisir de constater à la commission de la formation continue de la conférence des présidents d’université que l’IUFC de Besançon est souvent cité comme un modèle de dynamisme »[13]. Persuadé que la formation continue est une des missions d’avenir de l’université, il demande au vice-président Jean-François Robert d’animer une commission de travail sur ce sujet.
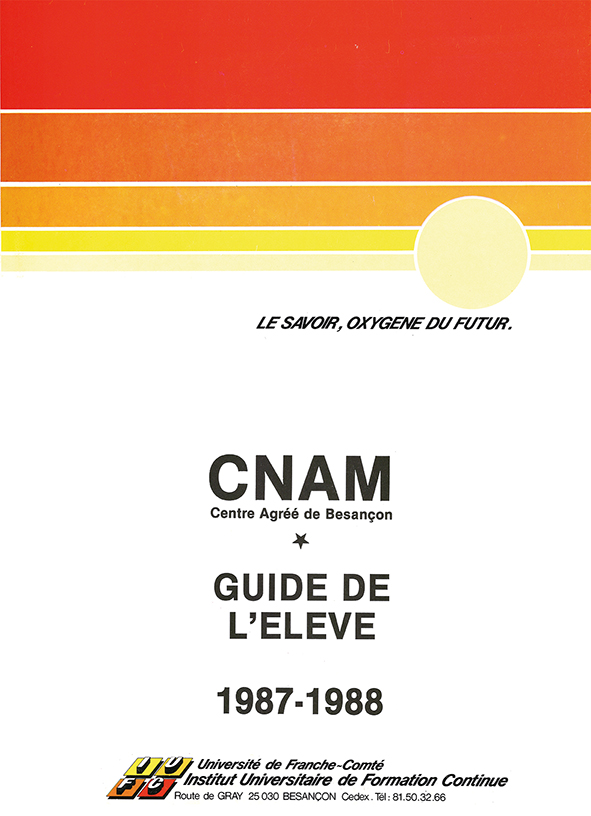
Dès ses premiers présidents, l’université de Franche-Comté marque également sa volonté d’accompagner ses personnels dans leur évolution professionnelle, au plus près de leur métier, avec la commission universitaire de la formation permanente. Les termes de formation « continue » ou « permanente[14] », longtemps utilisés indifféremment, désignent tout enseignement s’adressant à un public qui a quitté le système de la formation initiale. Ceci est renforcé par le fait que l’IUFC est l’opérateur[15] conjoint de ces deux champs d’actions. La réussite d’un stage de formation générale destiné aux personnels de catégorie D de l’université le 14 avril 1977 suscite la décision, aux mois de mai-juin suivants, du comité de la formation continue d’ouvrir des cycles de formation aux personnels, à la hauteur des crédits disponibles. Si, contrairement aux entreprises privées, l’État n’est pas tenu de verser 1 % de la masse salariale pour la formation continue de ses personnels, le conseil de l’université décide toutefois de prélever 1 % sur les contrats de recherche passés par les laboratoires afin d’alimenter ces actions de formation continue. Deux stages peuvent alors voir le jour[16]. Un premier, en avril, porte sur l’expression écrite et orale, grâce à des exercices d’improvisation orale et à la pratique des écrits professionnels (rapport, lettres administratives, notes de synthèse…). Un second, en octobre, propose une initiation à l’électricité. En 1980, sous la présidence de Pierre Lévêque, le service de la formation permanente des personnels dispose désormais d’un budget de 60 000 francs et apporte ainsi sa contribution à l’organisation de leurs stages[17].
En 1985, vingt-cinq ans après la création de l’IUFC, les effectifs sont passés de 50 à 600 stagiaires. L’IUFC comptabilise 1 400 inscriptions annuelles – sachant que les mêmes stagiaires peuvent s’inscrire à plusieurs matières ou unités de valeur. Si, au départ, des fonds spécifiques ont été attribués par l’État pour amorcer la création du service, et qu’il bénéficie du soutien du conseil régional de Franche-Comté, l’IUFC doit ensuite fonctionner en auto-financement. Alors que les dotations du ministère diminuent et que les deux IUT de Besançon-Vesoul et de Belfort-Montbéliard gèrent de manière autonome leurs propres diplômes universitaires de technologie pour adultes, l’université fait le choix de réorganiser le service pour mieux maîtriser la formation professionnelle.
Les directeurs successifs de la formation continue (1972-1986) : François Lhote (1972-1975), Maurice Colette (1975-1983), Pierre Maillard (1984-1986).