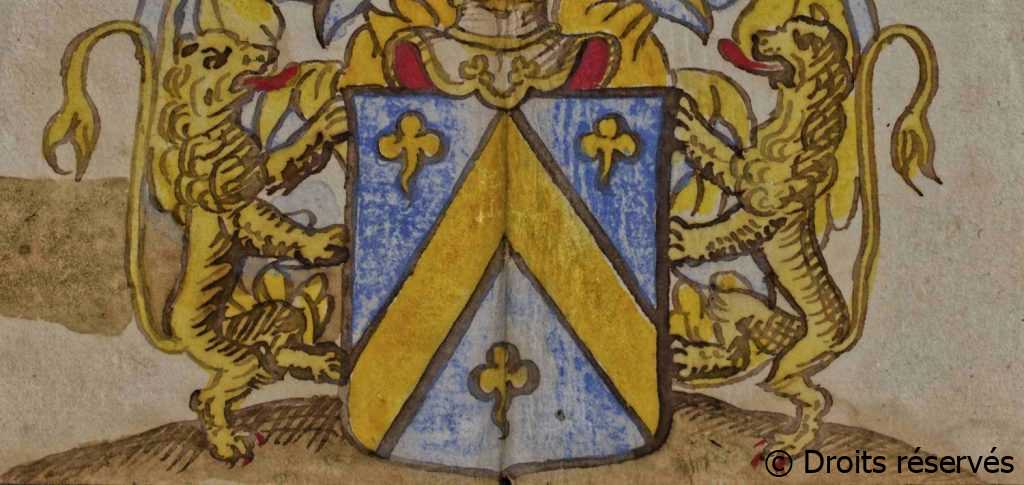Dénommée « université de Dole » à sa création en 1423, puis « université de Besançon » après son transfert par Louis XIV en 1691, l’établissement s’intitule « université de Franche-Comté » à l’automne 1970 pour mieux correspondre au territoire géographique régional qu’elle incarne.
Depuis le 1er janvier 2025, devenue « université Marie et Louis Pasteur », notre université vit une nouvelle mue.

Cet ouvrage se referme sur les six cents premières années de notre université. Le premier tome, portant sur la période dite « historique », entre 1423 et 1968, enjambait 545 ans. Ce second tome couvre, à lui seul, dix fois moins. Pourtant, la densité de son corpus, loin d’être exhaustive, démontre combien les temps récents, avec leurs successions de réformes et leurs dynamiques, ont apporté des bouleversements profonds dans l’enseignement supérieur et la recherche en France.
Cette aventure, narrée sous un tel format, demeure rare dans l’historiographie des universités françaises. La conception et la rédaction de ce second tome se sont efforcées de surmonter maintes difficultés, dans la mesure où fort peu de publications, retraçant l’éventail des sujets abordés d’une manière systémique, ont paru sur la période récente, à l’échelle régionale comme nationale. L’écriture de cette « histoire immédiate » s’est ainsi appuyée sur de multiples sources. Ont d’abord été exploitées des archives institutionnelles, réparties dans différents lieux de conservation : les archives nationales, départementales et municipales, les bibliothèques municipales, des bibliothèques universitaires ou encore les fonds administratifs de l’université. Ces recherches ont été complétées et recoupées avec des articles de la presse nationale ou régionale, mais surtout avec ceux des si précieux journaux internes de l’université.
Le défi enthousiasmant de ce récit collectif a été relevé par plus d’une centaine d’auteurs, auxquels il faut ajouter les très nombreux contributeurs qui n’ont pas hésité à se transformer en enquêteurs et à réaliser de véritables investigations, tant dans leur mémoire que dans celle de leur réseau d’anciens collègues, et, pour certains, dans leurs archives personnelles soigneusement préservées. Les récits oraux de ces témoins clés, anciens ou actuels, ayant vécu telle ou telle période, telle création ou refondation de service ou de laboratoire, sont ici sauvegardés. Les témoignages recueillis traduisent le fort attachement et la fierté d’appartenance d’une communauté à son établissement et en soulignent la richesse et la complexité. Que toutes et tous les passeurs de mémoire qui y ont participé en soient ici très sincèrement remerciés.
Misant sur l’intelligence collective, l’université produit chaque jour « des trésors du savoir » ; sa mission est de les partager avec le plus grand nombre, à commencer avec ses étudiantes et étudiants, mais aussi avec le public et les citoyens, au sens le plus large. Elle a aussi pour responsabilité d’en garder la trace. Le travail de mémoire permet la construction d’un avenir démocratique durable. À une époque où les technologiques numériques connaissent des évolutions fulgurantes, l’objectif de cet ouvrage est de retrouver les marques de l’histoire de l’université, afin de ne pas « l’oublier », de leur donner une certaine cohérence et d’ouvrir des pistes de références aux doctorants et aux futurs chercheurs…
Après des siècles de succès, de gloire, mais aussi de difficultés et souvent de crises, l’université poursuit ses mutations, résiliente, inventive et déterminée. Depuis six cents ans, sa communauté assure, avec responsabilité, ses missions de création, de transmission et de diffusion des savoirs, au service de tous.
Avec l’université Marie et Louis Pasteur qui en prend le relais aujourd’hui, s’ouvrent les nouvelles pages de cette histoire collective à écrire.