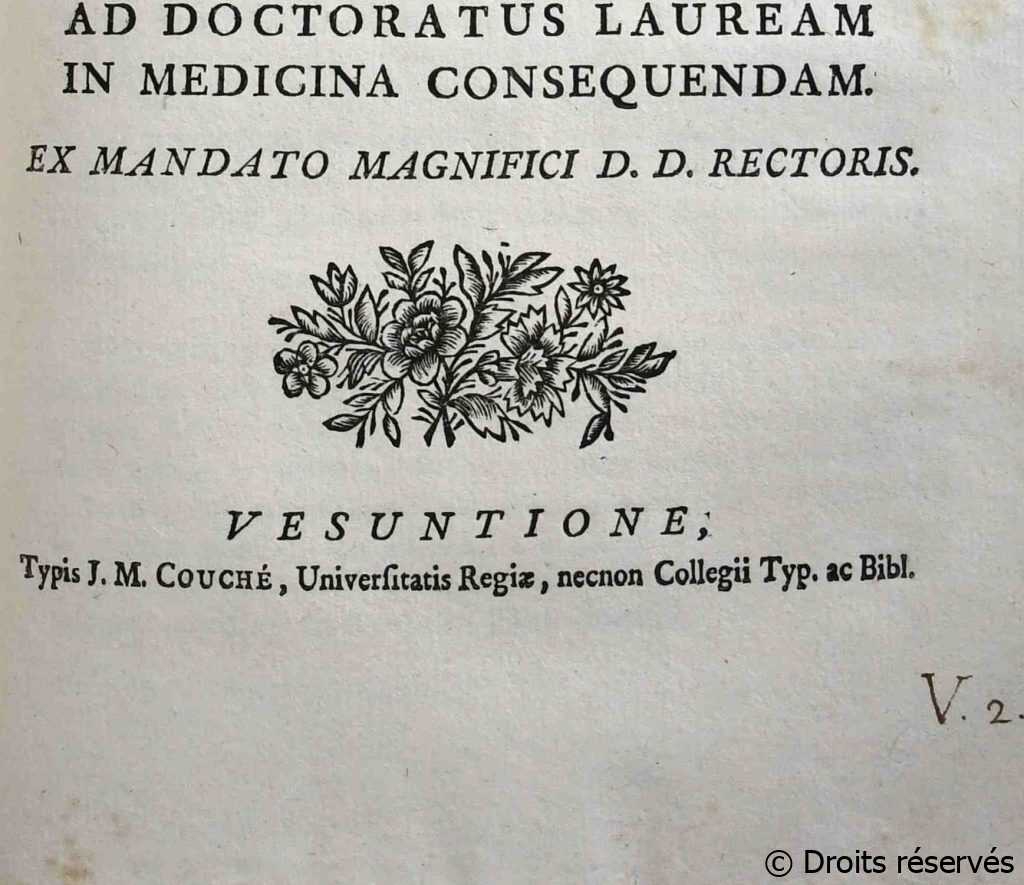En 2021, sous le mandat de Macha Woronoff, l’université réamorce sa politique, lancée en 2008, en matière de développement durable et de responsabilité sociétale (DD&RS). Dans cet objectif, en 2022, la présidente nomme Julien Montillaud[1] tout d’abord chargé de mission, puis vice-président chargé des transitions environnementales et sociétales. Un comité de pilotage est d’abord constitué, puis des référents écoresponsabilité sont nommés parmi les personnels de chaque composante, service commun et équipe de recherche. Une responsable DD&RS est recrutée pour animer et coordonner les projets.
Sous le pilotage actif de J. Montillaud, une première charte éco-responsabilité est rédigée (validée par le conseil d’administration du 25 mai 2022). Elle fixe huit objectifs stratégiques. Ce travail de fond aboutit à la feuille de route éco-responsabilité de l’UFC, validée en janvier 2024 par le CA. Celle-ci décline ces objectifs en 26 actions prioritaires et explicite leurs cibles, indicateurs et jalons. Elle permet d’établir un plan d’action, d’évaluer son avancée et de le communiquer à la communauté. Un modèle de cette charte écoresponsabilité est proposé aux unités de recherche, adaptable à leurs spécificités.
Un premier volet implique tout d’abord les personnels de l’établissement. Il concerne les différents aspects que peut revêtir la vie universitaire dans son fonctionnement, depuis les déplacements jusqu’à l’achat de matériel et de produits. Il préconise une politique d’achats responsables, avec une clause environnementale, devant s’inscrire dans les cahiers des charges de chaque marché. Les nouvelles modalités du guide des missions, régissant les déplacements professionnels des personnels de l’établissement, privilégient désormais les transports en commun ou, lorsque c’est possible, la visioconférence. Des dispositifs de covoiturage sont proposés[2] pour les réunions, les missions ou les trajets domicile-travail. Les personnels dont les missions le permettent peuvent bénéficier jusqu’à trois jours de télétravail par semaine, réduisant ainsi leur empreinte carbone. Dans le catalogue de la formation permanente 2024, des formations internes aux enjeux DD&RS sont proposées à l’intention du personnel.
Un autre volet concerne la sensibilisation et la formation des étudiants. L’objectif est de déployer, en premier cycle et pour toutes les filières, un module de socle commun obligatoire de 20 heures sur les enjeux, voies et moyens de la transition écologique. Cet enseignement, élaboré collégialement par une équipe d’enseignants et d’enseignants-chercheurs de toutes les composantes, est dispensé intégralement en présentiel par une équipe de plusieurs dizaines de collègues à près de 3 000 étudiants à partir de la rentrée 2024. Dès le printemps 2023, l’université de Franche-Comté propose six unités d’enseignement libres (UEL) pour développer l’engagement des étudiants dans la transition environnementale. Au programme, par exemple, des formations à l’animation de la fresque du climat, pour apprendre à décrypter les informations et à développer un esprit critique, la découverte du milieu associatif engagé dans la transition socio-environnementale ainsi que la possibilité d’assister à un cycle de conférences sur cette thématique.
D’autres volets s’intéressent, par exemple, au bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES) de l’établissement, à la réduction de la consommation d’eau, à la création de points de collecte et des filières de traitement des déchets recyclables ou valorisables ou encore à la réduction d’achat du nombre d’appareils électroniques neufs. Afin de préserver la biodiversité de ses sites, l’université s’est fixé deux objectifs. Tout d’abord, un inventaire régulier est réalisé pour établir un tableau de bord annuel de l’état de la biodiversité dans les campus et aussi d’évaluer l’impact des actions entreprises. Y participent le jardin botanique, le laboratoire Chrono-environnement, l’association des étudiants du Groupe naturaliste universitaire de Franche-Comté (GNUFC[JB1] )[3] et les personnels de l’UFR sciences et techniques (ST) et de l’UFR sciences techniques et gestion de l’industrie (STGI). Le second objectif veille à développer une gestion différenciée des espaces verts pour répondre au « plan national en faveur des insectes pollinisateurs 2021-2026 ». Il s’agit de privilégier une vision systémique, incluant des pratiques de gestion sans utilisation de produits phytosanitaires, en respectant les besoins des pollinisateurs sauvages, les ressources alimentaires et les espaces de nidification, incluant une implantation raisonnée de ruches d’abeilles domestiques. La pertinence des différents niveaux de gestion, comme l‘éco-pâturage, la fauche tardive ou la tonte classique, doit être évaluée selon les différentes zones identifiées afin de constituer en 2025 une charte définissant les principes généraux à respecter dans la gestion de ces espaces verts. Enfin, sur le terrain, maintes actions (conférences, expositions, événements) et projets, à l’initiative des composantes, des laboratoires et des associations étudiantes, complètent ces engagements quotidiens.