En 2011, Claude Condé définissait ainsi le doctorat : “Point d’aboutissement des études supérieures, le doctorat constitue un enjeu majeur pour l’établissement. Les doctorants sont non seulement les chercheurs et enseignants-chercheurs de demain mais aussi les acteurs de l’innovation industrielle culturelle et sociale[1].”
En effet, le doctorat, plus haut grade des formations universitaires au niveau mondial, est une référence internationale[2]. Après un DEA, diplôme d’études approfondies ou, à partir de 2004, après un master recherche (M2)[3], il se prépare en trois ans et représente une exigence de travail en recherche scientifique. À son issue, la soutenance d’une thèse forme la conclusion du doctorat et permet d’obtenir le grade de docteur.
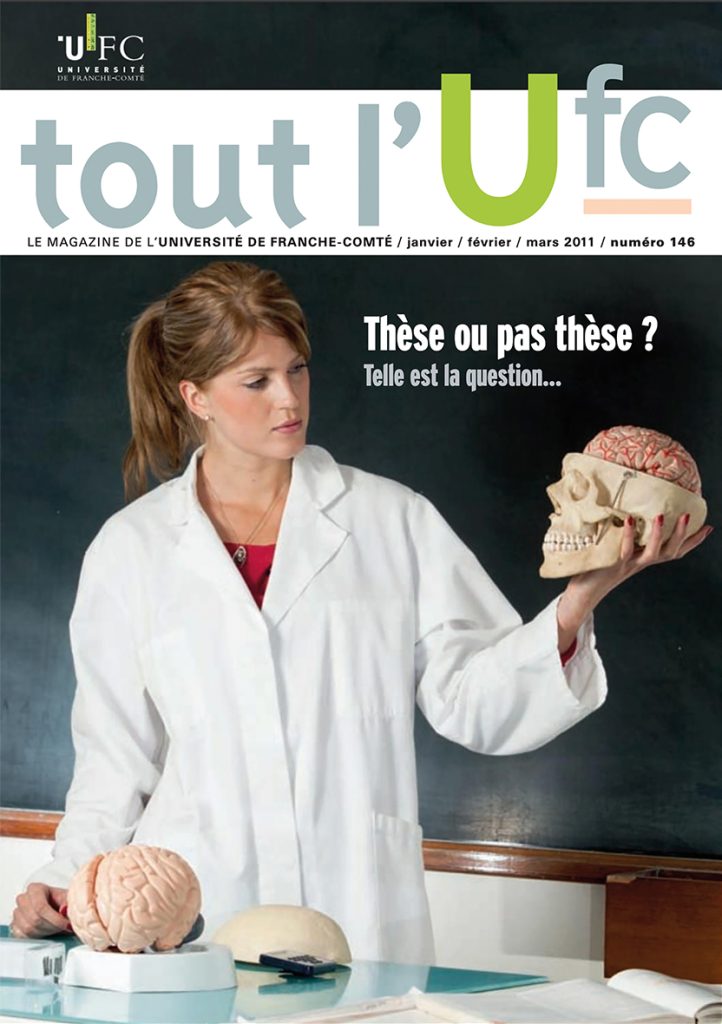
Un projet doctoral se construit autour d’un binôme doctorant-directeur de thèse (voire d’un co-directeur, parfois dans le cadre d’une cotutelle internationale), sur la base d’un projet de recherche s’intégrant dans les problématiques d’un laboratoire. Le doctorant doit prendre des initiatives, savoir argumenter face à ses pairs, rester ouvert au monde extérieur, se former dans des domaines transversaux tels que l’intégrité scientifique, la science ouverte, le management ou la communication, et ne pas perdre de vue la maturation de son parcours. Pour toutes ces raisons, le doctorat constitue indiscutablement une expérience professionnelle, qui va au-delà de la formation scientifique, et un élément de parcours personnel.
Différentes réformes ont modelé la thèse d’université. La loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, dite loi Savary, opère des transformations d’ampleur. Elle supprime la thèse d’État et la thèse de troisième cycle, remplacées par une thèse dite de « nouveau régime », ouvrant l’accès à de nouveaux corps de maîtres de conférences ou de chargés de recherche. Elle instaure l’habilitation à diriger des recherches (HDR), inspirée du modèle allemand, donnant accès aux corps des professeurs d’université ou des directeurs de recherche. L’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ouvre aux établissements publics, mais aussi à des établissements et des organismes privés (qui doivent être en association avec au moins un établissement public), le droit de créer une école doctorale en vue de délivrer un doctorat sous leurs noms et sceau. Mais l’arrêté du 25 mai 2016, fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, confère aux établissements publics le monopole de cette délivrance. Dès lors, s’affirme la conviction qu’il ne saurait y avoir de vraie recherche en dehors de l’université publique[4]. Pleinement intégrés dans la vie d’un laboratoire, les doctorants sont désormais considérés comme de jeunes chercheurs et non plus comme des étudiants[5].
Le décret du 23 avril 2009 réglemente le « contrat doctoral ». Le doctorant est alors salarié de l’université ou d’un organisme de recherche, théoriquement pour une durée de trois ans, avec pour mission principale la réalisation d’un travail de recherche. Parfois, les doctorants peuvent bénéficier du dispositif CIFRE, convention industrielle de formation par la recherche [6]. Une telle convention est passée entre une entreprise française (ou bien une collectivité ou une association), une unité de recherche et un futur doctorant, qui est embauché le temps de la convention par l’entreprise. Cette dernière bénéficie, en contrepartie, d’une aide substantielle de l’État[7], par le biais de l’agence nationale de la recherche technologique (ANRT).
En 2010, 991 doctorants sont inscrits dans les écoles doctorales de l’université de Franche-Comté, pouvant être encadrés par les 487 enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches : 163 thèses sont soutenues.
Durant leur thèse, les doctorants, contractuels ou non, ont la possibilité d’exercer des activités complémentaires rémunérées, autres que celles liées à la préparation de leur doctorat : enseignement, expertise, valorisation des résultats de recherche ou encore diffusion de l’information scientifique. La pratique de l’enseignement permet d’optimiser l’employabilité des doctorants dans le secteur universitaire. Dans ce cas, des enseignements de travaux pratiques (TP), de travaux dirigés (TD), voire de cours magistraux (CM), sont proposés selon les besoins de l’université et les attentes et compétences des doctorants. Bien que constituant une expérience intéressante, ces charges de cours ne donnent qu’une rémunération particulièrement modique et précaire, complément d’une activité principale (obligatoire, sauf pour les doctorants).
Le travail de doctorat intègre le doctorant au sein d’une équipe de recherche et d’une école doctorale qui veille au bon déroulement de sa thèse et lui propose des formations. En 2010, quatre écoles doctorales sont habilitées : sciences pour l’ingénieur et microtechniques (SPIM) ; langage, espace, temps, société (LETS) ; homme, environnement, santé (HES) et Louis Pasteur (LP)[8]. Composées chacune d’un directeur, éventuellement d’un directeur adjoint et d’un secrétaire, ces écoles doctorales mettent en application le cadre légal du doctorat et assure sa gestion administrative, la publication des soutenances, la préparation des jurys et elles autorisent les inscriptions et les réinscriptions.
Un bureau des écoles doctorales, rattaché à la vice-présidence du conseil scientifique est établi. Il définit chaque année les activités communes aux écoles doctorales de l’établissement. Il prépare les conventions de partenariat avec les autres établissements, notamment avec l’université de Bourgogne. Enfin, il travaille en collaboration avec les différents services de l’université concernés par l’activité des écoles doctorales[9]. Le service de la recherche à l’université assure le suivi des écoles doctorales pour réaliser leurs actions en matière de formations doctorales. Il coordonne les appels à projets pour le financement des contrats doctoraux, les aides à la mobilité et les séjours de recherche post-doctorale.
Le 14 juin 2014, les universités de Bourgogne et de Franche-Comté organisent pour la première fois, de manière conjointe, une remise officielle des diplômes de docteur, marquant ainsi de manière symbolique le rapprochement entre les deux établissements, qui s’opère à travers leurs écoles doctorales[10]. Cette cérémonie se poursuit au cours des années suivantes. Le 14 décembre, UBFC et son collège doctoral ont réuni une centaine de docteurs et leur famille sur les 350 docteurs diplômés de Bourgogne Franche-Comté, lors d’une cérémonie de prestige en leur honneur qui s’est tenue à la Rodia à Besançon.

Yves Petit.
Entre le 1er janvier 2017 et juillet 2024, UBFC (université Bourgogne Franche-Comté) est chargée de la définition et de la mise en œuvre de la formation doctorale des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la région BFC. Elle porte ainsi, à l’échelle de la communauté d’universités et établissements (COMUE), l’accréditation de six écoles doctorales thématiques : environnement-santé (ES) ; Carnot-Pasteur (CP), sciences pour l’ingénieur et microtechniques (SPIM) ; droit, gestion, économie et politique (DGEP) ; lettres, communication, langues, arts (LECLA) ; sociétés, espaces, pratiques, temps (SEPT). Ces six écoles doctorales sont structurées à l’échelle de la région Bourgogne Franche-Comté avec une direction et une direction adjointe. Le collège doctoral UBFC définit la politique doctorale en Bourgogne Franche-Comté et garantit sa qualité[11]. La formation doctorale transversale est gérée au niveau du collège alors que les formations disciplinaires le sont au niveau de chaque école doctorale. La mutualisation des formations par toutes les écoles doctorales a apporté une richesse dans les choix de formation et une augmentation des opportunités de formation pour les doctorants. La valorisation du doctorat a également été structurée à l’échelle du collège et des actions telles que les afterwork « voies des docteurs ».
Au total, en 2022, 346 thèses sont soutenues à l’échelle d’UBFC, dont 133 à l’université de Franche-Comté[12]. En 2023, le collège doctoral UBFC édite son enquête « Doctorat & Suivi de carrière des docteur.e.s UBFC »[13]. Fondée sur des données récoltées en 2021-2022, elle met en lumière l’évolution de carrière des docteurs de Bourgogne Franche-Comté avant, pendant et après leur doctorat.
Lors du conseil d’administration du 9 juillet 2024, la compétence doctorale est réintégrée dans les statuts de l’université de Franche-Comté (art. 6), faisant suite à l’arrêté du 12 juin 2024, accréditant l’université de Franche-Comté à délivrer ce diplôme national. Selon le nouveau schéma régional de l’enseignement supérieur en préfiguration, l’université de Franche-Comté reprend l’accréditation[14], précédemment conférée à la Comue UBFC, à délivrer le diplôme de doctorat et « l’habilitation à diriger des recherches » (HDR), dès la rentrée universitaire 2024-2025[15].
L’insertion professionnelle des jeunes docteurs est un enjeu majeur pour l’université, à la fois pour leur insertion professionnelle et pour la diffusion au sein du territoire des connaissances issues de la recherche. L’observatoire de la formation et de la vie étudiante publie régulièrement des enquêtes sur le devenir des docteurs par promotion, représentant des outils d’aide au pilotage. Lors du contrat 1996-1999, les doctorants bénéficient de journées consacrées à l’insertion professionnelle, « les doctoriales », avec l’appui du bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP), et de stages d’anglais scientifique, en collaboration avec le Centre de linguistique appliquée (CLA).
En 2013, l’université , soutenue par la région Franche-Comté, instaure le dispositif docteurs-entrepreneurs. L’objectif est d’inciter des étudiants, dès leur deuxième année de master (M2), à s’engager dans une recherche dont les résultats pourraient être valorisés par la création d’une entreprise innovante. En 2019, ce dispositif est modifié et étendu à un nombre plus grand de doctorants et postdoctorants, et s’intitule Itinéraire chercheur entrepreneur. Financé par la région Bourgogne Franche-Comté, il est conduit par le collège doctoral et en collaboration, selon le degré de maturité des projets, avec l’IAE de Franche-Comté (pour le volet formation), le PEPITE BFC[16] et DECA BFC[17] (pour le volet accompagnement). Ainsi, une dizaine de doctorants et de postdoctorants, sélectionnés chaque année sur la base du potentiel entrepreneurial de leur sujet de recherche, concilient un parcours recherche et formation, tout en bénéficiant d’un accompagnement à la création d’une future start-up. Les doctorants ont également pu rejoindre le diplôme d’université de l’IAE « entrepreneuriat et innovation »[18] délivré par l’université de Franche-Comté, qui aborde les différentes dimensions de la création d’une entreprise innovante de technologie.
Les associations de doctorants sont également très actives pour organiser les doctoriales et pour créer un réseau avec les milieux socio-économiques. Née en 1999, A’Doc, l’association des doctorants de Franche-Comté, a pour vocation de représenter la pluridisciplinarité de la recherche régionale. D’autres associations telles que les Students chapters au sein des écoles doctorales participent à l’animation scientifique et à la convivialité entre les doctorants. L’association nationale Bernard Grégory (APG) œuvre depuis des décennies pour le rapprochement entre docteurs et entreprises.
Différents prix récompensent les jeunes docteurs au cours des années. Mis en place en 2004, en concertation avec le conseil régional de Franche-Comté, le prix Jeune docteur de l’université de Franche-Comté récompense un jeune chercheur venant de soutenir sa thèse. Le lauréat peut bénéficier de la publication de ses travaux aux Presses universitaires de Franche-Comté (PUFC), ce qui représente une aide de 3 000 euros, plus 500 euros versés au lauréat pour mener à bien ce projet et assurer sa promotion[19]. Le prix A’Doc, destiné aux doctorants de Franche-Comté, créé en 2003, permet au doctorant lauréat de recevoir de 400 à 600 euros et de voir l’article qu’il a soumis publié dans un recueil aux PUFC, jusqu’en 2014.
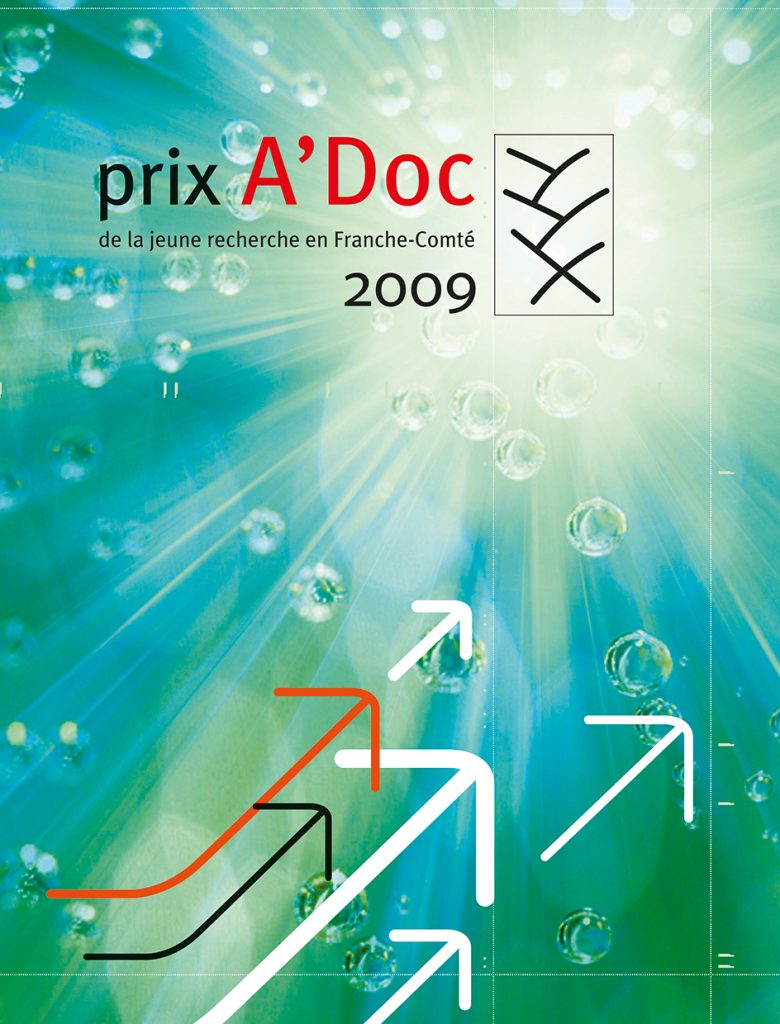
Université de Franche-Comté.
En 2014, le Forum des jeunes chercheurs est une manifestation scientifique annuelle qui permet aux doctorants de l’école doctorale Environnements-santé de Bourgogne Franche-Comté de présenter leurs travaux de thèse lors de sessions de communication orale ou par poster scientifique. En 2014 toujours, la Semaine des jeunes chercheurs concentre, en fin d’année, de nombreux évènements en faveur des docteurs et doctorants des universités de Bourgogne et de Franche-Comté : colloques, formations, séminaires, tables-rondes, ainsi que des cérémonies de remise de diplômes et de différents prix. L’Association française des femmes diplômées des universités (AFFDU) attribue trois bourses de 1 000 et 600 euros à trois jeunes femmes.
Le prix Pépite, créé cette année-là également, récompense les projets d’innovation sous toutes ses formes et est ouvert aux étudiants et doctorants. Il permet de récompenser plusieurs projets portés par des jeunes chercheurs dans des domaines variés, allant de la santé aux sciences humaines et sociales.
L’événement Ma thèse en 180 secondes (MT180), organisé par le CNRS et France Universités[20], s’adresse aux doctorants et aux jeunes docteurs (jusqu’à un an après la fin de la thèse). Ce concours international consiste à présenter son sujet de thèse en trois minutes sur scène. La recherche, mais aussi l’éloquence et la transmission du savoir sont au cœur du concours. Afin de donner toutes les chances de réussite à ses candidats, l’université de Franche-Comté et UBFC leur proposent une formation, confiée au service sciences, arts, culture. La journée de finale régionale se joue avec une représentation publique des dix candidats et se conclut sur la remise de trois prix : celui des lycéens, celui du public et celui du jury. S’ensuivent, si un candidat est lauréat, deux étapes, avec une finale nationale, puis une finale internationale.
Dans la même logique que celle de MT180, la première édition du challenge STARTHESE a lieu en 2024, en Bourgogne Franche-Comté. Ce prix récompense et met en valeur les projets d’innovation de jeunes chercheurs pourvus d’un fort impact environnemental et social.