Notre défi, au moment où nous parvenons à construire un enseignement supérieur réellement « massifié », est désormais de le « démocratiser », c’est-à-dire de lui assigner la mission républicaine de conduire chacun dans la voie de réussite où ses appétences et ses talents l’appellent, dans une démarche personnalisée et respectueuse du temps nécessaire à la maturation des vocations.
Telle était déjà l’affirmation d’un rapport parlementaire de 2015[1] rappelée, deux ans plus tard, par Gabriel Attal[2], rapporteur de la loi sur l’orientation en discussion à l’Assemblée nationale. Comment, en effet, accueillir de plus en plus d’étudiants, soit une augmentation de 23 % entre 2010 et 2017, avec des capacités d’accueil non extensibles, notamment dans les filières en tension que sont les activités physiques et sportives (STAPS), la psychologie et le droit ?
En 2009, face à une pression croissante des effectifs, le ministère met en place un portail d’admission post-bac (APB). Ce système, initialement conçu pour gérer des filières sélectives, notamment les écoles de commerce, les grandes écoles, les classes préparatoires, remplit d’abord bien son office. Mais, étendu à l’ensemble des admissions, l’outil s’avère de plus en plus inadapté puisque, lorsque les capacités d’accueil d’une filière non sélective sont atteintes, la plateforme régule par un tirage au sort. Ni les familles ni les lycéens ne peuvent admettre un système aussi contraire aux mérites et aux souhaits formulés et les recours se multiplient depuis 2016.
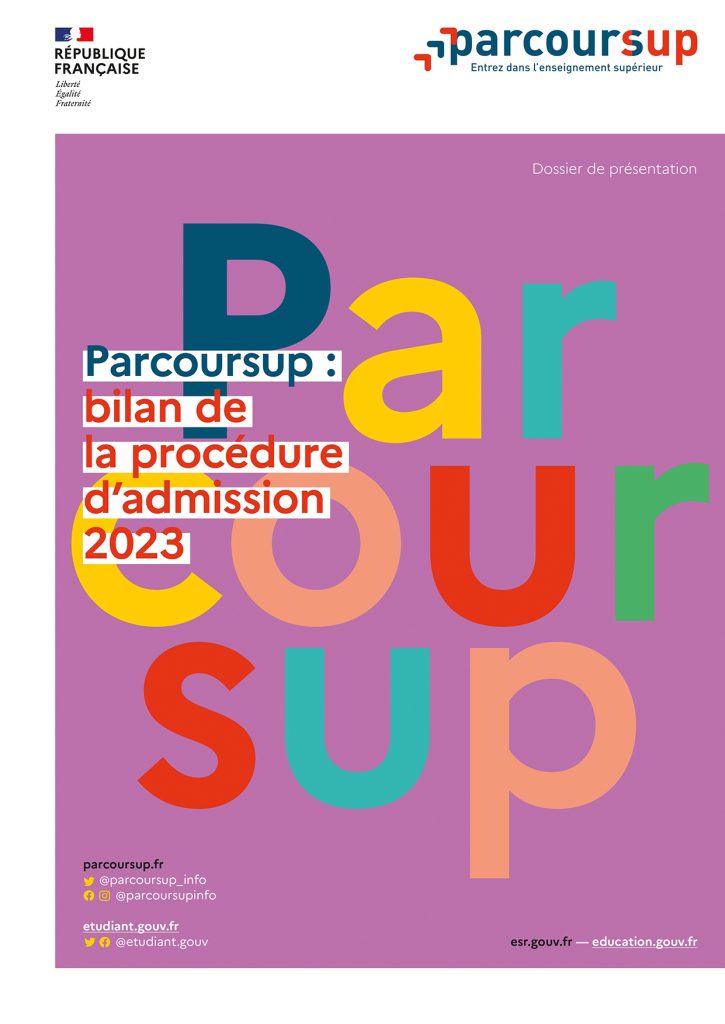
Or, plusieurs tribunaux administratifs constatent que la réglementation de l’orientation prévue par la loi LRU de 2007 (art. L. 612-3 du Code de l’éducation) n’avait jamais été prise et annulent, pour erreur de droit, la décision rectorale de refus d’inscription d’un candidat non tiré au sort. Autrement dit, le paramétrage de l’algorithme ne peut faire office de réglementation et le tirage au sort est dépourvu de fondement juridique. De plus, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pointe plusieurs irrégularités, au regard de la loi du 6 janvier 1978. Le traitement des données est entièrement automatisé, sans intervention humaine correctrice avant la décision, ce qui est interdit par son article 10, sans compter un manquement à l’obligation d’informer les personnes, ainsi qu’à celle de respecter le droit d’accès aux données traitées et aux modalités de ce traitement. Enfin, en 2016, l’association Droits des lycéens saisit la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir communication de la partie du code source d’APB concernant le traitement des filières non sélectives sous tension : le document fourni est inexploitable, ce qui révèle un manque flagrant de transparence.
Connues, ces difficultés prennent une nouvelle dimension au début de l’été 2017, lorsqu’il apparaît que près de 10 000 lycéens n’ont pas obtenu leur premier vœu qui concerne pourtant une filière non sélective[3] ! Le gouvernement, sous la pression des parents, mais aussi des injonctions de se mettre en conformité avec le droit formulé par le Conseil d’État et la Cour des comptes, ne peut plus reculer : le mécanisme d’affectation dans l’enseignement supérieur doit être réformé. Comme l’explique le rapporteur Gabriel Attal :
“C’est cette situation inacceptable qui a conduit le Président de la République à demander au Gouvernement de conduire une réforme tournée vers l’orientation et la réussite des étudiants dans le supérieur, avec une méthode qui est la marque de ce gouvernement et de cette majorité : la concertation, avec onze groupes de travail, cinquante-cinq réunions de l’ensemble des acteurs du supérieur et du secondaire, des centaines d’heures de travail. Vous êtes parvenue, Madame la ministre, à donner à cette pluralité d’acteurs la capacité de s’exprimer, et je veux une nouvelle fois vous féliciter pour cette concertation remarquable[4]”.
Une vaste concertation a donc été mise en place par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et dont le rapport du recteur de l’académie de Versailles, Daniel Filâtre, remis le 19 octobre 2017, rend compte[5]. Il faut impérativement donner la capacité aux lycéens de construire leur projet d’étude afin d’être maîtres de leur destin, ce qui implique une réflexion sur « un réel continuum entre le bac -3 et le bac +3 ». En conséquence, la ministre présente, le 30 octobre, un plan Étudiants, dont la loi ORE constitue le volet législatif. Débattu à compter du 22 novembre 2017, selon la procédure d’urgence, c’est-à-dire après une seule lecture dans chaque chambre, le projet est définitivement adopté le 15 février 2018. Déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, la loi est promulguée le 8 mars et publiée au JO le lendemain[6].
Le premier objectif est de garantir un processus d’affectation efficace et transparent pour la rentrée 2018, incluant une intervention humaine. La plateforme APB est, en conséquence, remplacée par Parcoursup.
Le lycéen saisit dix vœux, non forcément hiérarchisés, au lieu de vingt-quatre hiérarchisés. Il recevra une réponse sur chacun de ses souhaits et, en toute hypothèse, le recteur proposera une formation à tout bachelier, puisque le baccalauréat donne un droit général d’accès à l’enseignement supérieur.
Surtout, à la fois l’établissement d’origine et celui d’accueil se prononceront après examen du dossier. Les conseils de classe des premier et deuxième trimestres de terminale formuleront un avis consultatif sur le projet et les vœux de chaque lycéen, afin de l’éclairer dans sa décision. Deux professeurs principaux par classe l’accompagneront. L’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) est alors profondément rénové et, en terminale, deux semaines complètes sont consacrées à l’orientation. Si la culture de l’orientation doit imprégner la formation à partir de la seconde, la pédagogie à l’université a besoin d’évoluer profondément puisque le taux d’échec en licence en France est le plus élevé d’Europe[7].
Désormais, dans le supérieur, chaque étudiant, mis préalablement au courant des « attendus »[8], bénéficiera d’un « contrat de réussite pédagogique » qui sera une charte de suivi du projet personnel de l’étudiant et permettra à l’équipe pédagogique de s’assurer de la pertinence de ce projet en regard de ses aptitudes à suivre la filière retenue. Pourra alors lui être proposée une organisation de la formation articulée autour de sa progression personnelle plutôt qu’autour du parcours-type, nécessairement découpé en trois ans. Un directeur des études sera désigné dans chaque établissement, par champ disciplinaire, et sera chargé d’assurer le suivi de chaque contrat pédagogique[9].
L’autorité académique fixe, chaque année, les capacités d’accueil des formations de premier cycle en accord avec l’établissement, ainsi que le taux d’accès prioritaire des boursiers et des meilleurs bacheliers, par séries et spécialités, à l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public, y compris dans les formations dites sélectives. Tout étudiant a désormais droit, à n’importe quel moment de sa formation, à une année de césure.
Enfin, une bonne orientation ne se conçoit pas sans une importante augmentation des moyens. En tout, c’est une enveloppe de 950 millions d’euros qui sera engagée sur cinq ans.
Afin que l’étudiant accède aux soins comme n’importe quel assuré social, le régime étudiant de sécurité sociale est supprimé et la cotisation afférente de 217 euros disparaît. Les étudiants relèvent désormais du régime général. Une contribution unique, la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus), dont sont dispensés les boursiers, est instituée afin de favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants. Elle est versée au CROUS qui la redistribue aux établissements selon leurs effectifs étudiants.
Au cours des débats, Jean-Luc Mélenchon, député de La France Insoumise, n’a pas manqué de dénoncer le caractère libéral du texte :
De la loi Devaquet à la loi LRU, en passant par toutes sortes de fantaisies de cette nature, sous la houlette de l’Organisation de coopération et de développement économiques – OCDE –, qui n’a cessé de répéter qu’il fallait faire cette réforme, de la Commission européenne et de la stratégie de Lisbonne – pour ne citer qu’eux –, il n’est question que d’une chose en France – qui n’en veut pas – comme ailleurs : établir un marché de l’enseignement supérieur[10].
En revanche, aucune voix ne s’est élevée en faveur de la sélection. C’est une affaire entendue : l’entrée dans le supérieur non sélective est garantie alors même que les moyens humains et matériels manquent, sans parler du problème d’adaptation aux études supérieures de bacheliers dont le niveau peut être inférieur aux exigences universitaires. Même camouflée en « orientation », la question de la sélection demeure posée.
