« Mesdames, messieurs, dans le respect du pacte social qui lie notre pays à son université, dans le respect de ses traditions et de ses huit siècles d’histoire, la réforme que propose le gouvernement fait le pari de la liberté et de la responsabilité, qui sont les valeurs cardinales de notre projet politique. »[1]
Longtemps attendue ou au contraire redoutée, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (dite LRU) que s’apprête à faire voter en 2007[2] la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse (UMP), apparaît comme l’aboutissement d’un long processus finalement accepté. Dès 1987, le rapport Lesourne, « Éducation et société demain, à la recherche des vraies questions »[3], montrait clairement comment on pouvait aborder la réforme de l’université :
« Pour la réussite économique du pays, la compétitivité du système éducatif est aussi importante que celle des entreprises. Il faut sérieusement se demander s’il n’est pas indispensable d’accorder une large autonomie aux universités en les dotant d’exécutifs forts, en leur octroyant une réelle liberté dans l’affectation de leurs dépenses, en accroissant et diversifiant leurs ressources, en élargissant leurs marges de sélection des enseignants et en leur permettant d’octroyer des diplômes d’établissement garantis nationalement. Le corps professoral sera confronté à des problèmes d’évaluation, de différenciation, de rémunérations, d’échanges avec le CNRS, de permanence dans les postes. Les problèmes sont faciles à identifier mais difficiles à résoudre à cause de l’inquiétude des étudiants et de l’ambivalence des aspirations des enseignants ».
Mais le traumatisme provoqué par la mort de Malik Oussekine, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, à la suite d’une manifestation contre la loi Devaquet, est si profond qu’il empêche toute réforme d’aller à son terme durant vingt ans. Comment, d’ailleurs, réformer face à l’inquiétude de la jeunesse ? Flambée lycéenne en 1990[4], jacquerie étudiante en 1992, manifestations contre la tentative de révision de la loi Falloux en 1993 et, à l’automne, grogne de campus démunis face à l’afflux d’étudiants dont le nombre dépasse pour la première fois les deux millions : autant d’épisodes qui illustrent le malaise d’une classe d’âge qui craint pour son avenir[5]. Suivent la dénonciation du contrat d’insertion professionnelle, en 1994, avant la longue grève de l’automne 1995 : parties des IUT et des classes de BTS, les manifestations gagnent rapidement les universités, qui exigent des moyens. « Du blé, du blé, pour étudier ! » scandent les étudiants avant de rejoindre le vaste mouvement social suscité par le plan Juppé réformant la Sécurité sociale. C’est ensuite la longue cohabitation de 1997-2002 qui laisse la question universitaire en sommeil. Pourtant, le libéralisme marque des points et l’idée d’une telle réforme progresse.
Simplement, l’autonomie ne s’identifie plus à la sélection et à la fixation libre des droits d’inscription comme en 1986, mais suppose une nouvelle gouvernance couplée à un ébranlement du statut des universitaires. Tant le rapport Belloc de 2001 que sa traduction technique, le rapport Espéret de 2003, préconisent une individualisation des obligations de service[6]. Ainsi se dessine une logique de contractualisation et de différenciation entre enseignants-chercheurs, étrangère à la fonction publique – une logique qui passe par une culture d’évaluation[7] et une présidentialisation renforcée. En conséquence, au printemps 2003, le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche, Luc Ferry, annonce un projet de loi d’autonomie des universités déclinant les idées nouvelles : budget global, mutualisation des moyens, présidentialisation accentuée, création d’un conseil d’orientation stratégique composé de personnalités extérieures, conventions de partenariat avec les collectivités.
Mais, au même moment, les étudiants, eux, s’inquiètent de la mise en place du nouveau découpage des études « licence, master, doctorat » (LMD) alors que, par ailleurs, la réforme des retraites défendue par François Fillon est vivement contestée, notamment par les enseignants – pour ne pas mentionner le mécontentement provoqué par le projet de transfert aux collectivités territoriales de la gestion de certains personnels techniques de l’éducation. C’en est trop : au sein de l’UMP, des voix autorisées s’élèvent pour demander au ministre de différer son projet : la réforme est bonne, « mais il serait aventureux de la présenter dans un tel contexte »[8]. À l’automne, le climat de tension est relancé par le projet de Sciences Po Paris, qui s’apprête à majorer fortement les droits d’inscription, et les assurances données par le ministre de ne pas agir en ce sens n’y changent rien. De plus, entraînée dans un mouvement de contestation lancé par l’université de Rennes 2, la jeunesse dénonce un projet d’autonomie qui contiendrait, en germe, une privatisation de l’université. Tout à la crainte de réveiller les fantômes de 1986 et de 1995, le gouvernement fait savoir que « le projet de loi sur les universités n’est pas à l’ordre du jour. Ce n’est pas un élément tangible de réforme, ni annoncée ni inscrite dans un calendrier »[9]. Même en 2006, le traumatisme se laisse encore deviner : lors des débats sur la loi de programme sur la recherche, le secrétaire d’État, François Goulard, pressé par une partie de la majorité comme par la Cour des comptes de légiférer, dit que la loi de 1984 est une bonne loi qu’il est urgent… de ne pas modifier[10]. Il faut l’élection de Nicolas Sarkozy, qui s’était engagé sur l’autonomie, pour que la loi, dans le droit fil du projet de 2003, voit finalement le jour[11].
Le principe est toujours le même, à savoir la réforme des structures : le conseil d’administration est divisé par deux (30 membres), tout en comprenant plus de personnalités extérieures (7 ou 8). Son autorité sur les composantes et les personnels est renforcée afin d’affirmer son rôle de stratège. À la tête du conseil est porté un président choisi parmi les membres élus du CA pour quatre ans et dont le mandat est renouvelable une fois. Détenteur de l’autorité en matière de gestion et d’administration de l’université, il dispose d’un droit de regard sur toutes les affectations prononcées dans l’université. Porteur du projet d’établissement, il lui revient d’animer une équipe de direction cohérente : c’est un manager.
« Toutes les universités disposeront, au plus tard dans un délai de cinq ans, d’un bloc de responsabilités et de compétences élargies [RCE] en matière budgétaire (mise en place d’un budget global) et de gestion des ressources humaines (modulation des obligations de service, gestion des primes au niveau de l’université, possibilité de recruter des contractuels pour occuper des fonctions correspondant à des emplois de catégorie A, y compris des emplois d’enseignement et de recherche) ; la pleine propriété de leur patrimoine immobilier sera transférée aux universités qui en feront la demande ; les universités pourront créer des fondations sans personnalité morale dont la dotation sera facilitée par la mise en place de dispositifs fiscaux avantageux pour les particuliers et les entreprises, afin de favoriser le mécénat intellectuel »[12].
Le dispositif concerne également les étudiants qui « pourront choisir librement l’établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leurs études et bénéficieront d’une orientation active avec la mise en place d’une procédure de préinscription pour l’entrée en première année de l’université »[13]. La loi prévoit également que les universités puissent se regrouper après un vote à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d’administration et après approbation par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Les relations avec l’État sont réglées dans le cadre de contrats pluriannuels comportant un contrôle de légalité renforcé. Les diplômes doivent conserver leur caractère national et les droits d’inscription restent fixés par un arrêté ministériel[14]. On voit donc que les leçons de 1986 ont été retenues !
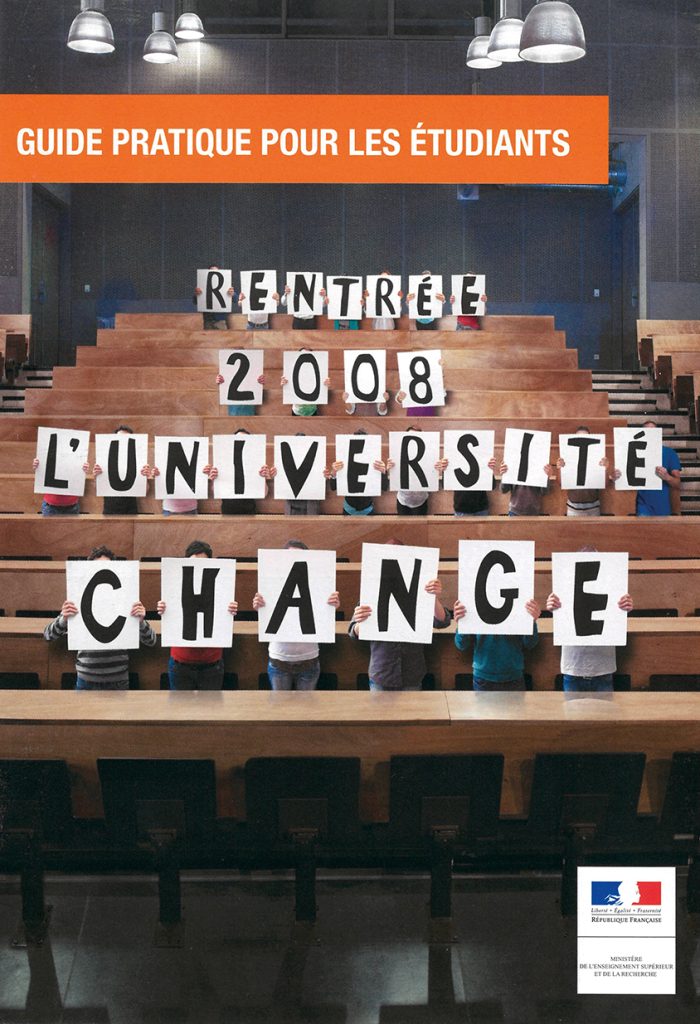
La loi présente cette particularité de renvoyer la question des études, de l’enseignement, des enseignants, à des « chantiers » que le budget pour 2008, et les lois de finances successives vraisemblablement, prendraient en compte.
« Ce projet de loi constitue le socle d’un projet ambitieux pour l’université, qui se construira par étape sur cinq piliers : la réussite en licence, l’amélioration des conditions de vie étudiante, la modernisation des conditions matérielles de l’exercice des missions de l’enseignement supérieur et de l’université ainsi que l’amélioration des carrières des personnels et de la condition des jeunes chercheurs et des enseignants-chercheurs. Ces chantiers trouveront leurs premières traductions dans le projet de loi de finances pour 2008 »[15].
Cette loi, qui rompt si profondément avec la logique de service public en ouvrant la porte au libéralisme, comme avec le droit de la fonction publique par l’accentuation de la contractualisation et de l’individualisation des carrières, n’a été que peu débattue. Elle arrive à son heure et sans doute est-il possible de dégager un certain nombre de facteurs d’évolution.
D’abord, le développement consensuel de la décentralisation a conduit à trouver naturel que les collectivités, pourvoyeuses de fonds, aient en face d’elles des universités autonomes dirigées par un exécutif clairement identifié. De même, le changement de procédure budgétaire entraîne nécessairement, pour les opérateurs de l’État que sont les universités, une autonomie nouvelle[16]. Le budget global, ensemble de programmes avec indicateurs de réalisation, amène déjà une mutation radicale de la gestion, y compris celle des ressources humaines. Citons aussi l’européanisation de l’enseignement supérieur et de la recherche qui, partout, transforme les structures. Plus largement encore, la réforme universitaire est le fruit d’une analyse économique ; la croissance viendra de l’innovation, ce qui exige une recherche puissante :
« Dans un contexte où les économies avancées n’ont plus d’autre choix pour demeurer compétitives que de bâtir une économie de la connaissance, selon les termes de la stratégie de Lisbonne, la qualité des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche devient un facteur majeur de différenciation : soit un moteur ayant pour effet de créer des avantages comparatifs propulsant l’économie nationale ; soit au contraire un frein, si les performances ne sont pas au niveau attendu »[17].
Enfin, on ne saurait passer sous silence le traumatisme causé par les classements internationaux, en particulier celui de Shangaï. Que ce soit en 2006 ou en 2007, le classement subjugue le débat. L’instrument n’est peut-être pas pertinent, mais il existe et, d’ailleurs, les universités sont les premières à l’utiliser. Remonter dans le classement, c’est enclencher le cercle vertueux du dynamisme et de la croissance. Grossir, être réactif, se regrouper en pôles, en réseaux : voilà ce qu’il conviendrait de faire et qui exige des partenaires libres et autonomes dans leurs stratégies. Une logique de projet remplace désormais l’ancienne logique de moyens, mais si l’université gérera avec plus de latitude une enveloppe pour partie liée à la performance, rien ne dit qu’elle obtiendra davantage[18]. Structurellement, la liberté reste corsetée, puisque ni la fixation des statuts ni les modalités du droit électoral n’ont été rendues aux établissements. D’ailleurs, le projet de loi ne devait être relatif qu’à l’autonomie des universités et ce n’est que sur un amendement sénatorial adopté in extremis que les libertés figurent dans le titre en sus des responsabilités ! Quant à la liberté de la recherche, elle peut se trouver limitée par le financement sur projets conduisant à une recherche plus subie que choisie et fortement administrée pour les besoins de l’évaluation. C’est d’ailleurs cette nécessité pour l’État de définir une stratégie nationale de recherche, plus que la seule alternance politique, qui amène à l’adoption de la loi Fioraso en 2013.
François Hollande, candidat socialiste à l’élection présidentielle de 2012, a posé une « priorité jeunesse » afin de démocratiser l’enseignement supérieur. Si la France a souscrit, lors du conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, à l’engagement d’amener la moitié d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur, engagement réitéré en 2005, force est de constater que l’objectif n’est alors toujours pas atteint : pas plus de 43 % accèdent au supérieur et seulement 28 % décrochent un diplôme de niveau « bac+3 ». Or, la loi LRU de 2007 a fragilisé les universités en ne leur donnant pas les moyens financiers d’une autonomie réelle et un certain nombre d’entre elles risquent la cessation de paiements[19]. La précarité étudiante a aussi largement progressé. Autrement dit, il faut plus d’étudiants, mieux formés et moins pauvres. Mais comment légiférer alors que depuis une dizaine d’années l’enseignement supérieur a été soumis à de multiples réformes et contraintes ?
Élu à la présidence de la République le 6 mai 2012, François Hollande appelle au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche la députée grenobloise Geneviève Fioraso (PS). Dès le 11 juillet, le gouvernement Ayrault annonce une vaste concertation en lançant des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le comité de pilotage, indépendant, est présidé par une scientifique de renommée internationale, Françoise Barré-Sinoussi, tandis que Vincent Berger, physicien, président de l’université Paris 7-Diderot, est nommé rapporteur. Enfin, le député Jean-Yves Le Déaut, biochimiste, professeur des universités, propose dans le rapport au Premier ministre une transcription législative et réglementaire des préconisations des Assises.
Cette démarche est une première en ce qu’elle associe l’enseignement et la recherche afin de redonner une cohérence à l’ensemble. En effet, jusqu’ici, les politiques ont été dissociées puisque la loi sur la recherche a été promulguée en 2006 et la loi Pécresse sur l’université (LRU) l’année suivante, ce qui correspondait d’ailleurs au découplage observé en Europe. La nécessité de bâtir, dans le cadre de la nouvelle économie de la connaissance, un modèle capable de concurrencer le standard anglo-saxon a été affirmée dès 1998 lors de la conférence de la Sorbonne, mais ensuite on a eu une homogénéisation du cursus des études, le LMD (licence-master-doctorat), amorcé à Bologne en 1999, concernant 47 États, tandis que les conseils européens de Lisbonne en 2000 et de Barcelone en 2002 visaient à faire de l’Union européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive à l’horizon 2010. Autrement dit, les réformes ont été « désordonnées et contradictoires »[20] et le résultat n’est pas à la hauteur des espérances.
En conséquence, le projet de loi élaboré sur le fondement du rapport des Assises[21] et présenté en Conseil des ministres le 20 mars 2013, en réunissant enseignement et recherche, rend à l’État sa fonction de stratège. Il apporte ainsi « une contribution décisive, de moyen et de long terme, au redressement nationalfondé sur la connaissance, centré sur l’université et s’appuyant sur les grands organismes publics de recherche »[22]. Une stratégie nationale de l’enseignement supérieur comportant une programmation pluriannuelle de moyens doit être élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement, de même pour la recherche sous la responsabilité, ici, du ministre de la Recherche. Cette double programmation bâtie en parallèle est rattachée au Premier ministre, structurée par le programme des investissements d’avenir et devra être articulée au cadre régional.
Cette réorganisation appelle une évaluation indépendante et transparente : une nouvelle autorité administrative indépendante, le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) remplace l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), créée par la loi de 2006[23] et fortement critiquée au cours des Assises. De même, le Conseil stratégique de la recherche, chargé de proposer les grandes orientations de la stratégie nationale de la recherche et de participer à l’évaluation de leur mise en œuvre, remplace le Haut conseil de la science et de la technologie.
Si la loi de 2006 est retouchée s’agissant de la coordination de la recherche et de l’enseignement, elle l’est aussi à propos des regroupements d’établissements : les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) ainsi que les établissements publics de coopération scientifique sont supprimés. Autrement dit, les regroupements d’établissements sont plus que jamais au programme, mais selon un nouveau périmètre, voire selon le même, renommé… On ose à peine rappeler que la loi nouvelle vise à stabiliser un système malmené par une multiplicité de réformes successives afin que l’autonomie soit réelle et non formelle ! L’offre de formation et la recherche doivent être coordonnées sur un territoire qui peut être académique ou interacadémique, la coordination étant organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur « relevant du seul ministre de l’enseignement supérieur ». Autrement dit, l’université est au centre et coordonne un regroupement qui peut prendre une triple forme : soit une fusion, soit la participation à une communauté d’universités et d’établissements (COMUE), soit l’association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le nouvel ensemble a donc une forme confédérale ou fédérale[24]. Un seul contrat d’établissement sera conclu entre l’État et les structures regroupées.
Cette nouvelle loi de juillet 2013[25] offre l’occasion, non pas de rompre avec l’orientation antérieure de présidentialisation de l’université, mais là encore d’apporter une correction de degré, non de nature. Il convient d’avoir une « gouvernance rénovée et plus démocratique ». Comme le dit le rapport sénatorial : « Il est essentiel que les membres du conseil d’administration de l’université se comportent en véritables administrateurs, chargés des choix stratégiques, du pilotage et du budget de l’établissement, et non en représentants de telle composante ou discipline, accaparés par des questions techniques, de gestion quotidienne de l’établissement ou catégorielle »[26].
Les anciens conseils, conseil scientifique et conseil des études et de la vie étudiante, sont transformés en commission recherche et en commission formation ; réunies, elles constituent le conseil académique, dont les attributions ne sont plus seulement consultatives, mais décisionnelles dès lors qu’il n’y a pas d’incidence financière. Par ailleurs, les modalités électorales sont modifiées afin de réduire la prime majoritaire attribuée dans chacun des collèges de représentants d’enseignants-chercheurs[27]. En parallèle, la composition du conseil d’administration est à nouveau modifiée en augmentant le nombre de membres de 24 à 36, contre 20 à 30 auparavant, tandis que les personnalités extérieures, qui étaient 7 ou 8, seront 8, autrement dit cette catégorie est proportionnellement affaiblie.
Il reste à ne pas oublier ce qui devait être au cœur de la loi, à savoir la condition étudiante, particulièrement dégradée à en croire un constat partagé par les parlementaires quelle que soit leur appartenance politique. Or, force est de constater qu’il s’agit d’une occasion perdue. Face à la multiplication des licences, l’État n’habilite plus les formations, mais accrédite les établissements qui doivent respecter un référentiel national des diplômes. Le cycle de la licence permet à tout étudiant d’être accompagné « dans l’identification et dans la constitution d’un projet personnel et professionnel, sur la base d’un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d’une spécialisation progressive des études »[28]. Pour le reste, la loi Fioraso ne traite pas des conditions de vie étudiante et renvoie à un ensemble de mesures qui interviendront ultérieurement, ce qui explique le constat formulé en fin de quinquennat par Le Monde sous le titre « François Hollande et l’université : une action manquée », observant que : « À l’heure du bilan, le président de la priorité jeunesse concentre les déceptions à l’université, faute de lignes claires dans les réformes »[29]. Que dire à l’issue de cette nouvelle séquence législative qui n’a mobilisé qu’une poignée de députés lors des débats et a abouti après une seule lecture dans chacune des chambres puisque l’urgence avait été déclarée, si ce n’est que la réforme est permanente tout en étant indifférenciée politiquement et toujours à reprendre…