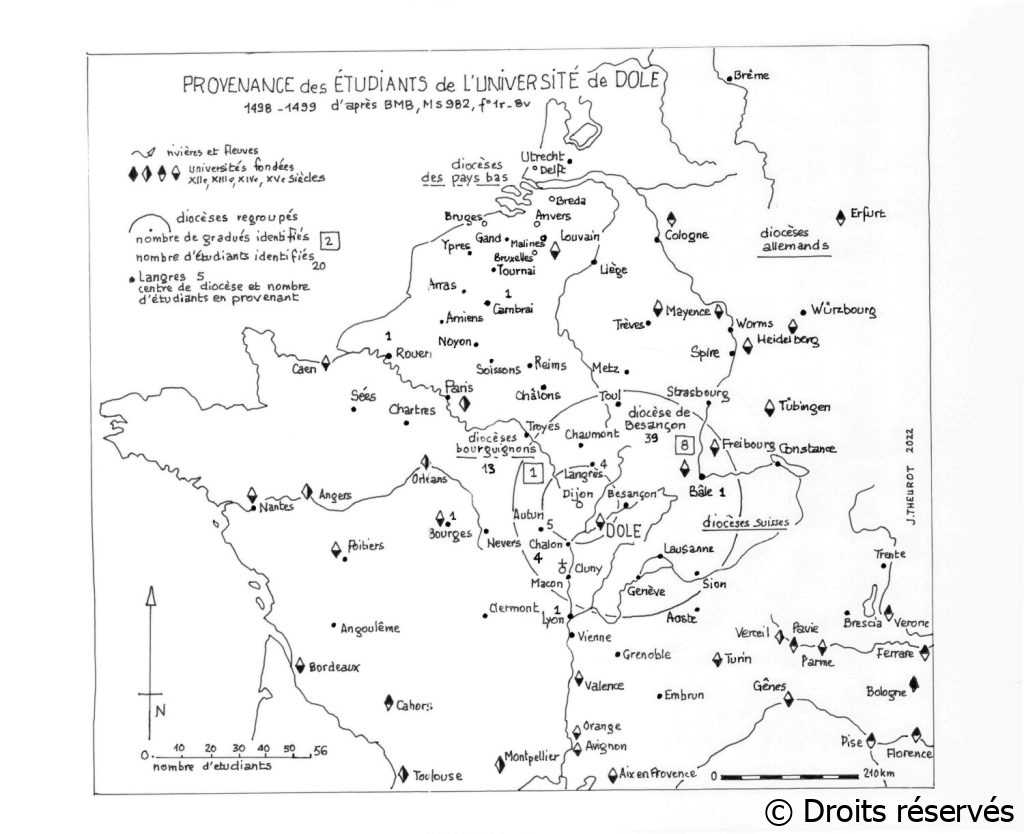Au Centre de linguistique appliquée de l’université de Franche-Comté, l’approche en communication active s’oriente autour de l’oralité et s’est transmise comme un formidable héritage qui, de plus, s’est enrichi au fil de soixante ans d’action des équipes et de la valeur-ajoutée de leur parcours personnel.
Régine Llorca, spécialiste de la linguistique-phonétique[1], mène depuis de nombreuses années une double vie : auteur-comédienne et danseuse de flamenco / maître de conférences au CLA. Elle cultive cette double facette depuis toujours, ne pouvant se résoudre à choisir l’une ou l’autre[2]. Du rythme dans la danse et dans le corps, elle s’intéresse au rythme dans la parole, dans l’équipe d’Elisabeth Lhôte, directrice du Laboratoire de phonétique de l’UFC et directrice du CLA, qui oriente les étudiants vers le « paysage sonore » des langues.
Jacques Montredon[3], qui analyse la communication gestuelle dans les langues, encadre son post-doctorat à Brisbane en Australie, lui suggérant une application pratique. Il propose alors à Régine Llorca d’allier ses deux talents, à savoir utiliser le mouvement et le rythme pour enseigner la phonétique du FLE aux étudiants. Et c’est une révélation car Régine s’empare des mots, les fait siens avec son corps et montre l’importance dans notre langue de tout ce qui ne s’écrit pas : l’intonation, la gestuelle, l’expressivité, l’utilisation de la voix, le rythme, la musique de la langue. Cette méthode inédite est un succès.
De retour en France, elle approfondit son approche si originale au CLA de Besançon. Elle participe à l’émission « Parlez-moi » sur la Cinquième chaîne, conçoit et réalise des supports pédagogiques télévisuels et vidéos pour TV5 monde. Avec les étudiants et les professeurs en formation, elle crée les « Ritmimots » et le « théâtre rythmique ». Elle s’appuie sur le principe suivant : quand on s’exprime en français, on bouge sur les syllabes accentuées, « la voix se voit » : « un accent, un mouvement ». Les Français ont tendance à « bouger français ». Lorsqu’ils parlent une langue étrangère, ils mettent toujours les gestes et l’accent sur la dernière syllabe, c’est souvent à cette façon de bouger qu’on les repère. C’est ainsi un bon indicateur pour des apprenants en FLE : s’approprier la langue avec le corps, c’est entrer dans son articulation et dans sa grammaire, en découvrant un moyen formidable de créativité.
Dans son spectacle « Ma parole, elle danse !», Régine Llorca jongle avec les mots et l’intonation pour amener avec humour des situations d’incompréhension, de double-sens.

Yves Petit.
Pour Régine LLorca, le français est une langue ambiguë qui peut engendrer de nombreux quiproquos. Le spectacle lui permet de grossir le trait pour créer de drôles de situations.
En conjuguant ses réflexions avec l’intérêt pour tout ce qui est audiovisuel et vidéo, le pas est vite franchi. Régine Llorca imagine une web-série, intitulée « Drôle de langue ». Ces vidéos pédagogiques et humoristiques[4] mettent en scène des phénomènes et des curiosités de la langue française ou d’autres langues. Une partie est réalisée au CLA, avec ses propres étudiants et des collègues. Enfin, le CLA permet à Régine LLorca de collaborer avec des spécialistes d’audiovisuel et d’informatique pour concevoir une plateforme web de jeux et exercices sur l’oralité – briques sonores, puzzles audiovisuels, harmonisations son-image… – pour observer, toujours dans l’humour, le rôle de l’intonation et la variabilité de la prononciation dans une langue.
Le numérique ouvre un nouveau terrain de jeu pour la créativité des équipes travaillant autour de l’oralité. Utiliser la mémoire auditive et sensorielle pour apprendre une langue, passer par la musique, le théâtre et la chanson, c’est un expérience inoubliable, plébiscitée chaque année par tous les stagiaires. La communication active reste au cœur de la démarche d’apprentissage du CLA.