Le renouveau de la recherche en philosophie à Besançon après la seconde guerre mondiale est porté par la fondation, en 1959, du Centre de documentation et de bibliographie philosophique. Le philosophe Gaston Berger, spécialiste de Husserl et ancien résistant, est alors, au ministère, directeur général de l’enseignement supérieur et cherche à faire émerger de nouveaux centres de recherche. Il repère le travail mené sur la bibliographie philosophique par Gilbert Varet[1] et crée le CDBP, qui s’inscrit alors dans le projet de Bibliographie de la philosophie lancé en 1909 par l’Institut international de philosophie.
Besançon devient un centre de collecte et d’analyse des publications philosophiques, de production de bibliographies et indices[2] et de réflexion sur le référencement des savoirs. Le livre issu de la thèse de Robert Damien, Bibliothèque et État[3], place la question de la classification des livres au fondement de la raison politique. Au XXIe siècle, cet héritage est transformé grâce à la création, par Thierry Martin, du « système d’information en philosophie des sciences ». La bibliographie philosophique entre dans l’ère numérique et participative, inscrivant le partage des métadonnées et des notices enrichies dans l’ère de la science ouverte.
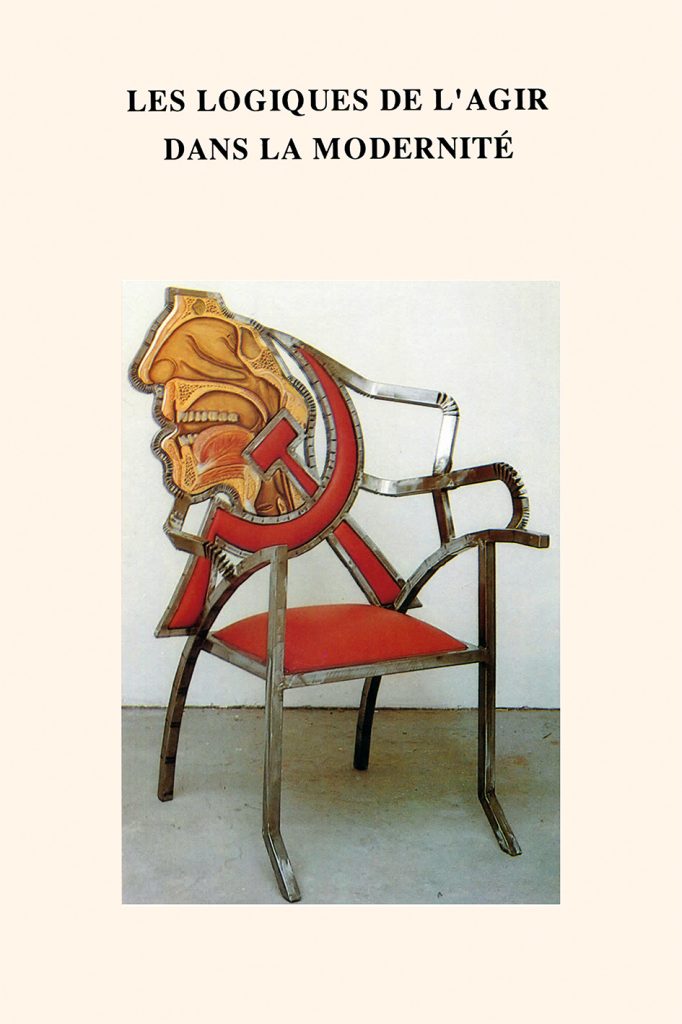
En 1991, André Tosel crée l’unité de recherche qui s’appelle aujourd’hui Logiques de l’agir et qui comprend en son sein le CDBP. Elle se consacre alors à renouveler la philosophie de l’action collective et la philosophie des pratiques. L’originalité des recherches menées par cette équipe consiste dans l’hypothèse que le sens de nos pratiques ne s’éclaire que si on les considère à travers de multiples prismes, ceux de la philosophie politique et sociale, des sciences humaines, aussi bien que ceux de l’ontologie, de la philosophie des sciences et des techniques, sans séparer les phénomènes du présent de leur inscription dans le temps long. L’équipe nourrit en retour une nouvelle approche de l’histoire de la philosophie à partir de la considération des pratiques, comme le livre de Jean-Pierre Cotten sur Victor Cousin[4] en donne l’exemple en 1992.
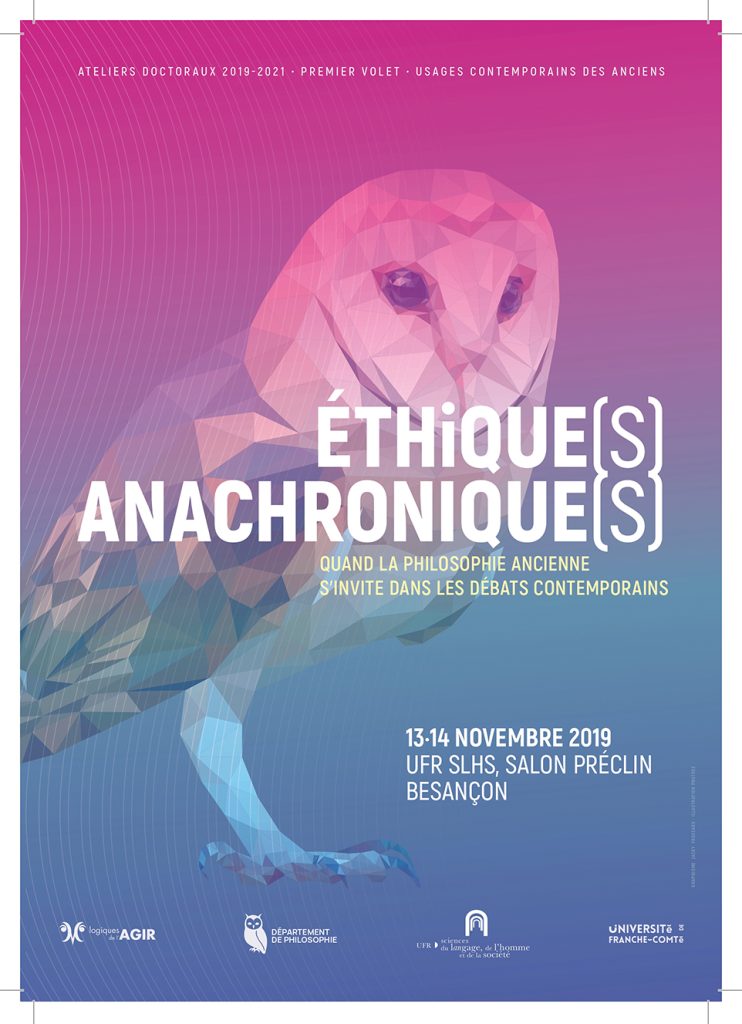

Aujourd’hui, forte de l’afflux d’une nouvelle génération de collègues et de doctorants, l’équipe enrichit cette réflexion de nouveaux objets et de nouvelles interrogations, sans oublier de valoriser le patrimoine philosophique bisontin, terre de naissance de la philosophie sociale française, avec Fourier et Proudhon[5].