Les budgets des universités sont une source continuelle de préoccupations pour les communautés universitaires. En témoignent les luttes incessantes des universités pour négocier des moyens, des postes et des locaux supplémentaires, et cela tout au long des cinquante dernières années. Leurs difficultés à assurer leur mission de service public se sont amplifiées avec l’augmentation rapide des effectifs étudiants. De manière récurrente, l’insuffisance des montants accordés au regard des missions confiées est soulevée lors des CA, donnant lieu le plus souvent à des motions, alors que des réformes successives transforment profondément l’approche financière de leurs budgets.
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF)[1], appliquée au 1er janvier 2006 à l’université de Franche-Comté, modifie la construction du budget de l’État et son suivi. Elle introduit un modèle managérial de gestion par la performance en donnant plus d’autonomie aux décideurs locaux dans le choix d’affectation de la ressource financière, en échange d’une responsabilité accrue. Chaque politique publique se voit allouer des crédits et des objectifs assortis d’indicateurs. Pour l’université, ils s’appliquent à 2 des 34 programmes composant le budget général de l’État : enseignement supérieur / recherche et vie étudiante. Ils se décomposent en 15 actions définies visant, en particulier, les trois niveaux du LMD, les bibliothèques, les différents types de recherche, la diffusion des savoirs, l’immobilier ainsi que le pilotage du programme. Pour chacune d’elles, les établissements doivent définir des objectifs et des indicateurs nécessitant un important travail en amont : définir les actions qui seront retenues, les objectifs spécifiques et un certain nombre d’indicateurs pour les mesurer. Ce dossier de mise en œuvre de la LOLF à l’UFC est confié à Jean-Luc Rossignol, chargé de mission LOLF, et à Elisabeth Flénet, chargée de mission système d’information. L’ensemble des indicateurs retenus s’inscrivent dans le projet annuel de performance (PAP), document publié en décembre avec le budget initial, dans lequel l’université fixe ses objectifs pour l’exercice à venir.
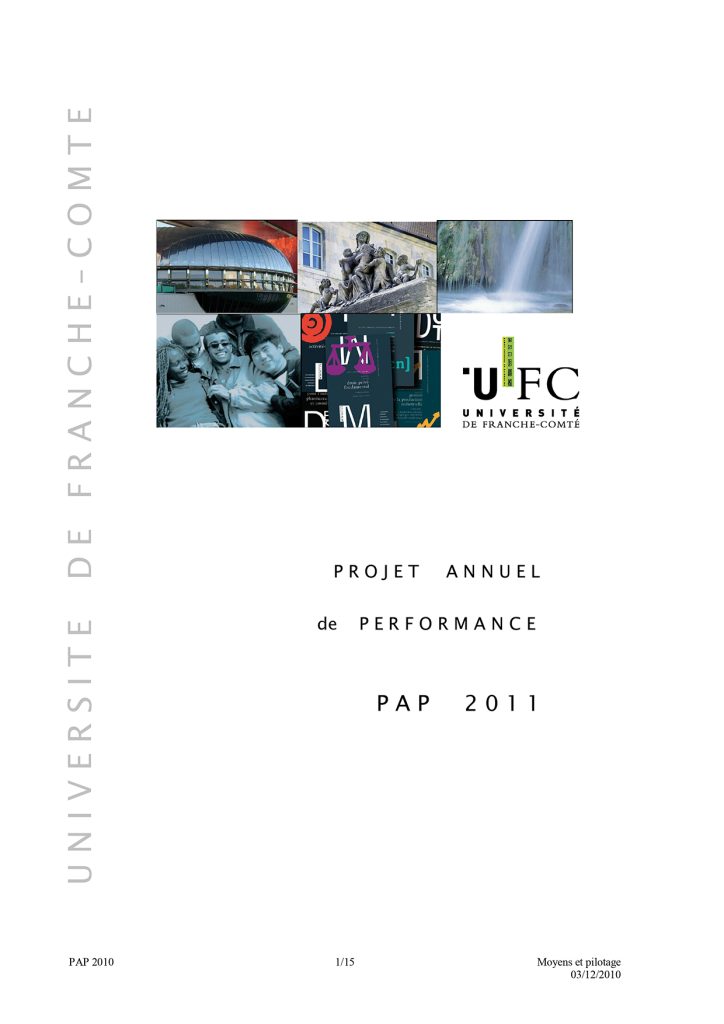
L’année suivante, l’établissement doit produire avec le compte financier un rapport annuel de performance (RAP) pour mesurer si ces objectifs ont été atteints, évaluer l’écart éventuel et préparer le nouveau PAP. L’allocation des crédits de l’année n+1 sera alors théoriquement subordonnée à l’analyse des résultats réalisés dans chaque programme de l’année n-1. Par souci de transparence, les résultats de l’analyse des informations recueillies sont également publiés, principalement sous forme de dossiers dans le journal interne tout l’U.
Le 1er janvier 2010, sous le mandat de Claude Condé, l’université de Franche-Comté, comme 33 autres universités en France, bascule aux Responsabilités et compétences élargies (RCE)[2] qui résultent de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités (LRU).
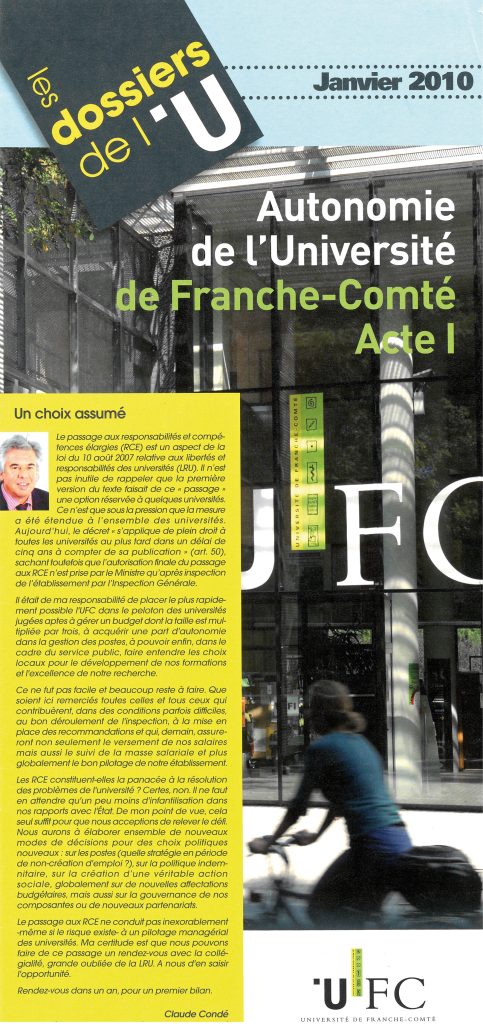
Désormais, l’université va gérer directement la part de son budget consacrée aux dépenses de la masse salariale et détient plus de liberté dans les choix relatifs aux ressources humaines. Le budget devient global pour la dotation de l’État, distinguant trois grandes enveloppes de crédit : la masse salariale, le fonctionnement et l’investissement. Seule l’enveloppe des personnels, pour les postes relevant de l’État, ne peut être abondée par les deux autres : on parle de « fongibilité asymétrique ». Cette gestion renouvelée des ressources humaines engendre une responsabilité totale de la structure des emplois, imposant le respect du plafond d’emplois[3] et d’une masse salariale fixés par l’État. L’intégration de la masse salariale des personnels titulaires a un impact sur les services de l’université, des ressources humaines aux services financiers et comptables. Avant le passage aux RCE, en 2009, l’université gérait un budget de 51,263 M€. Le budget 2010, le premier intégrant les traductions financières du passage à l’autonomie, s’élève à 195,3 M€, soit un triplement. Pour surveiller cette autonomie accrue, l’État se donne des moyens appropriés qui impliquent, au niveau des établissements, d’établir un contrôle interne financier et comptable fiable. De plus, les comptes annuels de l’université doivent faire l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes. Enfin, le recteur, chancelier des universités, assure le contrôle renforcé du budget de l’université.
Ce processus RCE change profondément le pilotage de l’établissement : la méthode de travail s’inscrit désormais en mode projet, qui impose de disposer de données robustes. À l’université de Franche-Comté, ces transitions structurelles importantes sont portées par les deux vice-présidents Joël Berger (budget) et Jean-Luc Rossignol (ressources humaines). L’université acquiert de nouveaux logiciels informatiques pour anticiper cette étape, tel Jefyco pour optimiser le pilotage du budget avec les composantes, et, en corollaire, se dote d’un système de gestion de la paie Winpaie. Dans le cadre de la certification des comptes de l’État, la Cour des comptes recommande aux opérateurs de l’État, dont les universités, de se doter d’un dispositif de contrôle interne financier (CIF). À l’université de Franche-Comté, le dispositif CIF se déploie à partir de 2011. Dans une approche globale, il permet de mettre en place, de manière complémentaire, des interactions régulières effectuées lors d’un double contrôle interne, à la fois comptable et budgétaire, dans l’objectif de sécuriser la qualité comptable et la soutenabilité budgétaire de l’établissement.
à la suite de la LOLF, le gouvernement a pour ambition d’impulser une stratégie globale des finances publiques en intégrant les engagements européens en la matière. À cet effet, la réforme de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP[4]) est mise en œuvre à partir du 1er janvier 2016 dans les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche. Visant à moderniser la gestion publique, elle a notamment pour objectif d’améliorer le pilotage budgétaire des opérateurs de l’État[5]. Les équipes de gouvernance des universités doivent disposer des moyens de construire un budget qui reflète la stratégie de leur entité, d’inscrire les prévisions budgétaires dans une perspective pluriannuelle et de pouvoir mesurer la soutenabilité de la politique menée. Au sein des universités, la GBCP accélère la modernisation de la gestion en promouvant l’instauration de dispositifs qui, pour certains, existaient déjà : les services facturiers se développent, associés à la dématérialisation des pièces ; des centres de services partagés prennent en charge des opérations qui font désormais appel à un fort niveau d’expertise, pour le compte de plusieurs unités (composantes, laboratoires). Cette réforme réaffirme le principe de séparation entre l’ordonnateur, responsable de la stratégie et du pilotage, et l’agent comptable, responsable des comptabilités. Révisé en 2018, sous une forme simplifiée, le nouveau décret a la particularité de clarifier la définition de la comptabilité publique avec notamment une comptabilité générale, une comptabilité budgétaire et une comptabilité analytique. En mars 2021, le « Vade-mecum du contrôle interne financier » précise les étapes de la démarche de maîtrise des risques financiers et les leviers permettant de la structurer et de la pérenniser. Il développe en outre les principes pour réaliser les outils de pilotage tels que les cartographies des risques et les plans d’actions.
La réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, prévue par l’ordonnance du 24 mars 2022, vise à rechercher les responsabilités financières de l’ensemble de l’exécution budgétaire. Guidée par des enjeux démocratiques importants, cette réforme entend renforcer l’exemplarité et la probité des décideurs publics, ainsi que la transparence des finances publiques. Sans remettre en cause le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, ce texte prévoit un régime unifié de responsabilité financière pour les comptables publics et les agents publics, mettant fin à la responsabilité pécuniaire personnelle des comptables publics. Ce nouveau régime de sanctions, basé sur la combinaison de la faute grave et d’un préjudice financier, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Les agents comptables
Selon le décret modifié n° 98-408 du 27 mai 1998 : « L’agent comptable est nommé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et du budget, sur proposition du président de l’établissement intéressé ». Il est choisi sur une liste d’aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il exerce « les fonctions de chef du service de la comptabilité de l’établissement », mais peut aussi être chargé, « sur décision du président de l’université », de celles de « chef des services financiers de l’établissement ». Comme le secrétaire général, l’agent-comptable participe avec voix consultative au conseil d’administration et aux autres instances de l’établissement (article L. 953-2, dernier alinéa, du code de l’éducation).
Les agents comptables successifs de l’université de Franche-Comté :
Anne-Marie Commerçon (1971), Dominique Dichamp (1983, intérim), Marie-Aimée Ladgé (1983), Dominique Dichamp (1984, intérim), Anne-Marie Sourd (1984), Philippe Petit (1997), André Jurine (2002), Colette Lesage (2004, intérim), Gilles Moiton (2005), Guy Lorenzelli (2015), Miguel Ortiz (2021), Karine Saby-Laudijois (2023)
Les responsables des services financiers successifs de l’université de Franche-Comté :
Marie-Paule Vuez (1971), Pascaline Nicolas (1994), Patrick Lefèvre (1997), Catherine Delabre (intérim, 2003), Christophe de Casteljau (2004), Philippe Caussin (2007), Thierry Blond (2016), Cristina Busquet-Parets (2018), Fatima Ansri (2021).