Une université n’est pas seulement une institution créant et dispensant des savoirs et des diplômes. C’est aussi une communauté qui partage des énergies et des idées sur de multiples activités. Dès leur origine, la vie associative est intense à l’université, mais particulièrement depuis les quarante dernières années, où très tôt, près de 80 associations sont présentes dans des registres variés. Elles apportent un complément essentiel à la formation des étudiants, une ouverture indispensable sur leur environnement et participent à une meilleure intégration à l’université.
Parmi ces nombreuses associations, certaines d’entre elles[1] sont labellisées par l’université et bénéficient de subventions annuelles. Ce budget, complété par d’autres aides du Crous et des collectivités, leur permet de recruter, pour leur fonctionnement, des professionnels permanents salariés. La charte des associations labellisées, une fois signée avec l’université, leur ouvre le bénéfice d’une adresse électronique, d’une boîte aux lettres, d’un espace sur le serveur web de l’université, de locaux pour les réunions à la maison des étudiants et un accompagnement par le bureau de la vie étudiante au montage de projets, à la structuration de l’association et à la formation de ses bénévoles.
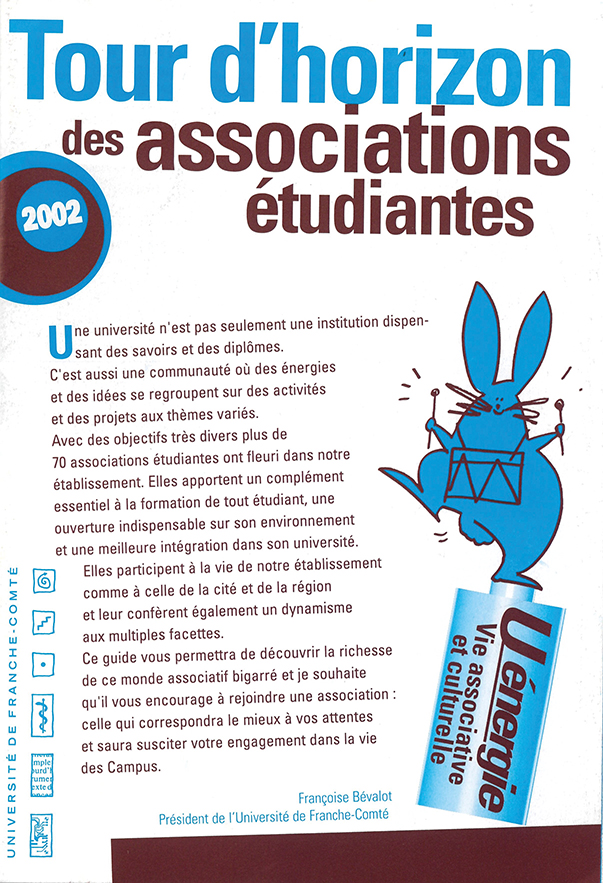
Jean-Michel Mourey.
Les associations étudiantes sont les actrices de la vie des campus. Pour la plupart, elles regroupent les étudiants, actuels et anciens, d’un diplôme ou d’une filière précise – souvent sous l’appellation de bureau des étudiants (BDE). Certaines ont un but humanitaire (notamment dans les filières de la santé ou paramédicales), altruiste, solidaire ou même ludique, d’autres promeuvent l’écologie, la culture, le sport ou défendent les intérêts des étudiants-usagers au quotidien. Des associations rassemblent des étudiants d’un même pays ou territoire ; l’Erasmus Student Network (ESN) accueille les étudiants internationaux. Certaines associations s’adressent à la fois aux étudiants et aux personnels de l’université, comme le TUFC (Théâtre universitaire de Franche-Comté), l’orchestre universitaire de Besançon ou la chorale universitaire.
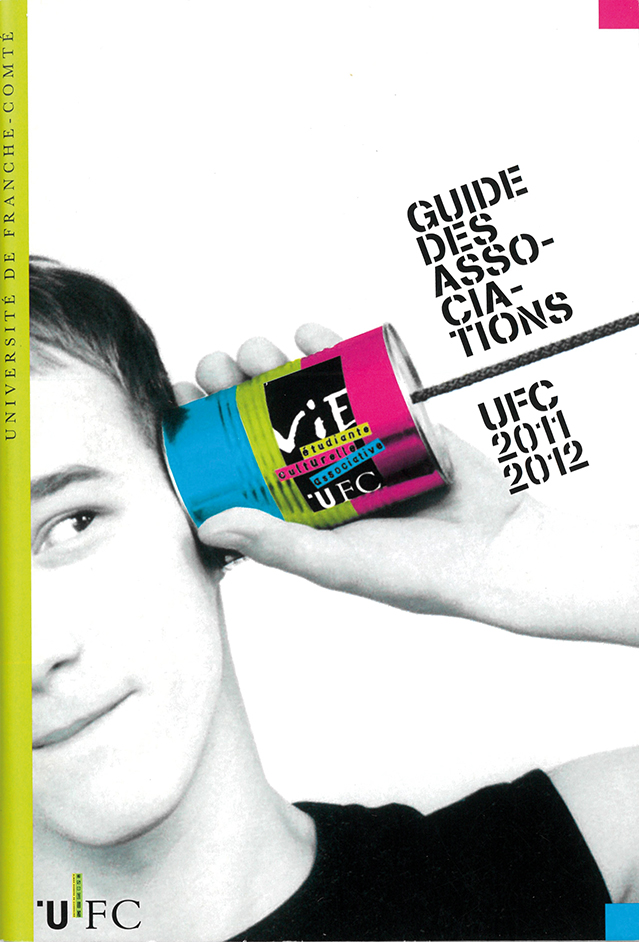
Catherine Bouteiller .
Afin d’accompagner ces étudiants qui s’engagent, l’université de Franche-Comté et le Crous ont mis en place précocement des commissions pour apporter une aide financière à la réalisation de leurs projets. Dès juin 1999, sous le mandat de Claude Oytana, un fonds d’amélioration de la vie étudiante (FAVE) finance des projets à vocation culturelle ou ayant pour objectif d’animer le campus. À titre d’exemples, les associations qui en bénéficient, cette année-là, sont la fédération des associations belfortaines (FABE) dans le domaine du sport, l’association GENEPI qui intervient en milieu carcéral auprès des détenus, l’amicale des étudiants sénégalais, une association de l’IUT GEA (gestion administrative et commerciale) pour un tournoi de basket et un voyage à Prague, la ligue universitaire d’improvisation théâtrale (LUDI), l’orchestre universitaire, ainsi que des actions de culture musicale sur différents sites.
En affichant une volonté commune d’encourager la vie associative et culturelle dans les campus, l’université et le Crous offrent à chaque étudiant la possibilité de transformer son parcours universitaire en une étape formatrice, intégratrice et conviviale. Également, depuis 1999, un guichet unique, une première en France, est mis en place : les fonds du FAVE (université) et ceux du dispositif culture action (Crous) sont mis en commun et les deux institutions décident dans une même commission des projets à soutenir. En 2000, ce fonds permet la réalisation d’une quarantaine de projets.
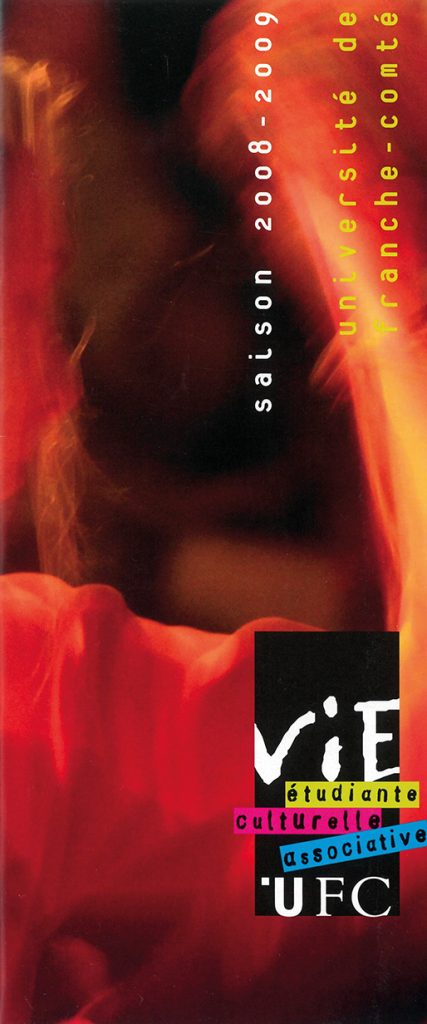
En 2001, le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche met en place le fonds de soutien et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE), qui prend le relais du FAVE, toujours en accord avec culture action du Crous. Le FSDIE est alimenté par une partie des droits d’inscription[2] payés chaque année par l’étudiant. En 2005, par exemple, 25 projets en bénéficient. La politique d’attribution du FSDIE aux associations leur permet de développer des initiatives, notamment par la création d’un statut d’« association institutionnelle » donnant accès au financement de la totalité des projets annuels en un seul dépôt lorsque ceux-ci se poursuivent depuis plusieurs années.
Créée par la loi du 8 mars 2018, dite ORE, relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) dynamise la vie étudiante en apportant une aide significative et en permettant un dialogue de tous les acteurs. Mise en place depuis la rentrée 2018-2019, elle a pour objectif de soutenir l’amélioration des conditions de vie dans les campus et de favoriser la réussite. Les sommes sont collectées par les Crous, en amont de l’inscription, auprès de tous les étudiants en formation initiale[3] dans un établissement d’enseignement supérieur et au bénéfice de tous les étudiants. Une partie est reversée aux établissements, une autre est conservée par le Crous pour financer des projets de vie de campus et mettre en place des actions d’amélioration de la vie étudiante. La CVEC concrétise l’engagement pris dans le « plan étudiants » de 2017 destiné à améliorer les conditions de vie des étudiants pour favoriser leur réussite, tout en diminuant pour eux le coût de la rentrée dès 2018. En effet, la création de la CVEC s’accompagne de la disparition de la cotisation pour la sécurité sociale étudiante et de la baisse de 21 € des droits d’inscription à l’université. En 2022, par exemple, la contribution à la CVEC représente un coût de 95 euros par étudiant[4]. Au total, à l’échelle nationale, ce sont près de 150 millions d’euros qui sont répartis entre les Crous et les établissements d’enseignement supérieur, soit 4,5 millions d’euros à l’échelle régionale en Bourgogne-Franche-Comté[5]. En complément, la région Bourgogne Franche-Comté apporte des aides substantielles sous forme d’appels à projet annuels, pouvant compléter les apports CVEC. Trois possibilités existent : le soutien aux initiatives des associations étudiantes, la vie étudiante et les équipements pédagogiques et numériques. Selon le dispositif retenu, des financements sont accordés à hauteur de 50 à 80 %.
Ces différents financements ont permis la réalisation de très nombreux projets dans les différents campus au fil des années, redynamisant des espaces de vie ou dotant des espaces d’apprentissage d’équipements numériques performants. Par exemple, des aménagements d’installations sportives en extérieur sont en libre accès à l’(S)pace Jenny d’Héricourt à Besançon, d’autres locaux créés sont affectés à la vie étudiante, comme les salles de coworking dans les bibliothèques universitaires, à la maison des étudiants, dans les UFR et IUT, au CLA… Le service de la vie étudiante propose des formations aux étudiants pour apprendre à créer une association, à organiser un évènement, à faire des demandes de subventions, ou même à préparer une action de solidarité internationale. Dès l’année 2000, la liste des associations paraît dans le journal interne tout l’U. En 2011, paraît un guide recensant 75 associations universitaires.
La gestion de la vie étudiante n’est pas distincte au départ des activités du SCUIO-IP[6], service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle. Au niveau institutionnel, en 2003, lors du mandat de Françoise Bévalot, une direction de la formation et de la vie étudiante est créée. Rattaché à Éric Prédine, vice-président de la commission des formations et de la vie universitaire (CEVU), elle est confiée à Philippe Caussin. Un des deux volets[7] concerne notamment la coordination des différents services universitaires liés à la vie étudiante, dont le SCUIO et le service culturel. La mention de « service vie associative et culturelle » n’apparaît sur l’organigramme qu’en 2004 et est rattaché à Chantal Jeanningros, responsable du SCUIO. C’est en 2005 que le service vie étudiante est réellement identifié, Anne-Cécile Klur en est nommée responsable, mais assumecette fonction depuis plusieurs années. Elle organise de nombreuses actions pour donner corps à ce service, en particulier pour la culture, avec des expositions dans la nouvelle maison des étudiants de la Bouloie, créée cette même année. Elle met également en œuvre, avec le SCUIO, la manifestation « Bienvenue aux étudiants ». En 2007, Émilie Parisot poursuit activement cette mission, le service s’intitule alors vie étudiante, culturelle et associative. Il est à nouveau intégré administrativement au service d’information et d’insertion professionnelle (S2IE, ex-SCUIO). Des livrets sont produits pour informer les étudiants des activités associatives et culturelles dans les campus.
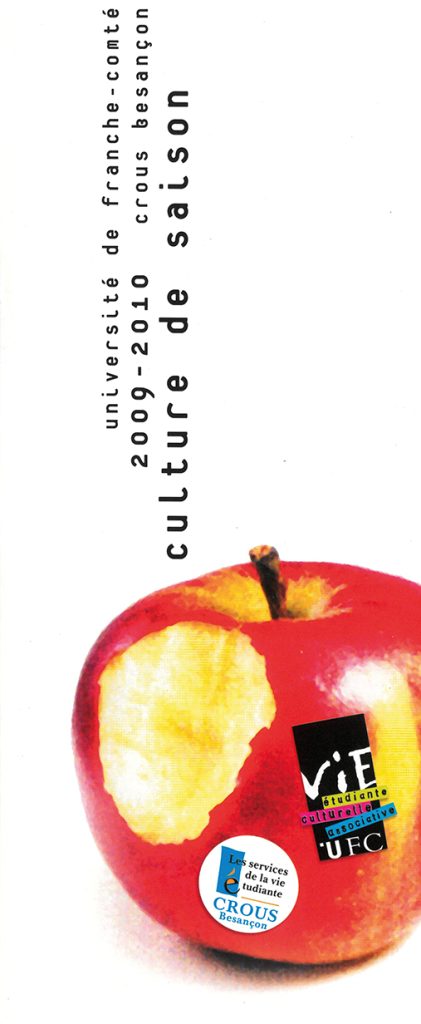
De juillet 2009 à août 2016, le service se renforce avec Anne Forno, chargée de la communication et de la vie étudiante.
Son autonomie prend forme en 2013. Désormais, un bureau de la vie étudiante (BVE)[8]a vocation à aider les étudiants dans leurs projets personnels et associatifs, tout en contribuant à l’animation des campus. Piloté par le vice-président Frédéric Muyard (formation initiale, continue et apprentissage) et aidé dans ses missions par les vice-présidents étudiants Thibaut Steinmetz et Clémentine Lab, le BVE est dirigé par Damien Guilbaudeau. Sa mission se consacre aux étudiants et à la vie dans les campus. À ce titre, il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique « vie étudiante » de l’établissement en développant la culture de l’engagement de l’étudiant dans toutes ses dimensions, par la réalisation des projets et initiatives individuelles et associatives hors cursus. L’équipe administrative du BVE est localisée à la maison des étudiants, au campus de la Bouloie, proche des services du Crous, avec qui il conduit ses missions en étroite concertation. Avec lui, il gère également l’utilisation des fonds du FSDIE (financé par la CVEC), de la CVEC et des appels à projets de la région BFC. En janvier 2015, sous le mandat de Jacques Bahi, F. Muyard, et T. Steinmetz confirment et élargissent les activités du service[9]. L’objectif est d’offrir aux étudiants un interlocuteur unique pour tout ce qui concerne leur vie « hors cursus » et de permettre le développement de projets d’envergure. Les activités du BVE s’élargissent à la coordination avec les autres champs de la vie étudiante : santé, handicap, sport… Le BVE devient un point d’entrée unique, orientant les étudiants, selon leurs besoins, vers les différents services universitaires concernés ou les mettant en relation avec les partenaires concernés, et tout particulièrement le Crous.
Au cours des années, l’université a amélioré les capacités d’action de son BVE, en créant plusieurs postes, affectés à l’accompagnement des étudiants en situation particulière, au travail avec les associations et au développement des initiatives de vie étudiante dans les campus délocalisés. Le BVE pilote à chaque rentrée universitaire les journées d’accueil « Bienvenue aux étudiants », qui ont pris une ampleur considérable.