Comme l’exprime Claude Oytana[1] en 1997 : “La recherche est l’une des grandes missions de l’université, il s’agit alors pour elle de participer à l’élaboration et à l’évolution des connaissances et de faire bénéficier ses étudiants d’une formation vivante et à la pointe du progrès ; celle-ci est aussi le moyen le plus évident et l’un des plus efficaces de concrétiser la volonté qu’elle a d’accroître autant que faire se peut son ouverture sur tous les milieux socio-économiques”.
La recherche rend l’enseignement supérieur qualitatif : les universités sont des lieux où les enseignants-chercheurs créent et transmettent le savoir le plus actuel. L’esprit critique et le doute sont des questionnements quotidiens qui permettent sans cesse une évolution des concepts.
Initialement, chaque faculté possédait ses propres laboratoires de recherche. Comme l’explique Pierre Verschueren[2], les premiers laboratoires sont des laboratoires de chaire, qui s’appuient sur des professeurs renommés, comme Pierre-Michel Duffieux (1891-1976), professeur d’optique à la faculté des sciences, ou Jules Haag (1882-1953), professeur de chronométrie, Lucien Lerat (1909-1993) en histoire de l’art ou Jacques-Pierre Millotte en archéologie (1920-2002), pour n’en citer que quelques-uns…
Autour des années 1960, la hausse des recrutements des enseignants-chercheurs et des assistants pour répondre à l’afflux d’étudiants apporte un renouveau épistémologique. De nouvelles disciplines s’affirment, ouvrant des pistes de recherche inédites : la psychologie appliquée (1957) avec Charles Bried ; la documentation et la bibliographie philosophique (1959) avec Gilbert Varet ; le calcul numérique (1961) avec Jean-Louis Rigal ; les sciences et techniques de l’Antiquité (1967) avec Pierre Lévêque ; l’étude des manuscrits et des textes claudéliens et bloyens (1974) avec Jacques Petit ; l’esclavage et les formes de dépendance dans l’Antiquité (1974) avec Monique Clavel-Lévêque ; les mathématiques (1977) avec Jacques Robert ; la cartographie des paysages (1978) avec Jean-Claude Wieber ; l’électrochimie des solides (1979) avec Guy Robert ; la physique atomique et moléculaire (1979) avec Louis Galatry ; les microsystèmes et la robotique (1980) avec François Lhote ou encore la dynamique stellaire et la structure galactique (1980) avec Michel Creze.
Cette vitalité encourage aussi l’implantation des organismes de recherche. Le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) crée ses laboratoires propres avec le laboratoire de physique et métrologie des oscillateurs (1957) avec Jean-Jacques Gagnepain, le laboratoire de l’horloge atomique en 1958, dirigé par Jean Uebersfeld, le centre d’études du français moderne (1964), puis l’institut de la langue française (1977) avec Bernard Quemada. Le CNRS s’associe aussi à d’autres : en mécanique appliquée avec Raymond Chaléat (1966) ; en holographie et traitement optique de signaux avec Jean-Pierre Viénot (1969) ; en biologie et biochimie du développement et sexualité avec Michel Gomot et Jean-Pierre Gaudemer. L’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) confie une unité de recherche à Pierre Magnin en 1966.
Dès les premiers statuts de l’université de Besançon, approuvés par arrêté ministériel du 24 novembre 1970, l’article 31 dispose que « la détermination du programme de recherche et la répartition des crédits correspondants, relèvent exclusivement du conseil scientifique de l’université[3] ». Ce dernier est « présidé par le président de l’université, est composé d’enseignants exerçant les fonctions de professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants, de chercheurs de même niveau, ainsi que de personnes extérieures à l’université de Besançon, choisies en fonction de leurs compétences scientifiques »[4].
Si la recherche universitaire se structure tout d’abord en « laboratoires », leur dénomination évolue avec le temps, dans des termes souvent complexes pour le public extérieur. Rassemblés autour de thématiques, les chercheurs sont souvent liés par une utilisation commune du matériel, comme c’est le cas dans les domaines scientifiques et technologiques.
Puis le concept « d’équipe de recherche (ER) » voit le jour et, lorsqu’une thématique novatrice se profile, on peut assister à l’émergence d’une « jeune équipe » prometteuse. Selon la nature des résultats obtenus, cette dernière devient, ou pas, une équipe de recherche reconnue ou en intègre une autre existante.
Au cours des années, la pluridisciplinarité devient un facteur clé de la recherche et est encouragée. Les chercheurs, issus de domaines scientifiques différents mais complémentaires, se regroupent alors en « unités de recherche » (UR).
Les réformes des années 1982-1984 unifient par ailleurs le modèle de laboratoire mixte de recherche (UMR) regroupant des enseignants-chercheurs de l’université et des chercheurs des organismes nationaux de recherche (ONR), qui sont en priorité le CNRS ou l’Inserm. Avec les encouragements du ministère, ils sont destinés à devenir le modèle prédominant d’auto-organisation locale de la science dans le système français. Les statuts peuvent cependant connaître divers degrés. Par exemple, le 15 septembre 2000, l’équipe d’accueil de microanalyse des matériaux (EA473), dirigée par Alain Chambaudet devient laboratoire de recherche correspondant du CEA (commissariat à l’énergie atomique)[5].
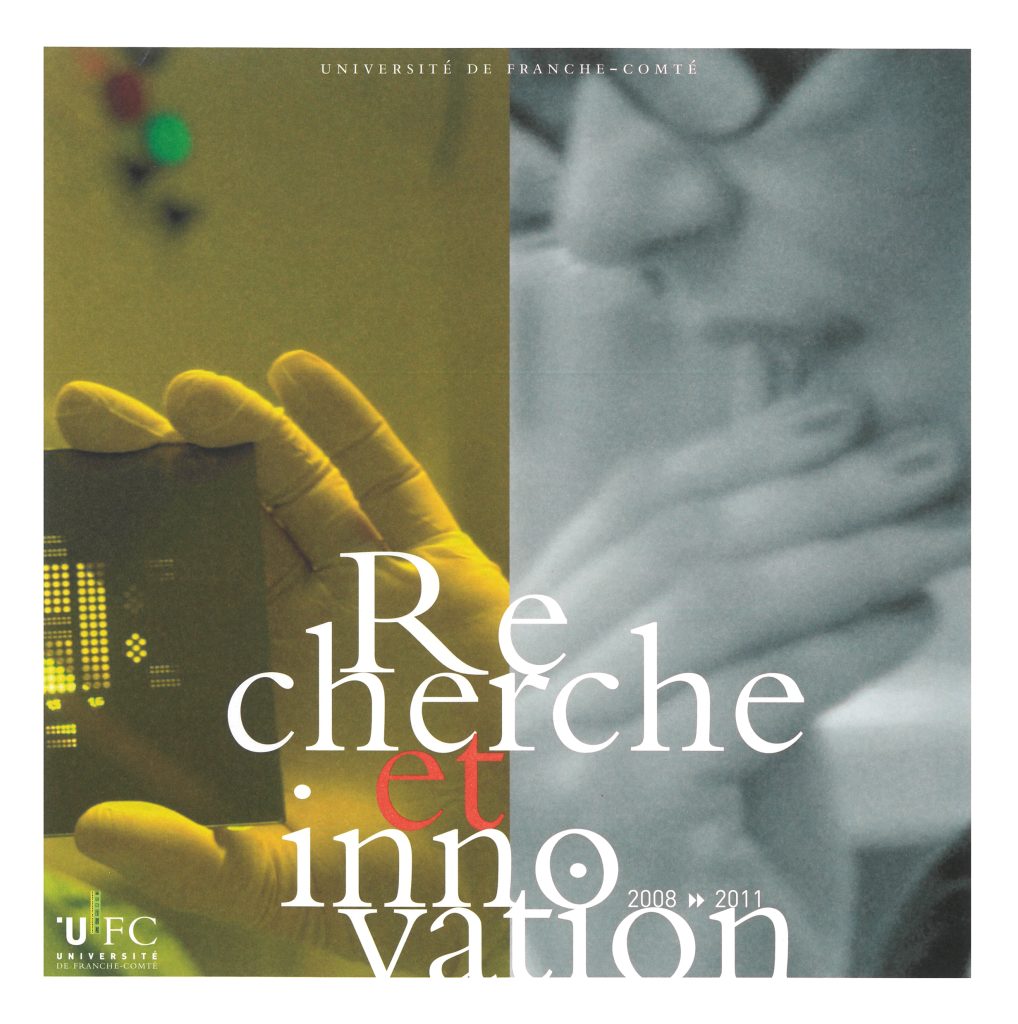
Devant le nombre important d’équipes, qui rend difficile la répartition de l’enveloppe des moyens attribués à chacun, les présidents d’université et leurs conseils scientifiques n’auront de cesse de veiller au renforcement du potentiel de la recherche, afin d’améliorer la cohérence et la lisibilité des équipes. Le ministère encourage cette structuration afin de faire émerger un rayonnement de la recherche française et de flécher davantage les orientations des recherches en réponse aux besoins du développement économique et social français. La consolidation des équipes existantes, l’émergence de champs innovants et la restructuration dans un objectif d’efficience deviennent une préoccupation constante lors des différents mandats. Les grands axes de recherche porteurs pour l’établissement sont alors définis et inscrits dans les contrats d’établissement successifs.