En 1986, l’IUFC restructuré devient le service de la formation continue de l’UFC et poursuit son envol. En 1992[1], il dispose d’un budget de huit millions de francs. Alain Chevillard, à sa tête depuis 1990, dirige une équipe de 18 personnes qui animent et gèrent 1 400 stagiaires pour 12 000 heures de cours. 150 intervenants extérieurs s’ajoutent au vivier des 860 enseignants-chercheurs de l’université susceptibles d’y intervenir. Le service de la formation continue est associé à d’autres organismes socio-professionnels et de formation dans des secteurs très divers : le centre interprofessionnel de promotion économique et sociale (CIPES), l’association Retravailler, la mission locale pour l’emploi des jeunes, l’association départementale de formations des agriculteurs (ADFA), l’institut de formation des travailleurs sociaux (IFTS)… Ce service apporte aussi son savoir dans l’étude des besoins et le montage d’actions que lui confient les collectivités locales, les organismes professionnels, les entreprises. Son réseau dépasse les limites géographiques comtoises : il est associé, par exemple, à la préparation du diplôme d’études supérieurs comptables et financières, avec l’université de Bourgogne.
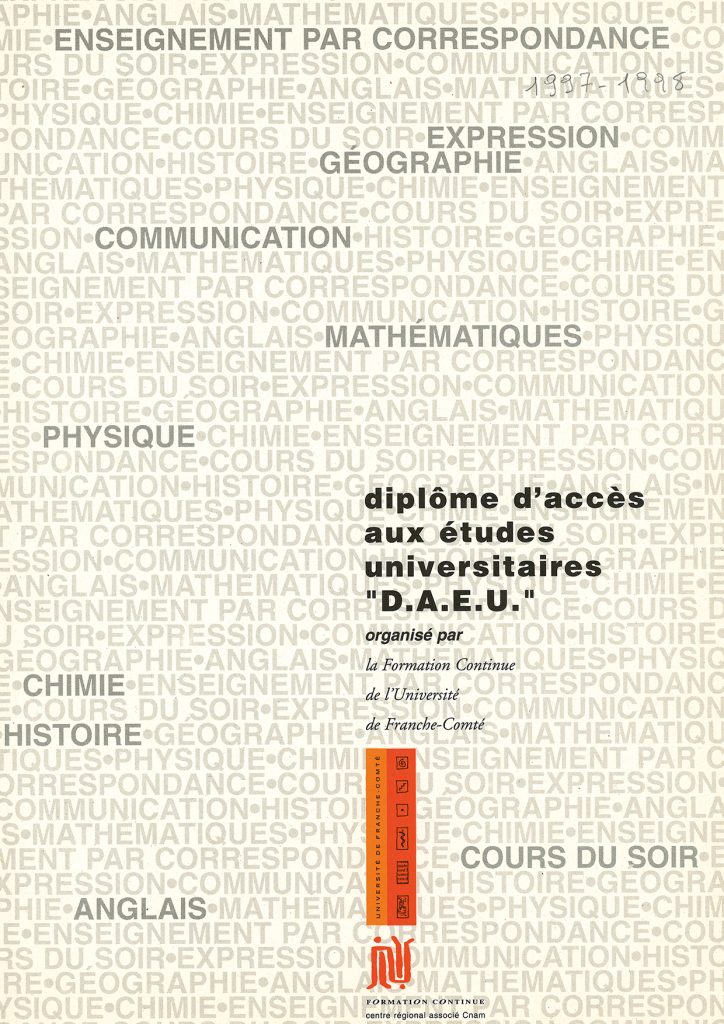
En 1997, l’université de Franche-Comté, dans une trajectoire ascendante, s’inscrit, sous la houlette de son président Claude Oytana (1996-2001), comme un établissement pilote et précurseur en matière de formation continue. En effet, ce service connaissant des difficultés structurelles et financières, Cl. Oytana engage une réflexion sur son devenir dès le mois d’octobre. Il est appuyé dans cette démarche par Bernard Froment[2], enseignant-chercheur en génie mécanique à l’UFR sciences et techniques (ST) depuis 1988, qui connaît bien le champ de la formation professionnelle. Il a en effet, dès 1992, créé (1995), puis dirigé l’IUP ingénierie et qualité, le DRT génie mécanique et qualité, ce qui lui a permis d’introduire l’apprentissage à l’université l’année suivante[3].
Sous la direction de B. Froment, nommé début 1998 en remplacement de Martial Thiriot, le service de formation continue se transforme alors dans son intégralité. D’une structure gérant des actions spécifiques à ce champ d’activité, il devient un service d’appui pour toutes les composantes de l’université souhaitant ouvrir leur activité de formation au champ de la formation professionnelle. Concrètement, Bernard Froment est entouré d’une équipe de neuf personnes[4] dans un noyau central coordonnateur, les autres personnels du service étant désormais répartis au cœur des UFR et des IUT pour contribuer au développement de leurs activités de formation continue. Cette nouvelle organisation est expérimentée à travers le nouveau pôle qualité[5], puis d’autres suivent : l’informatique, la santé, le travail social, les arts, la gestion et l’aménagement du territoire…
Au cours de l’année 1998, une petite révolution interne, pilote à l’échelle nationale, s’engage au sein de l’université de Franche-Comté. Elle devient la toute première université française à ouvrir stratégiquement l’ensemble de sa carte des formations initiales à la formation continue. En 1998, 230 intervenants, à 80 % universitaires, contribuent à la formation continue.
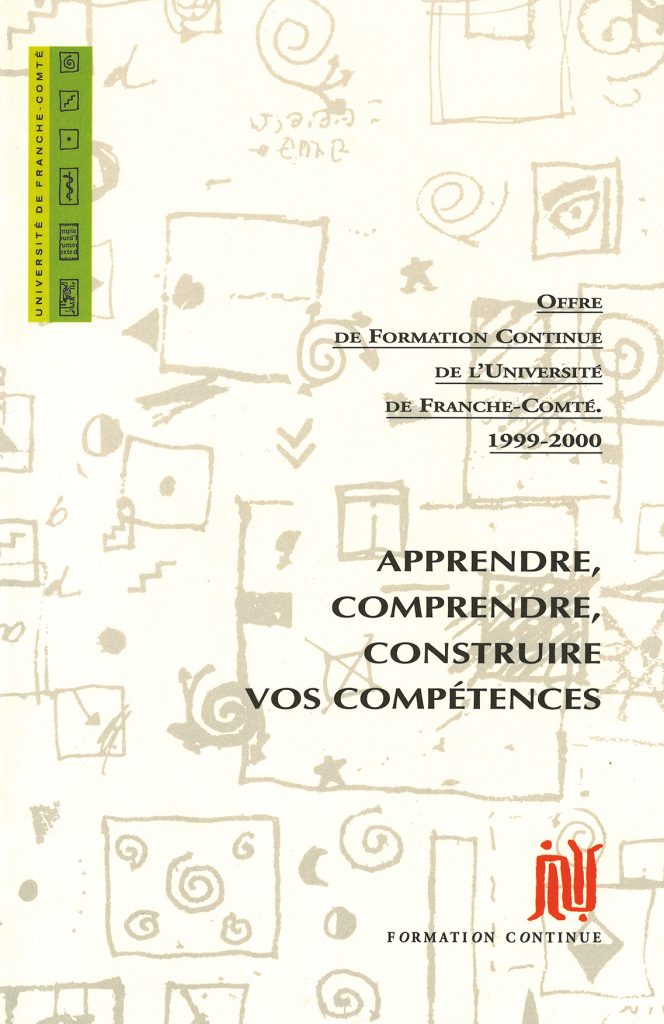
Sous le mandat de Françoise Bévalot (2001-2006), une réforme importante va conforter le rôle du service de la formation continue. Le 17 janvier 2002, la loi de modernisation sociale crée la validation des acquis de l’expérience (VAE) afin de permettre à toute personne engagée dans la vie active de valider les acquis obtenus de ses expériences, notamment professionnelles, en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification professionnelle[6]. Le service de la formation continue de l’UFC s’engage immédiatement dans ce nouveau dispositif précurseur. Ainsi, la même année[7], Evelyne Primo obtient en avant-première cette reconnaissance venant couronner ses vingt-deux années d’expérience professionnelle. Accompagnée dans sa démarche par le soutien décisif d’Anne Montenot-André, conseillère à la formation continue, la candidate tente deux diplômes à la fois : le DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations, option ressources humaines) et la licence professionnelle en gestion des ressources humaines. À la suite de son audition, le jury décide de lui accorder les deux ! Forte de ces deux diplômes qui récompensent ses efforts, la candidate, qui s’était souvent vu reprocher son manque de diplômes en dépit de compétences professionnelles avérées, continue sur sa lancée et poursuit avec un DESS en gestion d’entreprise par télé-enseignement. Le dispositif de la VAE conforte bien la promesse de l’université “ascenseur social”.
En 2004, B. Froment est élu président de la conférence des directeurs de services de formation continue universitaire (CDSUFC)[8]. Il organise à Besançon son colloque national annuel, au cours duquel il institue désormais dans les statuts de l’association sa participation officielle aux réflexions de représentants de vice-présidents d’université, délégués à la formation initiale. La même année, la loi du 4 mai 2004introduit denouveaux dispositifs de formation,tels que la période de professionnalisation et le droit individuel à la formation (DIF).La portabilité du DIF, liant les droits à l’individu plutôt qu’à l’entreprise, amorce un processus d’individualisation du droit à la formation et dégage des perspectives de champs d’action pour le service universitaire. Un nouveau directeur, Gérard Dupuis, est nommé (2004-2012).
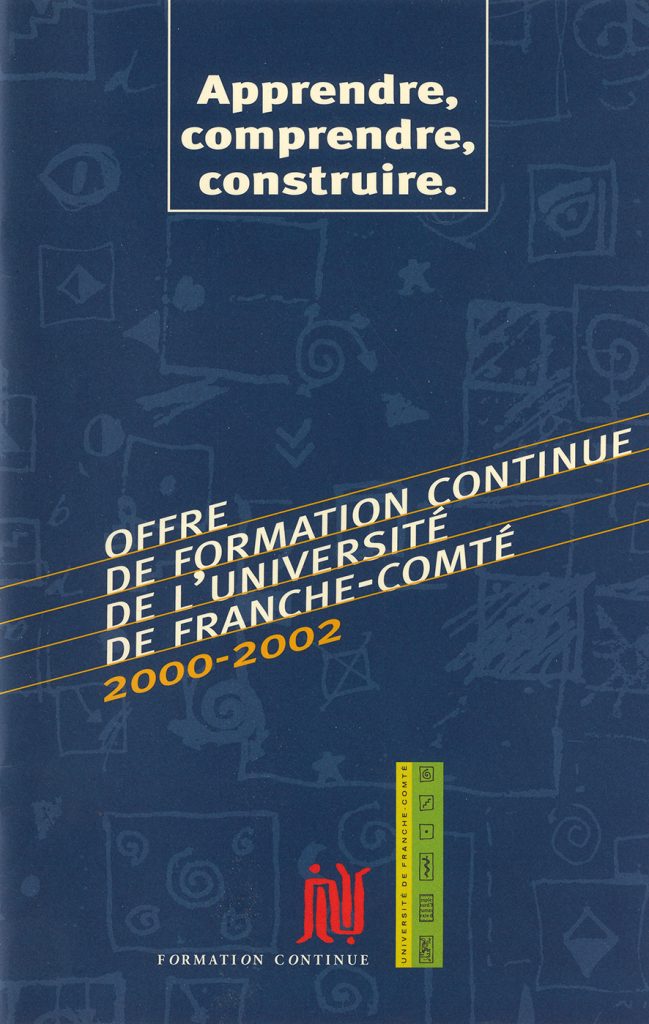
La maison des étudiants[9] ouvre en septembre 2005 à la Bouloie, rassemblant de nombreux services qui leur sont destinés. Le service de la formation continue quitte ses bureaux de l’UFR ST[10] et s’y installe aux côtés, notamment, du service commun d’information et d’orientation (SCUIO) et du bureau de la vie étudiante (BVE).
La vision partagée d’une stratégie d’établissement des deux présidents successifs Cl. Oytana et Fr. Bévalot place l’université de Franche-Comté en pionnière de la formation continue et par apprentissage. Enfin, c’est dans cette période que l’UFC, d’une manière inédite, inscrit la formation continue dans une stratégie globale d’établissement, remarquée par le ministère dans sa façon novatrice de construire et rédiger son projet d’établissement pour préparer son contrat. Là où les écoles d’ingénieurs, de commerce, de management, d’architecture ou d’autres proposent des catalogues de formation continue structurés sur un métier ou sur un champ d’activité précis, l’UFC ouvre largement l’ensemble de ses formations aux citoyens, à titre individuel en formation continue, et le plus grand nombre possible, en fonction de la réglementation, en apprentissage.
Elle propose au monde socio-économique des actions de formation continue de haut niveau, adaptées à leurs besoins spécifiques, fondées sur ses compétences scientifiques, faisant ainsi de la formation continue un véritable outil de valorisation de sa recherche.
Les directeurs de la formation continue (1987-2012)
Jean-Claude Fontaine (1987-1989), Alain Chevillard (1990-1996), Martial Thiriot (1996-1997), Bernard Froment (1998-2004), Gérard Dupuis (2004-2012).