La présence des femmes à l’université est plus que tardive[1]. C’est en 1909 qu’Anna Maiselsemble être la première à soutenir une thèse dans le domaine scientifique à l’université de Besançon. Dans les années 1960, le nombre de jeunes femmes poursuivant des études supérieures devient plus important, dépassant très vite celui des effectifs des étudiants. Avec les années, ce taux augmente graduellement, de 52% en 1989 à 58,6 % en 2023-2024.
Actuellement, les formations qui se sont fortement féminisées sont celles des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (71,8%) et des filières en santé. De même, les étudiantes sont largement majoritaires, à plus de 70%, dans les disciplines de la littérature, des sciences humaines, sociales et du langage, ainsi qu’en droit. Elles restent minoritaires dans les IUT (37% à l’IUT de Besançon-Vesoul et 47% à l’IUT Nord Franche-Comté) et en doctorat. En STAPS, elles sont moins d’un tiers des effectifs (32%), en sciences, le taux est également assez bas (38,7%).
Au 31 décembre 2022, toutes catégories confondues, la part des femmes égale 51,3 % des 2 973 personnels de l’UFC[2]. Elles constituent 48 % des titulaires et 57 % des contractuels. La proportion de femmes représente 62 % des BIATSS titulaires et 40 % des enseignants titulaires (contre 29 % au début des années 2000). Chez ces dernières, la progression est plus forte pour les maîtresses de conférences et les enseignantes du second degré (43%). En effet, les femmes sont souvent sous-représentées, voire absentes, dans les échelons hiérarchiques supérieurs. Pour les professeures des universités, après avoir longtemps stagné au-dessous de 20 %, la part des femmes commence à augmenter depuis 2019. À l’Université de Franche-Comté, 37 % des professeurs des universités de deuxième classe sont des femmes, contre 17 % des professeurs des universités de classe exceptionnelle.
Les femmes ont également rencontré de nombreuses difficultés à accéder à des postes à responsabilités. Sur les dix présidents de l’université, deux femmes seulement ont été élues : Françoise Bévalot (2001-2006) et Macha Woronoff (2020-2024). Sous le mandat de Jacques Robert, une première femme, Marita Gilli, professeur d’allemand, est élue vice-présidente de l’université. Auparavant, elle a également été la première, et la seule, femme directrice d’une UER, celle des lettres et sciences humaines (1980-1986), tout comme Catherine Tirvaudey (2010-2020), également la seule en droit, sciences économiques et sciences politiques (SJEPG) ou Gabriele Padberg (2001-2006) à l’UFR STGI. L’UFR sciences et techniques et l’UFR santé n’en comptent aucune. Dans cette dernière, seules Christiane Guinchard (1987-1993) et Macha Woronoff (2009-2016) réussissent à être élues vice-doyennes, en pharmacie.
L’univers très masculin des STAPS connaît cependant deux directrices : Yvette Demesmay (1992-1997) et Jacqueline Callier (2002-2006). De même, à l’IUT de Belfort-Montbéliard, Marie-Odile Rigo est l’unique directrice (1989-1993) et, à l’IUT de Besançon-Vesoul, Anne-Laurence Ferrari effectue son deuxième mandat depuis 2015.
Les services communs comptent davantage de directrices que les composantes, comme l’illustrent Catherine Caille-Cattin à l’ÉSPÉ (2016-2019) ou Nadia Butterlin à l’ISIFC (2005- 2012). Le CLA atteint le record, avec cinq directrices : Élisabeth Lhote (1980-1983), Évelyne Bérard (1986-1993 / 2008-2013), Anne-Emmanuelle Grossi (2013-2016) et Frédérique Penilla (2016-2019). Les responsables de service sont plus souvent des femmes, comme dans les bibliothèques universitaires, et parfois sur de longues durées. Michelle Genevois à la scolarité (1976-2009), Élisabeth Flénet (1975-2010) au service informatique de gestion, Damienne Bonnamy à l’université ouverte (depuis 2010), Corinne Lesueur-Chatot à la médecine préventive pour les étudiants (depuis 2015), Laurence Ricq à la formation continue (2012-2021), Pascale Brenet à Pépite BFC depuis 2014 ou Karine Monnier-Jobé à OSE depuis 2013 n’en sont que quelques exemples.
Les directions d’unités de recherche restent difficilement accessibles aux femmes. Le mot même de « chercheur » peinant trouver sa déclinaison au féminin… Petit à petit, des premières femmes intègrent les équipes des laboratoires avec un statut autre que celui d’assistante, de technicienne ou de laborantine. Cependant, il faut attendre très longtemps pour que certaines d’entre elles obtiennent la responsabilité d’un laboratoire ou d’un programme de recherche. Une des pionnières a sans doute été Monique Clavel-Lévêque dans l’unité de recherche « L’esclavage et les formes de dépendance dans l’Antiquité », qu’elle crée en 1974. Certains unités sont portées essentiellement par des femmes pendant des années, ainsi le laboratoire de phonétique[3], avec Elisabeth Lhote et Gabriele Konopczynski, qui alternent à cette fonction et font de ce laboratoire une référence bisontine à l’échelle nationale. En 1998, 14 unités de recherche sur 57 sont dirigées par une femme ; en 2001, 8 sur 42 ; en 2009, 6 sur 27 ; en 2012, 6 sur 26 ; en 2024, 9 sur 24.
Le centre de microscopie électronique connaît à trois reprises une direction féminine : Danièle Lenys (1980-1988), Michèle Bride (1988-1996), puis Bernadette Kantelip (1996). Il en est de même pour la direction de l’observatoire de Besançon, tout d’abord avec Claude Chevalier (1983-1987)[4], puis Sonia Clairemidi (1988-1998) et Céline Reylé (2012-2017). Au sein des équipes de recherche, de jeunes docteures, réussissent cependant des carrières exemplaires. Le brillant parcours de Sarah Benchabane-Gaiffe, directrice de recherche du CNRS à l’institut FEMTO-ST, en témoigne[5].
Ces évolutions sont attentivement suivies par les équipes de direction de l’université[6]. Ainsi, les présidents successifs s’attachent à porter cet axe politique. Sous Françoise Bévalot, Jeanine Bonamy est nommée chargée de mission pour la parité hommes-femmes. Cette dernière, enseignante à l’UFR sciences et techniques, est très sensibilisée à la trop faible proportion d’étudiantes en sciences. En 2005-2006, elle organise une campagne de communication intitulée « études scientifiques : pour une égalité des chances filles-garçons » afin de lutter contre les problèmes de stéréotypes dès le lycée. Lors du mandat de Claude Condé, Marie-Cécile Péra poursuit dans cette mission de parité hommes-femmes.
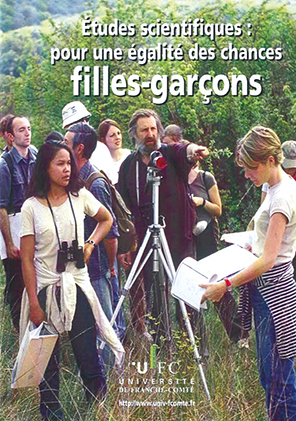
Jacques Bahi nomme Oumhanie Legeard à la mission égalité des chances-égalité professionnelle. Sous l’intitulé « paroles de femmes d’ici et d’ailleurs », elle organise en mars 2015 différents temps de rencontres pour s’interroger sur la question de l’égalité des sexes.

Élodie Crozier.
Sous sa houlette, l’UFC et ses partenaires français[7] portent le projet interrégional du laboratoire de l’égalité (PILE), de 2015 à 2020, en collaboration avec l’université de Genève et ses partenaires suisses[8]. Il a pour objectif de garantir un accès à l’emploi de qualité pour les femmes, une insertion professionnelle durable, et de favoriser leur accès aux postes à responsabilités. Il vise également à échanger les bonnes pratiques en matière d’égalité dans les domaines de l’éducation et de la recherche, en rapport avec le monde professionnel. Des actions communes se développent en vue d’améliorer l’employabilité des étudiants en inscrivant l’égalité dans la formation et la préparation à l’emploi. Ce projet, soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020, bénéficie d’une subvention européenne (FEDER) et fédérale.
En 2015, Pauline Butaud[9], doctorante à l’institut FEMTO-ST, est lauréate d’une bourse L’Oréal-UNESCO pour « Les Femmes et la science » qui valorise son sujet de recherche : « Les polymères à mémoire de forme s’invitent dans les véhicules ».
En 2016, dans le cadre de la coopération franco-suisse de la communauté du savoir (Cds), Oumhanie Legeard et Marie-Cécile Péra, directrice-adjointe de FEMTO-ST, organisent, le 6 juillet, une journée intitulée « Intelligence collective et mixité : une valeur ajoutée pour la formation et la recherche » ; son objectif consiste à sensibiliser la communauté scientifique universitaire au fait que la mixité n’est pas seulement un sujet d’équité, mais aussi et surtout une occasion d’améliorer la performance des équipes[10].
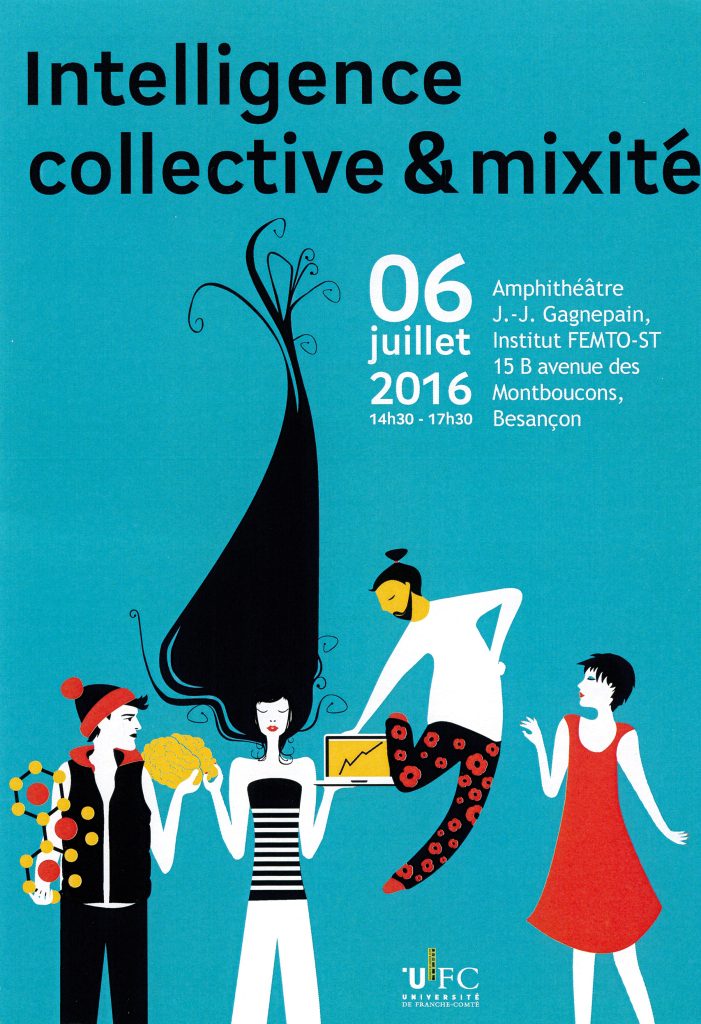
Élodie Crozier.
Différentes conférencières interviennent, dont Claudine Hermann, fondatrice et présidente d’honneur de l’association Femmes et Sciences et vice-présidente de la plate-forme européenne des femmes scientifiques, Nicole Aballéa, consultante, et Brigitte Mantilleri, directrice du service égalité de l’université de Genève.
L’état des lieux est en effet bien alarmant : selon l’UNESCO, moins de 30 % des chercheurs dans le monde sont des femmes. En France, bien que les étudiantes représentent 55 % des effectifs étudiants, elles ne sont qu’à 38,7 % inscrites dans des formations scientifiques à l’université, et moins de 30 % de femmes poursuivent un doctorat en sciences fondamentales et appliquées ou en école d’ingénieurs. Les femmes ne sont que 20% des chercheurs en entreprise et seulement 11% dans les hauts postes académiques. Cette dernière décennie, ce constat au niveau national place l’enjeu de l’égalité professionnelle au cœur de plusieurs textes et lois[11] qui viennent renforcer l’arsenal juridique et politique.
En 2020, la présidente Macha Woronoff signe la nouvelle convention régionale Bourgogne Franche-Comté 2020-2024, pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, dans laquelle elle renouvelle l’engagement pris précédemment par Jacques Bahi pour l’UFC, en 2014. Personnellement très engagée sur ce dossier, Macha Woronoff confie la vice-présidence égalité, laïcité et prévention des discriminations à Bassir Amiri et la mission d’accompagnement de la transformation sociale à Isabelle Jacques. Différentes actions de prévention sont engagées, que ce soit pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles (depuis le 8 novembre 2021) ou la précarité menstruelle[12]. Ces mesures concrètes s’intègrent dans les plans d’action pour l’égalité professionnelle (2021-2023[13] et 2024-2026[14]) en faveur des agents et des usagers, en cohérence avec les orientations et les exigences du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).
Le plan 2021-2023 souligne qu’une problématique fondamentale de l’accès au corps, grades et fonctions réside dans les perceptions a priori des métiers et des carrières. Raison pour laquelle différentes campagnes de sensibilisation sont menées pour briser les stéréotypes de genre concernant les métiers scientifiques. Afin que les lycéennes (public du secondaire) et les étudiantes puissent se projeter et s’imaginer dans une carrière scientifique ou technologique, la mixité dans les domaines de la recherche est, par exemple, promue lors de la journée internationale des « Femmes et des filles de sciences[15] » (le 11 février) ou lors de celle de « Sciences et techniques en tous genres[16]».
Des portraits de femmes scientifiques de l’UFC, inspirantes et passionnées, sont valorisés, via les réseaux sociaux (journée internationale du droit des femmes, le 8 mars) ou dans des expositions, comme « Infinités plurielles », « 145 scientifiques vous parlent de science »[17], « 100 femmes et des milliers d’autres »[18] ou encore « La Science taille XXElles »[19].
D’autres initiatives naissent dans les composantes ou les unités de recherche. Fin décembre 2020, Ausrine Bartasyte, directrice adjointe de l’institut FEMTO-ST et professeure à l’UFC, constatant que ses équipes de recherche ne comptent que 22 % de femmes, crée un Women Chapter, dont le but des actions est d’augmenter la visibilité des femmes et d’améliorer le soutien qui leur est apporté dans le milieu scientifique. L’UpFR sports promeut, avec Anne Tatu, enseignante-chercheure, une politique qui vise à favoriser l’engagement des jeunes femmes dans une pratique sportive de haut niveau, tout en contribuant à leur réussite universitaire.