Sous la présidence de Jacques Bahi, les vice-présidents du conseil scientifique, de la recherche et de la valorisation sont Hervé Richard[1], Nadine Bernard, puis Lamine Boubakar, pour le premier mandat (2012-2016), et Olga Kouchnarenko, pour le second mandat (2016-2020)[2].
Dans le cadre du contrat d’établissement 2012-2016, le nombre d’unités de recherche évolue de 27 à 24 (dont 5 UMR CNRS et 2 INSERM), se répartissant toujours dans les trois domaines : sciences de l’environnement et de la santé, sciences de l’homme et de la société (SHS), sciences pour l’ingénieur et sciences fondamentales (SIF). Des fédérations de recherche s’y ajoutent : FCLAB (Fuell Cell Lab) (CNRS, UFC, UTBM) ; FR-EDUC (UFC), fédération en sciences de l’éducation ; la fédération Mathématiques BFC (CNRS)[3].
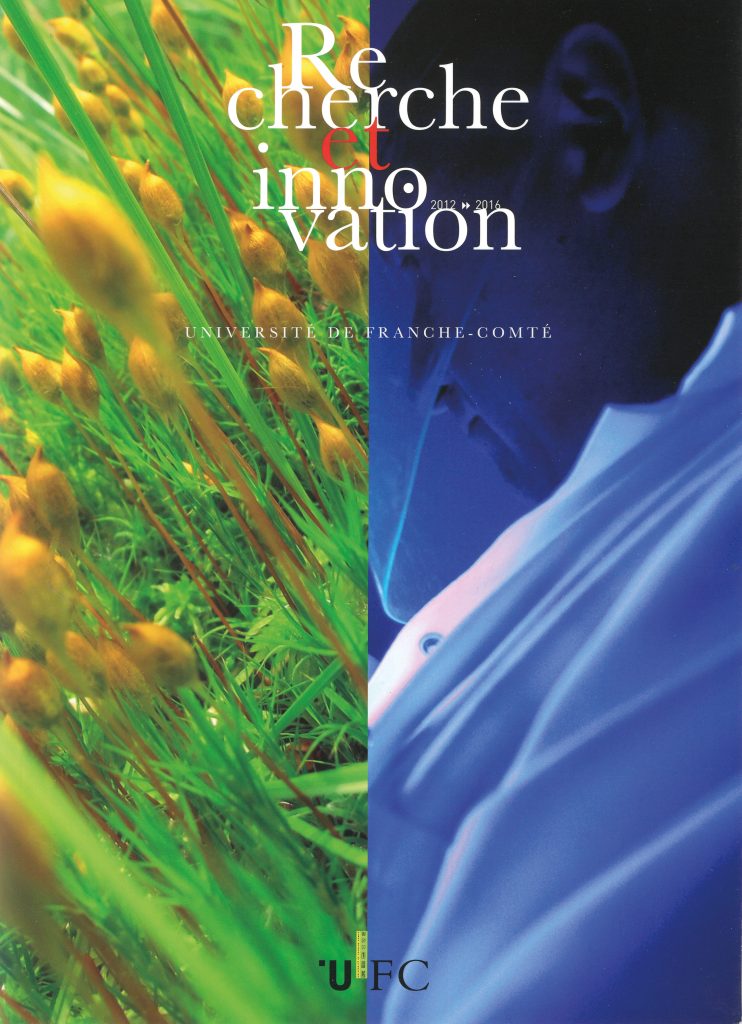
De plus, l’université peut s’appuyer sur onze plateformes technologiques : la plateforme protéomique clinical innovation proteomic platform (CLIPP, UFC et UB) ; la plateforme d’expérimentation animale ; la plateforme génomique SFR FED-IBCT ; la plateforme interrégionale d’imagerie cellulaire (DIMACELL) ; la plateforme exercice, performance, santé, innovation (EPSI) ; la centrale de technologie Mimento-FEMTO-ST ; la plateforme du mésocentre de calcul ; la plateforme technologique de la MSHE Claude Nicolas Ledoux ; la plateforme du laboratoire temps-fréquence (LNE-LTFB) ; la plateforme de caractérisation et la plateforme d’analyse physico-chimique Qualio analyse et environnement.
Afin de renforcer la construction d’une politique scientifique commune, une convention quinquennale interrégionale est signée avec le CNRS sur le site Bourgogne-Franche-Comté, le 10 janvier 2014. Cette cérémonie rassemble pour le CNRS : Alain Fuchs, président, et Philippe Pieri, délégué régional Centre-Est, et pour la première fois les quatre établissements d’enseignement supérieur de Bourgogne-Franche-Comté : Alain Bonnin, président de l’UB, J. Bahi, président de l’UFC, Pascal Brochet, directeur de l’UTBM et Bernard Cretin, directeur de l’ENSMM. Cette cérémonie se déroule à l’université de Bourgogne.

Cette nouvelle convention s’appuie sur des collaborations existantes, dans le cadre du PRES (pôle de recherche et d’enseignement supérieur) et se substitue aux contrats quadriennaux en cours dans chacun des établissements signataires. Le CNRS investit annuellement 26 millions d’euros dans la recherche des deux régions. Cette nouvelle convention inclut 24 structures, ce qui représente environ 850 personnels[4]. Elle favorise ainsi l’homogénéisation de certaines procédures de gestion et d’administration.
Lors du premier mandat de J. Bahi, le projet de rapprochement des établissements d’enseignement supérieur de Bourgogne et de Franche-Comté se concrétise. Près d’une année de concertation aboutit à l’élaboration des statuts[5] de la future communauté d’universités et d’établissements (COMUE). UBFC (université Bourgogne Franche-Comté) est ainsi créée en 2015. Cette nouvelle entité porte désormais la politique commune de site Bourgogne-Franche-Comté des établissements membres. Leur ambition serait d’atteindre une université de rang mondial qui participe au développement régional et national par son rayonnement scientifique, économique social, intellectuel et culturel.
Poursuivant cet objectif, les établissements d’enseignement supérieur, dont l’université de Franche-Comté, transfèrent à UBFC une partie importante de leurs outils de pilotage, autant d’éléments identitaires caractérisant une université de recherche. Il s’agit de sa capacité à délivrer, seule, le doctorat, l’habilitation à diriger les recherches (HDR) ou encore la coordination des stratégies des unités de recherche. Cela recouvre également l’attribution des crédits récurrents de fonctionnement des équipes, la signature scientifique commune et le portage des projets conjoints, stratégie qui se révèle payante. En effet, en 2016, UBFC devient la première COMUE lauréate du PIA (programme d’investissements d’avenir), grâce à son projet ISITE Bourgogne-Franche-Comté.
Affirmant ses propres spécificités, l’université de Franche-Comté continue à développer le partenariat franco-suisse, issu de la convention du collegium SMYLE, signée en octobre 2013, avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle permet à l’UFC de renforcer son rôle d’acteur européen de l’Arc jurassien, dans le domaine des sciences pour l’ingénieur. La même année, l’université crée, avec le soutien financier de la région BFC, la fondation partenariale FC Innov’, qui a pour but de construire des actions contribuant à promouvoir les activités de recherche de l’université, afin de créer le trait d’union entre les résultats de l’activité des laboratoires et le monde socio-économique.
Parallèlement, le service sciences, arts, culture, créé en 2014, complète la valorisation de la recherche et suscite, en s’adressant au plus grand nombre, les vocations du jeune public. En mai 2016, l’université obtient le label européen HRS4R, validant sa stratégie RH en matière de recherche et valorisation.
Dans le domaine de la santé, l’université signe une convention de partenariat avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon. Elle concerne certains axes de recherche, prémisses d’un continuum recherche fondamentale-recherche clinique, les équipes de recherche communes et la mutualisation des équipements et plateformes. Les partenariats sont également renforcés avec l’établissement français du sang (EFS) et avec l’INSERM. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, au sein de la COMUE UBFC, la MSHE Claude Nicolas Ledoux accroît ses liens avec la MSH de l’université de Bourgogne.
Le second mandat de Jacques Bahi s’inscrit dans le projet d’établissement 2017-2021. Dès 2016, la création de cinq collegiums[6]apporteune importante modification de la structuration de l’université. Conçus comme un organe consultatif d’aide à la décision, ils visent à renforcer l’attractivité du territoire dans tous les domaines de formation et de recherche de l’université. Trois collegiums correspondent aux trois axes scientifiques du projet I-site BFC[7], ce qui permet d’assurer une cohérence du projet à l’échelle de l’établissement et d’en simplifier le pilotage.
En 2017, UBFC est lauréate de deux appels à projets d’envergure : l’école universitaire de recherche EIPHI et l’initiative d’excellence en formations innovantes RITM. L’année suivante, la direction de la recherche et de la valorisation (DRV) réunit désormais les services recherche et valorisation. En 2019, s’ouvre, à l’UFC, le premier centre universitaire français d’études et de recherches olympiques universitaires (CEROU). En 2020, l’université et ses partenaires membres de UBFC sont lauréats de l’appel à projets PIA Grandes universités de recherche, dans le cadre des appels Intégration et développement des IdEx et des ISITE (IDéES) et Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence (SFRI) : il s’agit des projets UBFC-INTEGRATE et IDISITEBFC.