La dématérialisation des enseignements, souvent associée à la pandémie de la Covid-19 et à la fermeture pendant plusieurs mois des universités à travers le monde en 2020, recouvre une histoire plus ancienne qu’il n’y paraît, notamment à Besançon. Dès le milieu des années 1960, l’État, confronté à l’arrivée des enfants du baby-boom, suggère la création d’un enseignement diffusable à la radio et à la télévision, pour compléter l’enseignement classique, et débloque des crédits à cet effet. Dans l’est de la France, les universités de Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg tentent l’expérience[1], en commençant à produire des « cours radio ». Ils sont complétés, par la suite, par des cours écrits et des documents d’accompagnement. C’est ainsi que de véritables formations par correspondance se structurent. À Besançon, dès 1966, le Centre de téléenseignement de l’université (CTU) lancé par Jacques Gavoille, son directeur jusqu’en 1990, propose de valider à distance une licence, puis un master en histoire, son champ disciplinaire.
En 1974, un nouveau pas est franchi avec la création de la fédération interuniversitaire du téléenseignement de l’Est (FIT Est), qui regroupe les cinq universités pionnières : Besançon, Strasbourg, Reims, Nancy et Dijon. Les établissements, sous cette bannière, se répartissent entre eux, de façon concertée, les formations proposées par voie de téléenseignement afin d’éviter les doublons. Au fil des ans, Besançon prend en charge les filières en histoire, en AES et en mathématiques[2]. La FIT Est permet à l’étudiant d’un CTU de suivre un module auprès d’un des autres CTU et de passer ses examens dans le centre le plus proche de son domicile. En 1987, à l’initiative du ministère, est créée la FIED[3], fédération interuniversitaire de l’enseignement à distance, association dont Ronan Chabauty, directeur du CTU de Besançon, devient président en mai 2002 pour trois années.
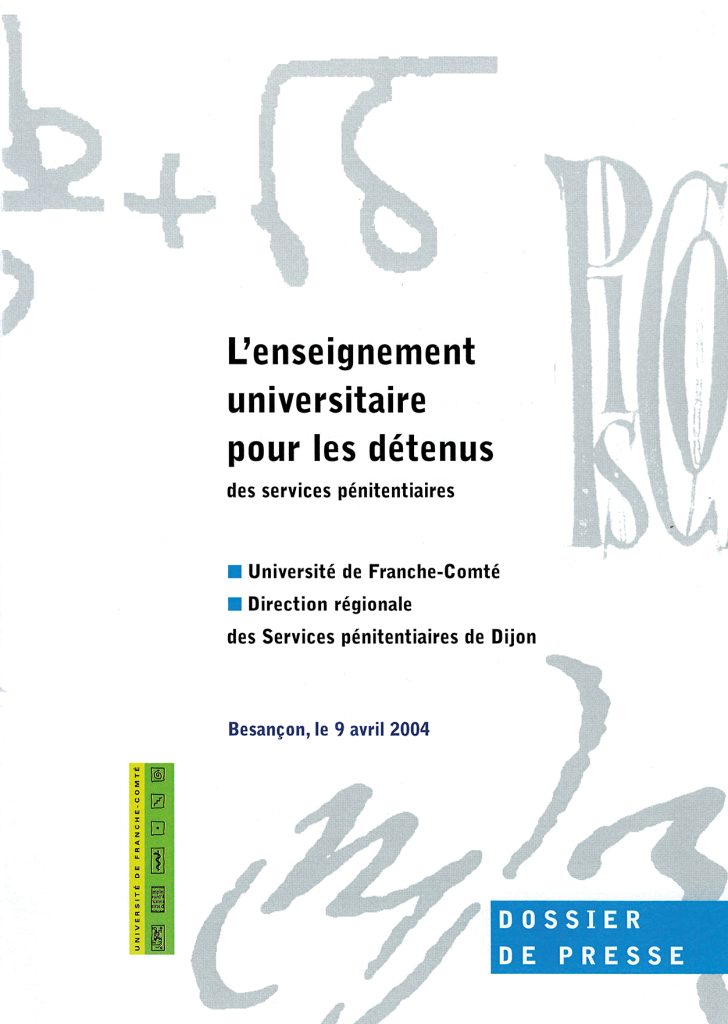
Depuis sa création, la mission du CTU est d’offrir une véritable alternative d’études à un public spécifique, dit « empêché ». Il s’agit d’étudiants qui ne peuvent suivre un cursus en présentiel à l’université, en raison d’une activité professionnelle (pour 80 % d’entre eux) ou pour des raisons médicales, familiales ou autres (pour les résidents à l’étranger, les appelés au service national, les détenus). Il leur permet d’obtenir une licence ou un master, mais aussi des diplômes équivalents du baccalauréat, comme les DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) A et B ou le certificat de capacité en droit.
Le 9 avril 2004, Françoise Bévalot, présidente de l’université, et Alain Jego, directeur régional des services pénitentiaires de Dijon, signent une convention pilote, qui permettra aux détenus de 18 établissements pénitentiaires, situés en Champagne-Ardennes, Bourgogne et Franche-Comté, de bénéficier d’une formation universitaire à distance avec le CTU.

Le succès de l’enseignement à distance est croissant. Les effectifs du CTU[4] progressent régulièrement pour atteindre, en 2005, un pic de 1 775 étudiants. De nouvelles filières voient le jour, comme la licence (1999) et la 1re année de master en informatique[5] (2005) à distance, toutes deux créées sous la responsabilité d’Isabelle Jacques[6]. À cette date, la moitié des 200 étudiants inscrits est constituée d’étudiants internationaux, résidant dans des pays francophones des continents africain, asiatique ou américain.
Le CTU est initialement implanté sur deux sites : à l’UFR sciences pour le secrétariat pédagogique des mathématiques et dans des bureaux rue Xavier Marmier, pour la direction, l’administration et le secrétariat pédagogique en histoire et en AES. Il déménage, en 2005, dans le nouveau bâtiment construit sur le site de la Bouloie. Pour promouvoir ses services auprès de ces publics, le CTU a su se doter d’une identité visuelle forte et mettre en place des campagnes de communication attractives. Le premier logo est conçu par la graphiste Catherine Zask en 1987, le second en 2010 par Catherine Bouteiller.
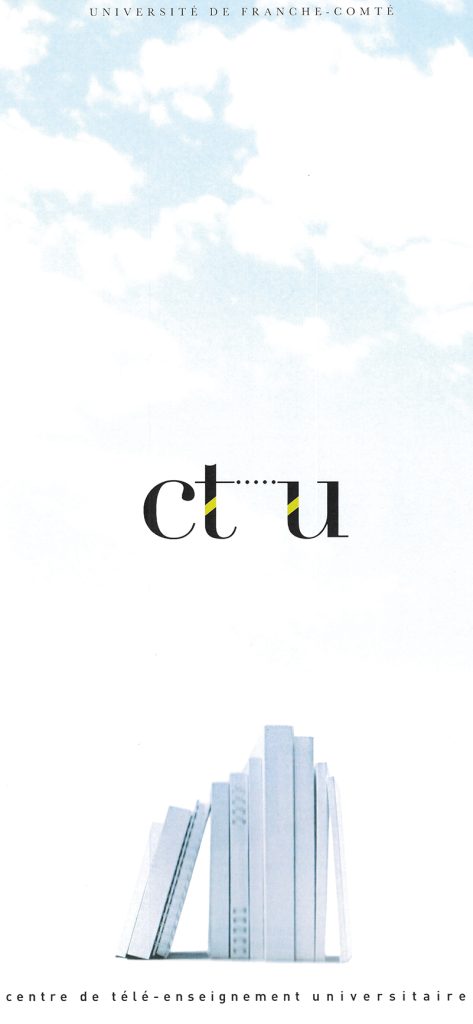
En 2016, le CTU renforce également le lien avec les sportifs de haut niveau, notamment par le biais d’une convention avec l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance). Il accompagne la Haute école spécialisée à distance de Suisse (HESD) lors de sa création en 1998 et jusqu’en 2019, permettant aux étudiants d’effectuer 80 % de leurs études à domicile. Toujours à l’international, son directeur Ronan Chabauty, qui a établi des liens étroits avec Djibouti, assiste le gouvernement de ce pays dans la création de son université.
La première expérimentation de la télésurveillance des examens a lieu en 2019. Elle concerne, cinq ans plus tard, près de la moitié d’entre eux. En septembre 2019, le CTU intègre le Service universitaire de la pédagogie pour les formations et la certification (SUP-FC), permettant ainsi le regroupement de trois missions dans ce service commun : l’accompagnement pédagogique, l’enseignement à distance et la certification. Le Centre d’accompagnement pédagogique propose du conseil en ingénierie pédagogique, des formations, des ateliers et des ressources matérielles. S’adressant à l’ensemble du corps enseignant et des personnels de l’université de Franche-Comté, il a pour ambition de développer et de valoriser les innovations pédagogiques, en présentiel et en distanciel. L’objectif est de soutenir l’émergence d’idées pour mettre en place de nouvelles pratiques, visant à susciter l’intérêt des étudiants, à améliorer leurs apprentissages et à accompagner leur réussite. Depuis 2020, une réflexion est menée sur l’approche par compétences. En 2023, le dépôt de la nouvelle carte des formations (2024-2028) a vu la description de chaque diplôme accompagnée de son référentiel de compétences. En étroite collaboration avec les différentes composantes, le Centre de certification organise, quant à lui, les 24 certifications[7] proposées à l’UFC, dont le TOEIC[8], le PIX[9] et le projet Voltaire.
En 2020-2021, la pandémie de la Covid-19 se révèle un véritable accélérateur de la transition digitale, attestée par les données du CTU. Désormais, les étudiants, mieux équipés, bénéficient de connexions de meilleure qualité, ce qui explique en partie la démocratisation des télé-examens. Seuls 1 % des étudiants ne passent pas l’étape des tests de niveau, contre 15 % avant la pandémie.
L’origine des nationalités évolue également. Avant la pandémie, 15 % des étudiants inscrits au CTU venaient de Franche-Comté, 20 % du reste de la France, 32 % de l’Europe et 33 % du reste du monde. Aujourd’hui, 65 % sont en France, 10 % en Europe et 25 % dans le reste du monde. Après l’année du Covid en 2020-2021, où le CTU a retrouvé son premier pic de près de 1 700 inscrits, les chiffres sont revenus, l’année suivante, à un seuil proche d’avant la pandémie, aux environs de 1 400. Le recours aux méthodes permettant de créer et faire perdurer un lien numérique avec les étudiants s’est néanmoins durablement installé après cette période : en témoigne l’usage plus important des outils tels que la plateforme Moodle et des nouveaux supports de cours.
Au fil du temps, le CTU, toujours en adéquation avec les évolutions technologiques les plus récentes, a mis en place des méthodes innovantes d’enseignement à distance. Ainsi, après la diffusion des cours sur cassettes audio et leurs envois postaux, puis la diffusion radiophonique, les cours papier et leur enregistrement sur cédérom, la plateforme pédagogique Moodle permet, désormais, la publication des cours en ligne et assure l’interface numérique avec les étudiants. À l’université de Franche-Comté, les examens se déroulent principalement à Besançon. Les étudiants résidant à l’étranger ont la possibilité de demander une ouverture de centre auprès d’une ambassade ou d’un établissement d’enseignement, dans leur pays, afin de se rendre plus facilement aux examens.
Largement tourné vers l’international, tout en étant attentif aux populations locales susceptibles de ne pas entrer dans le cadre classique des études « en présentiel », le CTU propose une offre à distance complémentaire de ces dernières. En cela, la dématérialisation croissante de l’enseignement semble offrir une piste de réflexion et représenter un vecteur toujours plus important de la formation des adultes.
Date de création des diplômes du CTU
- Diplôme d’accès aux études universitaires A – littéraire – et B – scientifique (2010)
- Certificat de capacité en droit (2020)
- Licences en : histoire (1966) / mathématiques (1968) / administration économique et sociale (1996) / géographie (2008, fermée en 2013) / sciences pour l’ingénieur (précédemment au CNAM et intégration à l’UFC en 2016) / licence 3 en informatique (2000, fermée en 2024)
- Masters en : histoire (1966) / mathématiques (1968) / finance (2004) / géographie (2008) / informatique, avec 3 parcours : informatique avancée et applications (2003), développement et validation du logiciel (2013), ingénierie du test et de la validation logiciels et systèmes (2016) / français langue étrangère (2009) / enseignement des mathématiques (2017, fermé en 2021)
Les directeurs du CTU
Jacques Gavoille, professeur d’histoire (1966-1990) ; Ronan Chabauty, professeur de mathématiques (1990-2010) ; Dominique Poincelot, maître de conférences en gestion (2010-2013) ; Fabrice Bouquet, professeur en informatique (2013-2023) ; John-Pol Pierrel (2023-…).